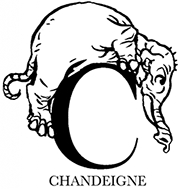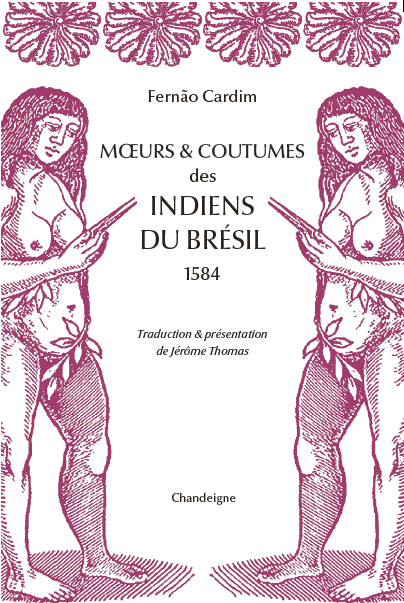- L'Histoire
- Le Monde
- France Culture - Le cours de l'histoire
- Radio Alfa - Passage à niveau
- Revue Mythologie
- Revue du MAUSS - Éditions Le bord de l'eau - CAIRN.info
- IdeAS - Idées d'Amérique
Voyage chez les Tupi
Des Amérindiens du Brésil on ne connaît, en France, le plus souvent, pour le XVIe siècle, que les écrits d’André Thevet (Les Singularités de la France antarctique, 1557) et du huguenot Jean de Léry (Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique, 1578). Mais voici une première : la traduction en français de textes originaux du missionnaire jésuite Ferñao Cardim, près de quatre cents ans après leur première édition en anglais.
Ferñao Cardim est moins connu que d’autres évangélisateurs et chroniqueurs de son ordre comme Manuel da Nóbrega, qui inaugura en 1549 les missions d’évangélisation jésuites au Brésil, José de Anchieta, qui, dit-on, fonda São Paulo en 1554, ou encore António Vieira, grand prédicateur et écrivain du XVIIe siècle, considéré jusqu’il y a peu comme un défenseur des Amérindiens, mais aujourd’hui décrié pour son silence sur l’esclavage. Pour autant, arrivé dès 1583 au Brésil où il demeure jusqu’à sa mort en 1625, sauf pour un séjour à Rome de 1598 à 1601, puis en captivité en Angleterre jusqu’en 1603, ses textes, somme toute précoces, sont de première importance pour la connaissance des peuples tupi. Délaissant quelque peu leurs croyances, vues comme nulles et non avenues, mais suivant en quelque sorte la grille d’analyse de saint Ignace pour l’évangélisation, il décrit leur nourriture, leurs habitations, leurs vêtements, leurs organisations familiales, leurs jeux.
L’édition réalisée par Chandeigne est un petit bijou. En format poche, l’ouvrage est illustré par des cartes de qualité et d’excellentes reproductions d’images parmi les plus célèbres des chroniques et livres de ces époques : Hans Staden, Eckout, Kilian, Thevet, Léry et en particulier Théodore de Bry. L’appareil critique, réalisé par Jérôme Thomas (notes, bibliographie, et surtout un dossier historique et anthropologique qui représente plus de la moitié du volume), est tout à fait complet, parfois même redondant dans la précision de ses références. Tout est dit sur les tribulations de Cardim, et de ses manuscrits : revenant de Rome, son navire est arraisonné par un corsaire anglais, Francis Cook, qui le fait prisonnier et vend ses écrits, dont on peut suivre ensuite les diverses éditions. De retour au Brésil, il devient provincial de l’ordre pendant cinq ans. Mais l’essentiel est bien la description des Amérindiens, surtout les Tupinambas, avec la marque des Jésuites qui s’immergeaient dans les sociétés indigènes et apprenaient leurs langues pour ensuite les évangéliser. Anchieta est ainsi l’auteur d’une première grammaire tupi.
Le texte édité apparaît dès lors comme une contribution aux débats d’aujourd’hui sur le rôle de ces évangélisateurs : ont-ils été protecteurs des Indiens (notamment contre les colons eux-mêmes) ? Destructeurs de leur culture, et de leur imaginaire ? Et aux débats sur la colonisation dans l’histoire. Des controverses qui prennent un tour plus aigu encore avec les attaques directes portées actuellement contre les droits des Amérindiens du Brésil.
La plupart des récits et chroniques sur les Amérindiens du Brésil aux XVIe et XVIIe siècles décrivent les rites anthropophages, et Théodore de Bry les illustre abondamment. Le texte de Cardim est sans doute le plus précis à cet égard. Au-delà de la condamnation morale sur ce qui est dénoncé par tous comme la preuve même de la barbarie, Cardim est très soucieux d’exactitude, presque d’objectivation. Les anthropologues, après lui, ont expliqué le sens de ces rites.
L’histoire – Septembre 2021
L’évangélisation des peuples du Brésil par les jésuites portugais fut à la fois, on le sait, l’un des axes de la lutte à mort coloniale, et l’occasion d’un recueil de données à grande échelle sur les cultures que l’on conduisait ainsi à l’extinction. De ce double mouvement, le père Fernao Cardim (1549-1625) est un parfait représentant. Arrivé au Brésil en 1583, il y passera le reste de sa vie, laissant plusieurs manuscrits, dont « Du principe & de l’origine des Indiens du Brésil & de leurs coutumes, adorations et cérémonies », consacré aux communautés tupi, qui contient entre autres la description la plus précise des rituels anthropophagiques, auxquels le jésuite a pu assister. Il est ici traduit en français pour la première fois, accompagné d’un dossier critique très complet.
Florent Georgesco – Le Monde – Juin 2021
Jérôme Thomas intervient dans l’émission de Xavier Mauduit « Le cours de l’histoire »
Série « Tous à poil ! Histoire de la nudité »
Épisode 2/4 : Du bon sauvage à l’indigène, regards européens sur le corps nu
Des premiers voyages des explorateurs au XVIe siècle jusqu’à l’expansion coloniale au XIXe siècle, le corps de l'”Autre” fascine autant qu’il inquiète les Européens. Comment la figure du “sauvage” évolue-t-elle dans le regard occidental ?
Pour écouter l’émission, veuillez cliquer ici !
Radio Alfa
Émission Passage à niveau
Artur Silva a reçu Jérôme Thomas, traducteur, auteur de l’introduction et du dossier historique de Moeurs et coutumes des indiens du Brésil.
À écouter ci-dessous :
En 1582, le jésuite portugais Fernão Cardim est envoyé au Brésil pour rendre compte de l’avancé de l’évangélisation. Il se familiarise aussitôt avec l’environnement et observe finement la faune et la flore brésilienne, tout autant que les coutumes des populations indigènes. Il compilera ses impressions dans ce texte qui offre de précieux renseignements sur les moeurs et coutumes indigènes.
Revue Mythologie – Numéro 46
Haut dignitaire jésuite, Fernão Cardim débarque au Brésil en 1583. Dans ce petit traité, mal connu, mais essentiel, il rassemble tout ce qu’il croit savoir des multiples nations indiennes (76 selon lui) qui survivent encore à la conquête portugaise. Le tout est passionnant, et plus particulièrement le long chapitre intitulé « De la manière des Indiens de tuer & de manger des humains », qui est peut-être le récit le plus détaillé et fascinant dont nous disposions sur les rituels anthropophages tupi- guaranis (dans lesquels on ne tue et ne mange un prisonnier qu’après avoir vécu plusieurs années avec lui). Notons que si les captifs refusent de s’enfuir c’est que « certains semblent si heureux d’être mangés qu’en aucune façon ils ne consentiraient à être délivrés pour servir car ils disent que c’est une triste chose de mourir, d’être nauséabond et de se faire manger par la vermine » (p 48). Croyance partagée par leurs vainqueurs et futurs bourreaux. Elle n’est pas sans évoquer « la belle mort » des Grecs, si bien décrite par Jean-Pierre Vernant. [A.C]
P.S. Et ajoutons que le livre, très joliment mis en page, est assorti de magnifiques gravures anciennes.
Revue du MAUSS – n° 58 – Février 2021
La publication de la traduction en français du récit du missionnaire jésuite portugais Fernão Cardim, qui a séjourné au Brésil dans les années 1580, dans une édition qui comporte une présentation, des notes explicatives et un commentaire de Jérôme Thomas, apparaît opportunément dans un contexte où l’Amazonie brésilienne et les peuples indigènes du Brésil reviennent dans l’intérêt et l’imaginaire européen. La nouvelle conscience écologique, tout comme les démarches de réécriture de l’histoire et de nouveaux droits attribués aux peuples autochtones du Brésil depuis désormais plus de 30 ans (la nouvelle Constitution brésilienne après la dictature civile et militaire date de 1988), sont les principaux moteurs de cette forme de redécouverte, y compris en Europe. Ce livre devient donc un document incontournable pour les études et la connaissance en France (ou en langue française) des Indigènes brésiliens.
Il s’agit tout d’abord d’une très belle édition, accompagnée de plusieurs sources iconographiques, des peintures et des gravures des voyageurs européens du XVIe siècle également, comme André Thevet, Théodore de Bry, Hans Staden, Albert Eckhout. L’ensemble de cette iconographie est déjà en soi une source précieuse, qui peut aussi être utilisée, au demeurant, par les enseignants, universitaires et chercheurs.
Pour ce qui est du récit de Cardim, « Le Traité de la terre et du peuple au Brésil », il occupe les 53 pages centrales de l’œuvre. Il est accompagné de cartes représentant la division du territoire et la répartition de la population indigène dans le territoire brésilien au XVIe siècle, dont certaines sont produites à partir des éléments fournis dans son récit. Mais qui était Fernão Cardim, comment son texte est-il parvenu à être connu et que nous apprend-il ?
Cardim est né au Portugal à la fin des années 1540. Il fait sa formation de novice chez les Jésuites du collège d’Évora, où il reçoit un enseignement en humanités et en théologie notamment. En 1582, il est envoyé au Brésil ayant comme mission d’évangéliser les populations indigènes et d’accompagner le travail des Jésuites. Cette mission, comme le dit J. Thomas dans la présentation du livre, n’était pas sans danger, puisque de nombreux missionnaires ou voyageurs « finissent en martyrs, taillés en pièces ou rôtis lors des cérémonies cannibales. » (p. 8). Cardim restera au Brésil jusqu’à sa mort en 1625, mais son séjour est interrompu deux fois, entre 1598-1601, quand il est nommé à un poste à Rome, et entre 1601-1603, quand il est retenu comme prisonnier en Angleterre. Ses manuscrits – dont il fait référence dans sa correspondance en prison – sont d’ailleurs récupérés par les corsaires anglais en 1601, qui les vendent. Ils sont édités en version anglaise en 1625, dans une œuvre de compilation de récits de voyage. Le texte, portant sur les Indigènes, la faune et la flore au Brésil, est attribué au jésuite Manuel Tristão. C’est seulement dans les années 1880 que l’historien brésilien Capistrano de Abreu reconnaît Fernão Cardim comme l’auteur du récit. Il publie une édition dans laquelle il se trouve aux côtés de plusieurs autres Jésuites qui font état, dans leurs différents récits, de leur connaissance sur le Brésil et les peuples indigènes entre les années 1550 et 1595. Le texte est à nouveau édité en 1925 par l’académie brésilienne des lettres, puis en 1939 dans la fameuse collection Brasiliana. C’est à la fin des années 1990 seulement qu’une nouvelle édition voit le jour au Portugal. Les originaux sont conservés à La Biblioteca Pública e Arquivo Distrital d’Évora. Selon le commentaire de la bibliographie fait par Jérôme Thomas à la fin de la présente édition, une traduction en français aurait été commencée par Blaise Cendrars, mais ce travail ne fut jamais abouti.
Cardim, qui était contemporain des pères Nóbrega, Anchieta ou Vieira, est souvent éclipsé par ceux-ci. Toutefois, son récit est tout aussi important pour la compréhension des éléments de la culture indigène (les « mœurs » ou « habitudes », selon l’auteur), avec de nombreux détails et une riche description des pratiques. Le récit de Cardim a été écrit comme un rapport, dans le but de décrire et d’être utile pour les Jésuites dans leur travail d’évangélisation, notamment pour la connaissance de la population indigène. En ce sens, il doit être lu avec un filtre prenant en compte le fait qu’il s’agissait bien d’un regard d’un religieux européen, dans le but de mieux comprendre pour mieux civiliser ou évangéliser ces populations. Ce n’est pas, toutefois, un récit qui porte d’importants jugements de valeur. À certains moments, Cardim pose un regard plutôt indulgent envers les Indigènes de la branche tupi-guarani, mais pas forcément sur les tapuyas, les ennemis des tupis. D’ailleurs, cette division entre peuples tupi (voire tupi-guarani) et tapuyas est reprise par l’anthropologie brésilienne (chez Darcy Ribeiro notamment, mais aussi chez Eduardo Viveiro de Castro et Manuela Carneiro Cunha, entre autres).
Cardim commence cette partie de son récit traitant des éléments de la cosmologie des Indiens, qui même sans avoir « aucune connaissance sur son créateur ni des choses du ciel », savent que « nous avons une âme et que celle-ci ne meurt pas » (p. 27-28). Il cite les noms des entités, liés aux phénomènes naturels, comme Tupã (Dieu), ainsi que les mauvais esprits, comme « Curupira », « Taguaiba », entre autres. Mais la question de la « foi » des Indigènes n’est pas le principal centre d’intérêt de Cardim. Il parle plus longuement des fêtes, toujours arrosées d’une boisson alcoolisée qu’il appelle « le vin indigène ». Il s’agit en effet du « caouin », qui est « l’appellation commune pour rendre compte des boissons fermentées à base de maïs ou de manioc consommés par les Tupinamba » (note 3, p. 30, de l’organisateur). Il parle de la nourriture abondante et partagée, fruit des chasses et des pêches, et du fait que « Ce gentil mange tout le temps, nuit et jour, à chaque heure et moment de la journée. » (p. 31). Aux yeux de Cardim, les Indigènes mangent tous « les animaux répugnants », ainsi que les fruits et légumes qu’ils ne cultivent pas. Cardim dit que les Indigènes ne sont pas très propres pour manger, ce qui va à l’encontre d’autres récits existants, comme ceux de Jean de Léry et Yves d’Evreux. Ces auteurs soulignent le fait que les peuples indigènes étaient très propres et soignés, comme l’observe l’organisateur du livre (note 1, p. 32).
Cette comparaison entre les récits, dans les notes, dans l’introduction ou dans les commentaires à la fin, est d’ailleurs un point fort de l’ouvrage, quand bien même les commentaires dans le « dossiers historiques et anthropologiques » (p. 73-159) sont parfois un peu redondants.
Les Indigènes, appelés souvent « les Gentils » par Cardim, vivent dans de grandes ocas (maisons) à plusieurs dizaines, voire centaines de personnes ; organisés autour d’un ou de plusieurs « Indiens principaux ». Ils dorment dans des hamacs et chaque hamac a son feu allumé en dessous. Ils portent des cheveux de différentes manières selon les événements de leurs vies (les femmes peuvent couper leurs cheveux pour faire le deuil de leurs maris, par exemple). Une nation peut en reconnaître une autre par la façon dont les cheveux sont coupés.
Dans une lecture attentive, nous pouvons constater que le récit n’est pas une description pure et simple de la vie des Indigènes comme s’ils étaient figés dans le temps et pourraient être décrits comme vivant exactement dans les mêmes conditions qu’avant l’arrivée de Cabral. Cardim laisse transparaître quelques modifications dans la culture des Indigènes car ils étaient en relation, à cette époque, avec les Européens. Il parle ainsi de l’usage du fer pour faire des outils tranchants comme une technique récemment acquise, ainsi que du fait que les Indigènes, qui d’habitude se « promènent nus, et il n’y a aucune sorte de vêtements et pas de honte (…) maintenant, commencent à s’habiller, hommes et femmes, mais peu le font honnêtement et seulement quand on le leur demande ». Et il ajoute : « Les femmes aiment beaucoup les rubans et les peignes » (p. 34-35). Des éléments apportés dans le cadre de l’interaction avec les Européens, une relation inégale en pouvoir et en objectifs – celui des Jésuites était clairement l’évangélisation -, mais existante.
Le récit aborde les mariages, les relations polygames qui pouvaient très librement être défaites, l’usage du tabac (« coutume de boire de la fumée »), la naissance des bébés (la responsabilité de couper le cordon revient au père et il doit jeuner jusqu’à ce qu’il tombe), l’allaitement, l’hospitalité suivie d’une « étrange » coutume, celle de pleurer auprès des invités pour remémorer les ancêtres tués à la guerre. Le texte aborde encore les fêtes et les danses, les enterrements, leur manière de se rendre beaux, les décors faits en plumes et les outils… Plusieurs de ces moments sont illustrés par l’iconographie produite par les voyageurs.
Fernão Cardim consacre une bonne partie de son témoignage au rituel anthropophage. Selon lui, « de tous les honneurs et plaisirs de la vie, rien n’est plus grand pour ce Gentil que de tuer et de garder le souvenir du nom de ceux qu’il élimine » (p. 48). Le récit de Cardim est une des sources principales de l’anthropologie sur le sujet. Il décrit l’arrivée du prisonnier, comment on l’alimente et comment on le rend beau « de la même manière que les Espagnoles portent leurs plus belles robes » (p. 47), une analogie proposée par Cardim. Il décrit le rituel du combat final et de l’acte du repas en question. L’anthropophagie impressionne d’ailleurs un bon nombre de voyageurs de l’époque, et l’ouvrage nous fournit plusieurs images de Théodore De Bry ou de Hans Staden sur le sujet.
Un autre aspect privilégié dans le récit de Cardim est la « diversité des nations et des langues » (p. 58). Il présente ainsi 76 groupes d’indigènes Tapuyas qui vivent dans l’intérieur du pays (le sertão, dans le texte). Si les tupi-guarani sont les peuples les plus « civilisés » ou surtout « civilisables » au regard des Portugais, voire des Européens de manière générale, les Tapuyas l’intriguent également. En fait, sur les dix nations qui s’expriment en tupi, la communication avec les Portugais est plus facile, « elles sont plus dociles que les autres ; elles sont les plus anciennes alliées des Portugais » (p. 59). Sur la branche tupi, Cardim nous fournit un témoignage assez généreux et difficile à lire de nos jours sans ressentir un grand regret sur la presque disparition d’une culture aussi riche :
« une seule langue prédomine parmi dix nations d’Indiens établis sur le littoral et dans l’arrière-pays, et même si certains mots sont différents d’un groupe à un autre, elle est comprise des Portugais car c’est une langue facile, élégante, riche, même si la difficulté tient au fait qu’elle contient beaucoup d’expressions » (p. 59).
Sur les Tapuyas, il note :
« ces soixante-seize nations tapuya parlent différentes langues et sont très courageuses, sauvages et indomptables et presque toutes sont ennemis des Gentils qui habitent sur la côte, voisins des Portugais. Seul un groupe de Tapuya, près du fleuve São Francisco, est ami des Portugais » (p. 69).
Et un peu plus loin, on comprend mieux les méthodes des Jésuites envers les Indiens, ainsi que le rôle de la langue, de la traduction et des écrits, dans leur but colonisateur et évangélisateur. Les nouvelles générations ont ainsi un rôle important à jouer selon Cardim, les enfants servent de traducteurs et de véritables passeurs de cultures :
« Certains parmi eux ont commencé à embrasser la foi chrétienne grâce à l’action de prêtres venus dans le sertão. Ils ont appris la langue de ceux qui vivent sur la côte et certains qui habitent dans les aldeias sont baptisés et même mariés. Les prêtres servent d’interprètes et c’est seulement avec ce groupe de Tapuya qu’ils peuvent entreprendre leur action évangélique ; il n’est pas possible de convertir les autres nations car elles sont nomades et parlent plusieurs langues très difficiles à comprendre. Mais il existe une solution, si Dieu notre Seigneur n’en découvre pas une autre : en ayant sous la main les enfants, ils leur apprennent la langue de ceux qui vivent sur la côte et ces enfants servent d’interprète malgré toutes les difficultés. » (p. 70).
Ainsi, ce riche témoignage représente à la fois le récit de l’existence et l’attestation d’une population en cours de disparition. Cette disparition ne semble pas être regrettée par Fernão Cardim dans son récit.
Silvia Capanema – IdeAs, Idées d’Amérique – 2020