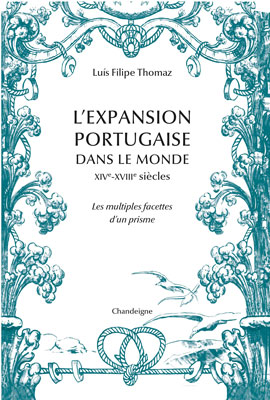Partir, en portugais
Dans un livre paru en 2017 en Colombie et traduit ensuite en français, l’historien Luís Filipe Thomaz explore la complexité de l’histoire coloniale portugaise, remet en doute la stabilité de l’Empire et définit ses spécificités. Un essai majeur qui associe quatre continents, et propose une manière de faire de l’histoire « à tâtons ».
Comment expliquer qu’un royaume maladroit, peu structuré, peu peuplé et sans tradition colonialiste, intimidé par l’Atlantique d’un côté et par la Castille – qu’il tente d’imiter à bien des reprises – de l’autre, presque une île à la dérive, devienne un empire aussi divers et vaste, « à l’échelle de trois océans et de trois continents » ? Comment ne pas tomber dans des raccourcis qui rendraient cette histoire facilement intelligible, dans des récits nationalistes insistant sur la gloire militaire des Portugais (ou dans des contre-récits de résistance, ce qui revient à confirmer par la négative ces mêmes récits) ? Qui sont les protagonistes peu héroïques et peu spectaculaires (même si cela dépend d’où l’on parle), violents par ailleurs, les casados à Goa et à Cochin, les bandeirantes à São Paulo et encore les jésuites, qui ont construit cette histoire ? Le chemin que prend Luís Filipe Thomaz – sans l’expliciter – est original : un lien semble exister entre cette précarité structurelle, selon lui inscrite dans l’histoire du Portugal (et qui s’opposerait à l’organisation et à la constance de l’empire espagnol), et la force de sa diffusion dans le monde.
Dès la première page, il est ainsi question de séparer l’empire et le peuple portugais de leurs pendants espagnols, dans lesquels les discours tendent souvent à diluer les premiers. Rien de cette indifférenciation ici, et l’un des intérêts de l’ouvrage tient à ce que Thomaz n’emprunte pas le chemin attendu, celui de la fascination portugaise pour des délires messianiques et apocalyptiques incarnés aussi bien dans la figure du roi Sebastião que dans les sermons de Vieira et dans la politique impérialiste de Manuel Ier ; ou encore dans le goût féodal pour la croisade, cristallisé par le chef-d’œuvre de la littérature portugaise, Les Lusiades. La comparaison fréquente avec l’Espagne permet à Thomaz de cerner d’autres spécificités portugaises, plus discrètes et parfois négligées par les récits officiels : le penchant pour la désorganisation, l’aptitude à la multiplicité, la disposition aux projets ratés ou abandonnés, à l’inachèvement, et le désir parfois inavoué de partir.
Ces traits ne constituent pas pour Thomaz une essence mais découlent de l’histoire même : nous découvrons ainsi une façon de coloniser à l’espagnole, solide et terrestre, qui vise la domination massive et totale du territoire. Et, à côté, la manière portugaise : maritime, irrégulière, proliférante et sans but précis ; selon les mots du chroniqueur du Brésil Frei Vicente do Salvador, « préférant en arpenter seulement les côtes, tels des crabes ». Ainsi lisons-nous aussi la forme des villes coloniales espagnoles, orthogonales et centralisées autour d’une Plaza Mayor ; et celle des villes portugaises, plus éparpillées, anarchiques et labyrinthiques, « qui s’étirent en demi-lune suivant le contour d’une baie ». Ainsi que les tentatives ratées de conquérir les Canaries vers 1424 et 1425, le Maroc en 1437, le Sénégal en 1444, et la préférence pour des espaces moins peuplés (pour des raisons pratiques, donc) comme Madère et les îles du Cap-Vert.
L’argument se repère assez vite et annonce ce qui va devenir le sujet même du livre : l’histoire de diasporas plus ou moins spontanées et imprévisibles, dont les conséquences résultent souvent d’erreurs, de hasards et de malentendus. Un exemple assez drôle est l’arrivée de Vasco de Gama en Inde : « Gama prit des brahmanes pour des prêtres catholiques, pria dans les temples hindous qu’il crut être des églises et vénéra l’effigie de Kali en pensant qu’il s’agissait de la Vierge Marie ; après quoi il rentra au Portugal avec la nouvelle que l’Inde était majoritairement peuplée de chrétiens. » Un malentendu qui permit le soutien nécessaire du Conseil pour l’envoi d’une deuxième expédition en Inde en 1500. Ce qui conduit à un autre malentendu : cette expédition, commandée par Pedro Álvares Cabral, allait arriver d’abord non en Inde mais au Brésil… L’erreur d’appréciation s’aggrave : dès que Cabral, en compagnie d’un groupe de franciscains, arrive en Inde, « leur objectif n’était pas de convertir des païens au christianisme, puisqu’on pensait encore que les Indiens étaient chrétiens, mais de ramener à l’orthodoxie ces Nazaréens déchus, qui vénéraient des saints aux bras multiples, dotés de têtes d’animaux et de défenses de sanglier ! ». L’arrivée des Portugais au Brésil et en Inde s’accompagne ainsi d’un problème de communication considérable. La masse des détails, présentés de façon aérée, autour d’une histoire se déroulant sur un grand espace, nous offre un livre informé et agréable, et un argument difficile à contredire. En revanche, on aurait envie de poser une question à Thomaz : ce qu’il considère comme une spécificité portugaise, à savoir le penchant pour l’erreur, le malentendu, le ratage et la déstructuration, ne serait-ce pas une qualité humaine et, encore plus, l’avenir de toute entreprise humaine ?
Ensuite, l’histoire ne se réduit pas à ce qu’on connaît déjà de Gama et de Cabral. L’« expansion » serait autant l’œuvre du pouvoir institutionnalisé que d’individus plus ou moins déshérités : des marchands et des négociants qui n’ont rien à perdre, des femmes de l’orphelinat du roi, des voyageurs sans attaches familiales – souvent des initiatives individuelles ou faiblement collectives. Au détour de deux lignes, Thomaz évoque l’institution des casados (« mariés »), c’est-à-dire de soldats cherchant à épouser une femme indienne à Goa ou à Cochin, et à y commencer une nouvelle vie (je reviendrai sur la neutralité avec laquelle Thomaz traite de la violence de l’histoire). L’auteur inclut aussi dans cette liste les jésuites, même si les réduire à des « individus déshérités » est contestable. La spécificité du phénomène jésuitique, à savoir l’adaptabilité et l’ouverture des prêtres de la Compagnie de Jésus aux cultures hindoues et amérindiennes, s’inscrit dans un projet rigide d’évangélisation, patronné par la cour métropolitaine (notamment João III, comme le rappelle Thomaz). Vieira ne compte certainement pas, comme l’écrit Thomaz, parmi « les plus déshérités de ce pays », tant ce qui concerne ses ressources économiques que ses ressources intellectuelles ; c’est sa position ambivalente dans la pyramide du pouvoir qui surprend dans son projet.
Le parcours s’achève avec « le fils bâtard de l’empire », « le Nouveau Monde », « le fruit principal et sans pareil de l’expansion portugaise » : le Brésil. La nouveauté vient ici de la comparaison marquée entre le Brésil, l’Afrique et l’Inde. On découvre l’immense manque d’intérêt initial de la cour portugaise pour le Brésil, dans le cercle de Manuel Ier et parmi les marchands de Lisbonne, pour qui l’Inde restait un paysage plus attirant et plus riche. On découvre qu’il n’y pas eu de volonté d’inventer un nouveau système d’exploitation, et que le modèle du paiement du quint à la Couronne était exactement le même que celui utilisé auparavant en Guinée. De la même façon, le modèle des capitaineries héréditaires, un vestige féodal, avait déjà été adopté dans les îles du Cap-Vert, de São Tomé, de Madère et des Açores. On apprend aussi que l’importante chronique du Brésil de Frei Vicente do Salvador, écrite en 1627, est restée manuscrite jusqu’en 1889. Il fallut donc attendre certaines circonstances pour que l’indifférence disparût : la découverte du bois-brésil, la compétition avec d’autres envahisseurs (notamment français), le succès de l’économie sucrière et la découverte des mines d’or à la fin du XVIIe siècle, qui déplace le peuplement vers l’arrière-pays. Le Brésil voit dès lors l’arrivée de marchands attirés par les avantages économiques, de nouveaux chrétiens à la recherche de liberté religieuse, d’esclaves arrachés à l’Afrique de l’Ouest, les lançados, des entradas dans le Nordeste et des bandeirantes au Sud. À l’horizon, ce sera la cour elle-même, comme on le sait, au début du XIXe siècle, qui s’installera à Rio pour fuir les troupes napoléoniennes. Les multiples facettes d’un prisme reflète donc la tentative, moins de donner une cohérence à un phénomène historique, que d’esquisser sa complexité.
Le résultat est un livre érudit et multiple, au carrefour de l’histoire politique mondiale, de l’histoire économique, de l’histoire naturelle et de l’histoire de ceux qui ne sont souvent pas retenus par l’histoire. On peut être intrigué par la neutralité de certains passages et de certains mots (comme « encadrement de la population native » ou « importation » quand il est question d’un esclavagisme massif ; ou « expansion » pour un génocide) : un ton distancié efface-t-il la violence de l’histoire ou au contraire, plus subversivement, la renforce-t-il ? On peut s’étonner également de l’absence de la parole de ces déshérités, qu’on aurait souhaité entendre davantage. S’en trouverait amplifié le sens du mot partir (qui comporte, selon Thomaz, une « manière portugaise d’être dans le monde »), verbe dont il est dommage de réduire l’usage à des circonstances économiques alors qu’il s’agit aussi d’un besoin humain. On aurait encore voulu déplacer un peu le point de vue, ou plutôt l’élargir : si les bandeirantes peuvent être vus comme des déshérités négligés par l’histoire portugaise officielle, ils constituent pourtant le mythe fondateur, voire institutionnel, de São Paulo, un monument imposant face au Parc Ibirapuera leur étant dédié : un nationalisme déplacé dès lors qu’on se souvient, comme Thomaz, que la motivation majeure des bandeiras était la chasse aux Indiens. Il est impossible d’étudier l’histoire du Brésil sans passer par eux et ils sont loin d’avoir été négligés par l’histoire, surtout si l’on compare leur histoire avec celle d’autres indifférences.
Enfin, en ce qui concerne la mise en récit du savoir, on est moins convaincu par l’effet totalisant de « la brillante synthèse » annoncée sur la quatrième de couverture que par une écriture elle-même proliférante, qui avance, pour utiliser à nouveau la métaphore de Frei Vicente do Salvador, « telle des crabes ». C’est la grande qualité stylistique du livre de Thomaz : à plusieurs reprises, l’historien émet des hypothèses qu’il ne développe pas (abondent les « quoi qu’il en soit », les « en tout cas ») ; il laisse des détails de côté (sur, par exemple, les expéditions commerciales au Maroc, de la part d’Afonso V, au long du XVe siècle ; sur la liste des privilèges accordés par Duarte Ier à la noblesse pendant son règne, de 1433 à 1438 ; ou sur l’occupation initiée par Paulo Dias de Novais en Angola à partir de 1581) ; et il expose des lacunes et des incertitudes : qu’envisageait exactement l’infant dom Pedro à Ceuta vers 1426 ? Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’expéditions au cap de Bonne-Espérance jusqu’à la fin du règne de João II en 1495, alors que Bartolomeu Dias en avait déjà réalisé en 1487 et 1488 ? Sur quoi reposait le soupçon de João II s’agissant de l’existence de terres dans l’Atlantique ?
L’expansion portugaise dans le monde ouvre ainsi deux voies intéressantes. La première, politique, est de dissoudre par l’écriture une solidité impériale qu’on pouvait attribuer au Portugal et qu’on retrouve encore dans les livres d’histoire de ses anciennes colonies, en Afrique ou au Brésil. Par la fragilisation et la déstabilisation d’une ancienne autorité, le livre présente des récits subtils où sont reconnues l’imprévisibilité de l’histoire et une forme de bêtise de la part de tous ses agents. « La cour portugaise », comme le dit Thomaz à propos de la prise de Ceuta en août 1415, « ne semblait pas avoir de plan défini et cohérent. » Qu’on doive ou non pardonner certaines bêtises, ce serait une question à poser. La deuxième voie passe par une perception constructive, voire tendre, de la précarité ; car le récit et la thèse de l’auteur s’accordent à l’art qui soutient son propos : le projet d’une écriture de l’histoire « à tâtons », à la manière des crabes ou, pour ainsi dire, en portugais, au sens fort que Thomaz donne à cette expression.
Luciano Brito – En attendant Nadeau – Octobre 2019
Vous pouvez également consulter cet article directement via le site d’En attendant Nadeau en cliquant ici !
Le petit livre que publie les éditions Chandeigne, Maison spécialisée depuis plus de 25 ans sur le monde lusophone, sa culture et son histoire, a vocation à devenir une référence dans le champ historiographique de l’histoire mondiale, en particulier des empires européens de l’époque moderne. Issu d’un ouvrage publié en espagnol (Colombie) en 2017, remanié et augmentée dans sa version française, il est l’œuvre de l’historien portugais Luís Filipe Thomaz, dont le parcours de recherche et d’enseignement depuis un demi-siècle, la maîtrise de plus d’une douzaine de langues européennes et asiatiques, rappellent que faire de l’histoire mondiale suppose un bagage culturel et linguistique orienté vers plusieurs horizons. Il est de fait la première synthèse en français de la longue et complexe histoire de l’expansion portugaise à l’échelle mondiale, de Ceuta à Timor (pour reprendre le titre de son maître-livre écrit en portugais en 19941), de Bahia à Goa, des Açores à Monomotapa, de Benguela à Canton.
Une synthèse mondiale sur la longue durée
Ce qui distingue en effet l’empire portugais des temps modernes de l’empire espagnol, pourtant plus connu car mieux étudié en France, est en effet sa dispersion sur trois océans (Atlantique, Indien et Pacifique) et sur trois continents (Amérique, Afrique, Asie), et par conséquent son caractère plus maritime et commercial que ne le fut l’Amérique espagnole, même augmentée des Philippines. Par ailleurs, la construction de cet empire s’échelonne sur plusieurs siècles, au moins du XIVe au XVIIIe siècle, tandis que l’invention américaine par Colomb au service des souverains espagnols est le fait d’un pari géographique raté. C’est sur ces deux constats comparatifs que débute l’ouvrage dans une première partie sobrement intitulée « Les origines » (pages 9 à 43), qui s’attarde avec précision et clairvoyance sur la dynamique médiévale de l’expansion lusitanienne, dans la foulée de la Reconquista achevée en 1249 pour le Portugal, laquelle se poursuit encore deux siècles et demi chez le voisin et rival castillan, contre le royaume de Grenade. Car l’importance des démêlées avec la Castille aux XIVe et XVe siècles sont l’un des aspects les plus surprenants de cette dynamique : pour le petit Portugal, plutôt pauvre en ressources naturelles, l’obstacle castillan ne laisse pas d’autres échappatoires de développement et d’enrichissement que de se tourner vers le Maroc et l’Atlantique. C’est ce qui explique la convergence d’intérêt entre les trois grands acteurs de l’expansion dans sa phase initiale, à savoir l’État, la noblesse et la bourgeoise marchande, les uns plus préoccupés par l’esprit de croisade à l’encontre de l’Islam proche (Maroc), les autres plus stimulés par l’esprit de lucre, un temps comblé par l’exploitation d’îles comme Madère et les Açores.
La « découverte » de l’Afrique
Nous voici déjà introduit dans le 2e chapitre de l’ouvrage intitulé, « la « découverte » de l’Afrique » (pages 47 à 109), qui voit le début de cette expansion séculaire débutée par la prise de Ceuta en 1415 et nous conduit à la lente descente des navigateurs portugais jusqu’au cap de Bonne Espérance à la fin de ce XVe siècle. Par delà la chronologie fine de cette avancée, il faut remarquer qu’elle est ponctuée de péripéties politiques avec la Castille, d’échecs et de passivité au Maroc, de blocages psychologiques et nautiques pour le passage du cap Bojador en 1434, d’avancées dans l’exploitation et la colonisation des îles atlantiques (Madère avec ses vignes et son sucre ; les Açores, grenier à blé du Portugal ; le Cap Vert, escale sur la route du retour et centre de négoce des esclaves). En effet, les esclaves de la côte du sud du Sahara sont les premières marchandises africaines à se vendre sur le marché lisboète au milieu du XVe siècle, avant que le trafic ne s’étoffe dans les décennies suivantes et surtout dans les siècles postérieurs. L’or est l’autre ressource recherchée sur les cotes d’Afrique occidentale, et c’est le comptoir de Mina qui permet de se le procurer en quantité croissante dans le second XVe siècle.
Mais derrière cette dynamique globale d’expansion africaine, dont il ne faut jamais oublier qu’elle se déroule sur presque un siècle, l’auteur montre que se cachent en fait des intérêts variés et des groupes d’influence multiples. La monarchie portugaise est le fer de lance à la fois de la conquête marocaine, ce qui lui permet de combler les attentes d’une noblesse en mal de croisade, et de l’avancée atlantique dont le prince dom Henrique est en partie chargée d’assurer la réussite. Car le « parti libéral » à la cour de Lisbonne veille à ce que l’esprit de croisade ne prenne le pas sur l’esprit capitaliste, dont les intérêts sont défendus par la bourgeoisie portugaise, mais aussi par les investisseurs florentins. Au fur et à mesure que le projet de contournement de l’Afrique se met en place, surtout dans les années 1480, ces derniers tentent d’influer auprès du roi Jean II afin d’arriver en Inde et d’ainsi pouvoir concurrencer leur rivaux vénitiens dans la captation des épices asiatiques.
« L’aventure des Indes »
En toute logique, le 3e chapitre s’intéresse à « l’aventure des Indes » (page 113 à 193), consacré essentiellement au XVIe siècle, suite au voyage de Vasco de Gama, même si des prolongements chronologiques expliquent la substitution de la domination hollandaise et anglaise à partir du milieu du XVIIe siècle sur de nombreux territoires de l’Estado da India et si des tendances plus longues sont apportées jusqu’aux XIXe et XXe siècles comme pour Macao ou Timor. Il n’est pas question de retracer les étapes de cette présence portugaise dans l’Océan Indien, de l’Afrique de l’est à la Mer Rouge, des côtes de Malabar à Malacca, du Pegu aux Moluques, de Macao à Nagasaki : nous laissons aux lecteurs le plaisir de naviguer dans les caravelles, de troquer dans un comptoir commercial, de guerroyer pour la prise d’une place militaire stratégique, mais aussi de divaguer sur la Praça da Sé de Goa ou d’assister à l’autodafé d’une nouveau-chrétien condamné par l’Inquisition.
Signalons quelques thèmes pas forcément connus du grand public : l’épisode Vasco de Gama et les expéditions qui suivent sont clairement le fait de la monarchie sous Manuel 1er, un souverain dont le projet impérialiste et messianique se développe d’abord contre l’islam, aussi bien au Maroc que dans l’Océan Indien. La passionnante figure du vice-roi Afonso de Albuquerque que le shâh de Perse appelait le lion des mers, reste peu connue en France2, alors que son court gouvernorat (1509-1515) est marqué par la mise en place d’un commerce à grande échelle dans l’Océan Indien appuyé sur plusieurs places fortes, pivots de la présence européenne dans la région. L’auteur dévoile aussi comment, au-delà de l’Inde, ce sont ensuite des marchands privés et des aventuriers qui assurent la progression de ce commerce par des contacts avec de nombreuses civilisations orientales, mais aussi en Afrique de l’est dans le royaume de Monomotapa. Cette présence portugaise donna naissance dans cet outre-mer à une société métisse, par mariage ou concubinage avec des femmes « indigènes », mais ces communautés de casados, métis et convertis entraient fréquemment en conflit avec les Portugais venus du royaume (les réinois), dont les intérêts économiques pouvaient être concurrents.
Les navires portugais apportent aussi des hommes d’Église : des évêques, des prêtres et des frères des ordres mendiants qui se chargent d’encadrer les populations chrétiennes de Goa et d’ailleurs, afin de faire régner un ordre moral catholique loin de Rome ; ce sont aussi des missionnaires jésuites, qui entrent en contact avec les populations asiatiques afin de tenter de les convertir, rarement dans les territoires musulmans, mais plutôt dans les terres hindouistes ou bouddhistes jusque dans la Chine des Ming ou le Japon, avec un succès plutôt mitigé. Il reste que les témoignages de ces aventuriers de Dieu sur ces peuples et les dictionnaires bilingues apportent à l’Europe une connaissance beaucoup plus sérieuse de ces régions du monde, et remplacent avantageusement le Devisement du monde de Marco Polo.
Je laisse aux lecteurs le soin découvrir les causes de l’affaiblissement de l’Estado da India au début du XVIIe siècle, à l’origine de sa disparition, pour mieux me concentrer sur le dernier chapitre de cette somme, consacrée au « Nouveau Monde » et aux liens atlantiques entre le Brésil et l’Afrique (pages 197 à 270).
« Le Nouveau monde »
L’étude du Brésil portugais, de sa « découverte » en 1500 (ou quelques années avant) jusqu’à l’accession à l’indépendance en 1822, est un sujet plus classique, mais nourri d’une longue et ample historiographie brésilienne et internationale. C’est dire l’exploit de l’auteur que de résumer en à peine plus de 70 pages les grandes lignes de cette histoire de plus de trois siècles, qui s’étend sur un territoire toujours plus vaste, car en expansion permanente et en construction, et qui s’intègre dans un espace sud-Atlantique à travers la traite négrière depuis les côtes d’Afrique occidentale.
Le Brésil est d’abord et pour la plus grande partie du XVIe siècle le fils « bâtard » de l’Empire portugais. Sa découverte n’est qu’une conséquence collatérale de la mise en place de la route de l’Inde et longtemps il pâtit du manque de richesses à capter dans ce vaste espace difficile à pénétrer, du fait d’une présence amérindienne plus ou moins hostile. Longtemps le bois de teinture rouge, le pau brasil, ne fait pas le poids face aux épices et autres produits de luxe venus d’Orient, ni même face à l’or du Golfe de Guinée ou du Monomotapa. La Couronne peut donc confier ces terres, ou plutôt le littoral entre São Vicente au sud et Pernambouc au Nordeste, à l’appropriation privée par des capitaines donataires, tandis que le commerce illégal des Français se poursuit sans guère d’entrave. C’est le passage progressif à une économie sucrière, à partir de l’expérience des îles de Madère et São Tomé, qui va susciter l’intérêt du pouvoir royal à partir du milieu du XVIe siècle, accentuer le contrôle du territoire notamment au dépens des Français dans la baie de Guanabara (Rio), accroître la mise au travail des populations indiennes, très vite remplacées par une main d’œuvre servile venue d’abord de Sao Tomé, puis de plus en plus massivement du continent africain. C’est l’occasion pour l’auteur de s’attarder sur « le corollaire africain » du Brésil (p. 231 à 248), à savoir sur l’histoire des royaumes de l’Ouest, celui du Kongo très vite rattaché aux intérêts du Portugal à travers le trafic négrier et la christianisation, puis celui du futur Angola aux XVIe et XVIIe siècles, en montrant les difficultés de la pénétration portugaise face à la résistance de la reine Njinga, soutenue par la puissance hollandaise. La présence des Provinces-Unies à Luanda et au Pernambouc au milieu du XVIIe siècle démontre la cohérence de cet espace sud atlantique et la nécessité de relier les deux bords de cet océan pour saisir les logiques océaniques de l’expansion portugaise.
Pour revenir au Brésil, c’est à partir de la seconde moitié du XVIe siècle que les cadres structurants de l’histoire de cette colonie se mettent en place : d’une part, l’exploitation sucrière avec les moulins dans la bande littorale, fondée sur l’esclavage d’Africains déportés en droiture en nombre croissant pour y travailler ; d’autre part, le métissage entre des Portugais venus du royaume ou des îles atlantiques, qu’ils soient nobles, aventuriers ou nouveaux-chrétiens, et des femmes issues des populations amérindiennes majoritaires (entre 1 et 5 millions) ou des esclaves noires domestiques ; enfin, la création de structures religieuses et l’arrivée des ordres religieux, à commencer par les Jésuites, qui se lancent dans l’évangélisation des Indiens, avec la création de communautés vivant à l’écart de la société coloniale à l’intérieur des terres (sertao).
La confusion des empires en 1581, à savoir la réunion des deux couronnes espagnole et portugaise sur la tête des Habsbourg, ne change pas la dynamique d’expansion au Brésil. Elle permet la poursuite de ce que l’auteur appelle « la tripartition de modalités d’expansion » (p. 251), celle qui a prévalu en Orient et en Afrique. Elle inclut d’une part la colonisation officielle menée par l’État, à partir du relais constitué par la capitale Salvador da Bahia, afin de favoriser le peuplement de cet espace immense, de plus en plus représenté comme une île, à mesure que les cartes intègrent le cours des deux bassins fluviaux de l’Amazone au nord et du Paraná au Sud… reconnus grâce à la pénétration de l’arrière-pays par des aventuriers. Cette dynamique privée et plus individualiste constitue le second versant de l’expansion portugaise, au Brésil comme ailleurs : elle prend notamment la forme au XVIIe siècle des bandeiras, ces expéditions lancées depuis la région pauvre de São Paulo afin de conquérir des richesses qui, à défaut d’être de l’or (il faut attendre le XVIIIe siècle pour découvrir le métal précieux dans la région du Minas), sont les Indiens des Réductions jésuites, capturés et revendus dans les exploitations littorales. Avec les Jésuites, nous retrouvons le troisième grand acteur de l’expansion coloniale, celle des missionnaires, plus axée sur la conquête des âmes que la captation des richesses naturelles ou de la force de travail, mais dont il faut rappeler qu’elle est en grande partie contrôlée par la papauté, et qu’elle tisse un réseau d’influence mondiale, véritable firme transnationale avant l’heure. Ces trois grands acteurs de l’expansion continuent leur œuvre dans le Brésil du XVIIIe siècle, qui révèle d’ailleurs avec force la puissance des conflits entre ces dynamiques de colonisation, que ce soit l’interdiction des Jésuites dans tout l’Empire portugais sous le ministre Pombal (1760) ou les velléités d’indépendance dévoilées par l’Inconfidence minière de 1789.
Un ouvrage de référence sur l’expansion portugaise
Ce compte-rendu, déjà trop détaillé, ne rend pourtant pas compte de toute la richesse de l’ouvrage de Luís Filipe Thomaz, de la somme d’érudition accumulée sur un demi-siècle nécessaire pour maîtriser cette matière foisonnante, de la mise en exergue des grandes tendances de cette histoire séculaire, de la subtilité de l’argumentation qui n’en reste pas moins toujours accessible et qui nous font comprendre le sens du sous-titre, a priori quelques peu abscons, « les multiples facettes d’un prisme ».
Pourtant, il nous faut faire quelques remarques critiques, certaines encore positives. Ainsi, le travail de traduction mené par Michel Chandeigne (alias Xavier de Castro) et Émile Viteau s’avère impeccable. Il est réjouissant et fort utile de trouver à point nommé des encarts, sous la forme de chronologie, d’images (mais pourquoi montrer une illustration du XIXe siècle d’un moulin à sucre au Brésil, alors que des peintres hollandais en ont représentés au milieu du XVIIe siècle ?) et surtout de cartes, qui permettent d’éclairer le propos, car c’est à un voyage transcontinental et transocéanique que le lecteur est convié et il lui faut une bonne boussole pour s’orienter et se situer dans l’immense empire portugais. Le choix de ne pas mettre de notes de bas de pages (ou même en fin d’ouvrage) rend incontestablement la lecture plus fluide et le lecteur curieux ou averti pourra aisément se reporter au site des éditions Chandeigne pour trouver une impressionnante bibliographie de 37 pages, outre celle de l’auteur de 15 pages ! (https://editionschandeigne.fr/livre/lexpansion-maritime-portugaise-du-bresil-macao/)
On peut s’étonner de l’organisation de la bibliographie restreinte figurant à la fin de l’ouvrage, non pas d’avoir opté pour une séparation des ouvrages en français d’avec ceux en langue étrangère essentiellement en portugais, mais de ne pas distinguer entre les sources primaires et études historiques sur le sujet. La présence d’index des lieux, voire des noms, aurait rendu la consultation du livre plus rapide et efficace dès lors que l’on recherche une information précise, car la table des matières n’est pas très étoffée à l’intérieur de chaque chapitre ; de même les non-lusophones auraient apprécié la présence d’un glossaire des mots portugais légitimement gardés dans la traduction car difficilement remplaçables en français. Quant à la conclusion (sûrement trop courte, une page), il était légitime d’en attendre un peu plus pour achever un tel périple. On notera par ailleurs une confusion de date au début du 3e paragraphe de la page 209 où il faut remplacer 1550 par 1530 et un mot glissé par erreur (« un plusieurs ») à la 5e ligne de la page 229. Mais ce ne sont que péchés véniels eu égard à l’ampleur du sujet traité ramassé dans un texte concis et précis à la fois.
Un point de départ incontournable pour d’autres pérégrinations
Quant à ceux qui voudraient élargir la vision de l’expansion portugaise outre-mer, ils peuvent s’adonner à la lecture des sources narratives de cette histoire, dont beaucoup ont été publiées brillamment par la Maison Chandeigne, et pour lesquelles l’ouvrage de Luís Filipe Thomaz constituera désormais la base de référence pour intégrer ces sources dans un continuum impérial et ainsi mieux saisir leur spécificité ou leur exemplarité. Ceux qui voudraient plutôt obtenir une approche thématique du même sujet se reporteront au volume collectif publié en anglais, Portuguese Oceanic expansion, 1400-1800, sous la direction de Francisco Bethencourt et Diogo Ramada Curto (Cambridge Press, 2007) ou à sa traduction portugaise (A expansão marítima portuguesa, 1400-1800, edições 70, 2010). Enfin, un prolongement naturel selon une approche comparatiste peut être trouvée dans L’Empire portugais face aux autres Empires, XVIe-XIXe siècles, (dir.) Francisco Bethencourt et Luiz Felipe de Alencastro, Paris, Maisonneuve et Larose- Centre Calouste Gulbenkian, 2004.
Quoi qu’il en soit, le petit livre de Luís Filipe Thomaz est une grande synthèse sur un sujet dont l’historiographie récente démontre l’importance, non seulement pour saisir les ressorts de la création de l’identité nationale portugaise depuis le XIXe siècle, mais pour pleinement appréhender les logiques d’une histoire mondiale de l’époque moderne dont l’expansion portugaise a constitué un volet incontournable, bien au-delà du voyage de Vasco de Gama. Car, comme le rappelle F. Bethencourt dans l’introduction au dernier volume collectif susmentionné « contrairement à la vision traditionnelle de l’historiographie mondiale, qui met en valeur la période initiale de l’expansion portugaise, c’est justement la capacité d’enracinement, de reproduction, de transfert et de réorganisation de l’empire qui rend l’étude de ce cas intéressante » (p. 9).
Malheureusement, sauf changement de dernière minute, les concepteurs des nouveaux programmes de lycée n’ont en rien intégré cette longue saga de l’expansion portugaise dans le programme de Seconde, et se sont contentés d’un rabougrissement des perspectives limitées à la seule colonisation de l’Amérique. Pourtant, la lecture de cet ouvrage est à conseiller fortement à tous les enseignants de secondaire, auxquels je ne peux que suggérer la « désobéissance pédagogique » en osant une approche comparatiste des deux expansions ibériques, l’espagnole et la portugaise, non seulement dans les Amériques mais à une échelle globale.
Laurent Guitton – La cliothèque – Janvier 2019