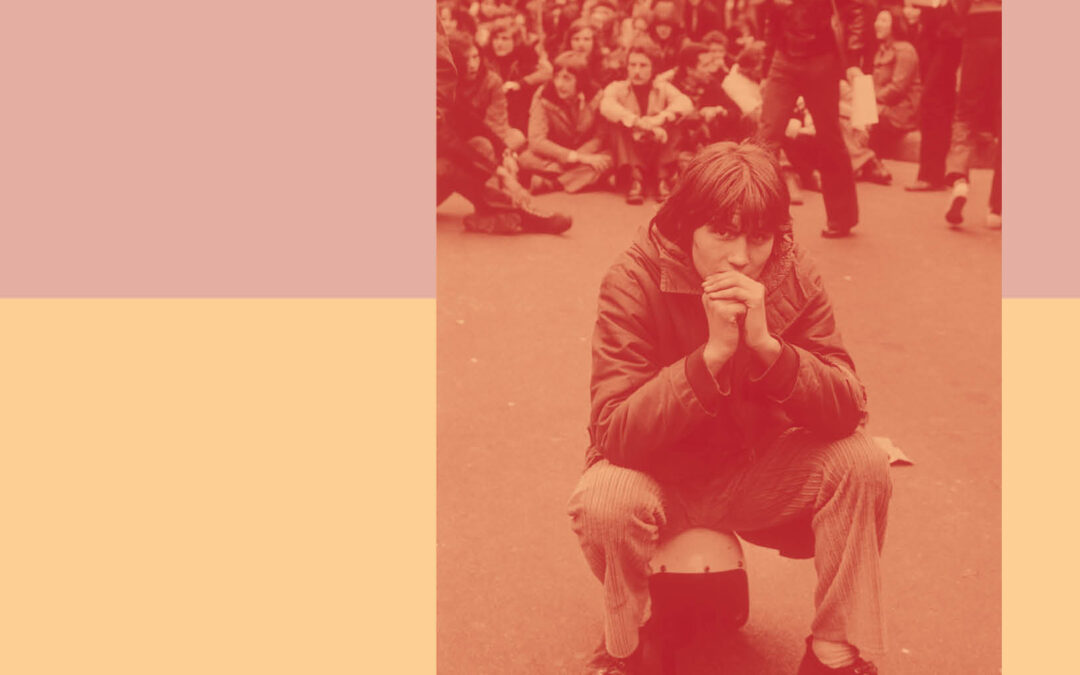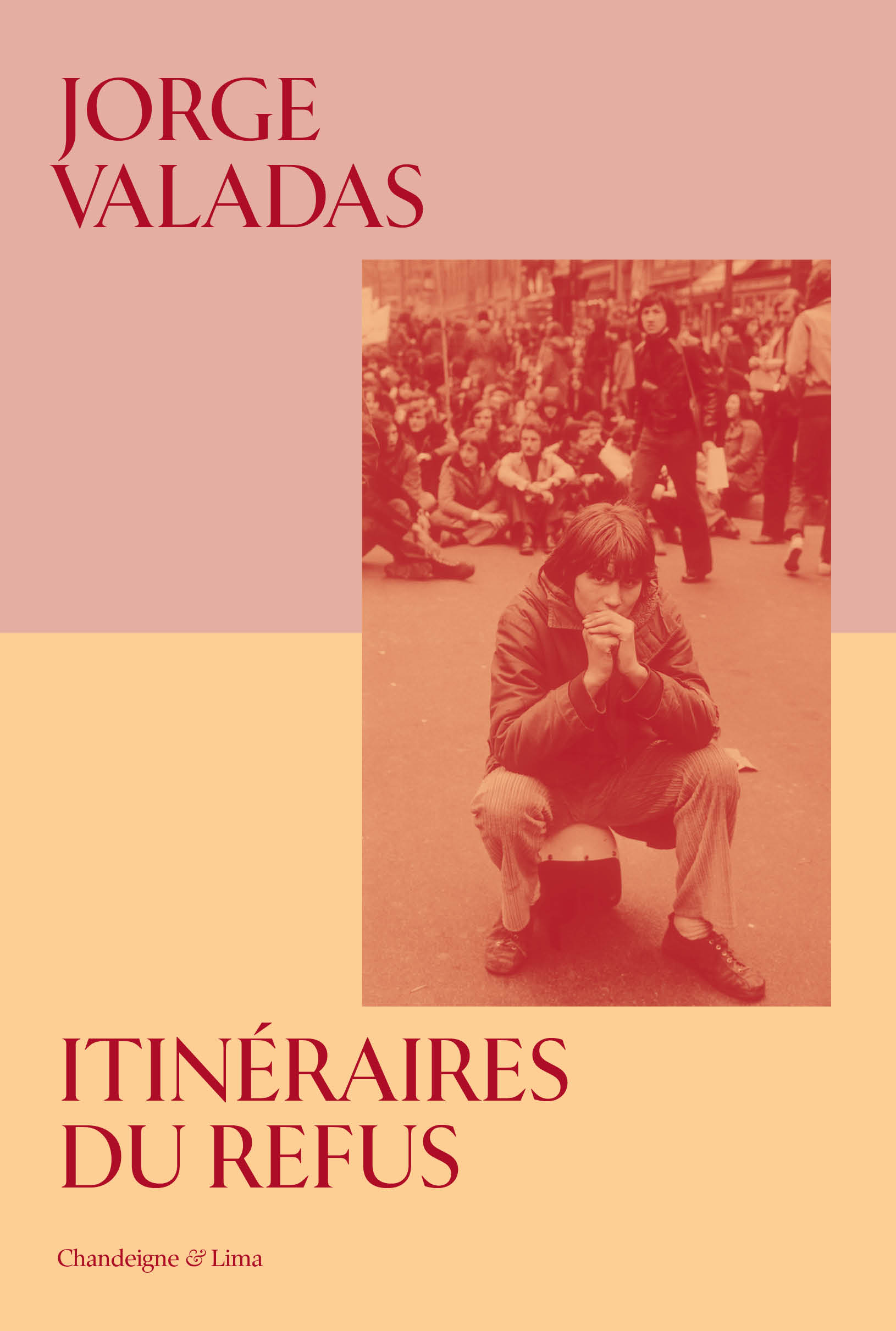
- Radio Libertaire – Chroniques rebelles
- Radio Alfa – Tempestades 2.1
- Radio Alfa - Passage à niveau
- Addict Culture
- RFI – Português
- Lundi Matin
- À contretemps
- CQFD
- Revue Ballast
- L'Anticapitaliste
- La feuille de Quilombo n° 9
- MAPA – jornal de informação crítica
- Revue Ballast – entretien
Interview de Jorge Valadas avec Christiane Passevant, dans l’émission « Chroniques rebelles » du 26 avril chez Radio Libertaire.
Interview de Jorge Valadas, auteur de Itinéraires du refus, dans l’émission Tempestades 2.1 du 29 mars 2025.
À écouter en cliquant ICI !
Interview de Jorge Valadas, auteur de Itinéraires du refus, par Arthur Silva, dans l’émission Passage à niveau du 9 mars 2025.
Itinéraires du refus, un exemplaire chemin de liberté
En 2024, les éditions Chandeigne & Lima lançaient une nouvelle collection dénommée Brûle-Frontières. Elle s’est ouverte avec le récit du cinéaste et écrivain José Vieira, Souvenirs d’un futur radieux, qui revenait sur son enfance portugaise puis son arrivée dans des bidonvilles de triste mémoire, à Massy, où ont été logés une partie des émigrants portugais. Addict-Culture s’était entretenu avec l’auteur (https://addict-culture.com/jose-vieira-chandeigne-2024/) qui a encore, très récemment, été reçu dans l’émission Douce France (https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/douce-france/les-portugais-d-ile-de-france-l-empreinte-d-une-communaute-modele-4193179) que je ne saurais trop vous recommander d’écouter.
Et puisque revenir sur l’histoire récente des liens entre la France et le Portugal c’est interroger notre passé autant que notre présent, je vous parle aujourd’hui du second volume de cette enthousiasmante collection, Itinéraires du refus, tout aussi réussi que le précédent et qui centre son propos sur le passionnant parcours d’éveil à la conscience politique sous la dictature salazariste d’un futur déserteur de l’armée coloniale portugaise, Jorge Valadas. Ce qui m’est venu tout de suite à l’esprit à la lecture de ce récit d’apprentissage c’est le mot « Respect ». Respect pour la rare précocité du narrateur qui nous relate son acquisition progressive d’une forme d’acuité politique et sociale dès l’enfance et l’adolescence, et respect pour la permanence, tout au long de sa vie, d’une posture de questionnement systématique (des assertions entendues, de l’ordre social inégalitaire qui favorise les soumis et les dociles, …) qui le maintiendra à l’abri des écueils dans lesquels tant sont tombés ou se sont fourvoyés et le gardera à jamais libre de toute attache idéologique préfabriquée.
Il n’est encore qu’un gamin, ce fils d’un professeur instable et un peu obsessionnel, qu’il entend déjà son père ordonner le monde entre communistes et non communistes, ou entre bons salazaristes (ce qu’il pense être) et salazaristes déviants, ceux qui s’écartent trop de l’homme à qui ils doivent tout. Un père assez mystérieux et souvent absent dont le jeune garçon interroge tout de suite les contradictions paternelles, contradictions qui viennent par ailleurs percuter ses propres incompréhensions du monde qu’il découvre, ses doutes et ses peurs. Rapidement, l’enfant sent instinctivement qu’on obtient un surcroît d’ouverture à fréquenter des personnes différentes de soi, des petits camarades fils de communistes ou un pseudo oncle qu’il découvrira plus tard barbouze du régime, ainsi qu’à envoyer balader la religion et son catéchisme naïf ou à torpiller les rencontres des jeunesses fascistes confondantes, tout un corpus incohérent à ses yeux avec lequel il comprend rapidement qu’il doit rompre.
C’est à partir de lui et de lui seul, que le narrateur apprend à penser, à penser dans le sens le plus noble que lui confère Hannah Arendt pour qui « l’être humain ne doit jamais cesser de penser ; c’est le seul rempart contre la barbarie ». Cette faculté, l’enfant l’acquiert d’ailleurs d’une manière quasi corporelle, grâce à ses propres sensations et intuitions et comme un long travail d’extraction de la gangue archaïque dans laquelle il est maintenu. Cette liberté de choix et de conscience il la doit notamment à sa « terre de liberté », cette île d’Abóbora en Algarve où il apprend chaque été, en partie délivré du père, ce que c’est qu’être soi, ce que ce devrait être qu’être libre. À partir de cette expérience primordiale tout se déploie : le sens de la contradiction (comprendre que des choses ne vont pas ensemble), le sens de ce qui est inexplicablement refoulé ou caché (conscience d’un mystère de la sexualité qui est à découvrir et non à éviter), la conscience que tout ce qui fait obstacle à la raison doit être observé, questionné encore et encore, jusqu’à ce qu’un sens cohérent surgisse enfin pour soi-même (par exemple son examen minutieux des étranges échanges entre les douaniers de son île tant aimée, bien peu cohérents avec l’ordre militaire de base qu’ils devraient respecter et qui révèleront, évidemment, de bien sombres petits trafics !!).
« Très tôt, la violence des inégalités sociales s’impose à moi, de façon choquante. Dans les années cinquante, avoir une bonne est un luxe permis à tous ceux qui ont un salaire raisonnable et régulier. Les bonnes sont de jeunes femmes venues de la campagne qui travaillent en échange d’un maigre salaire. Elles sont nourries et logent chez leurs patrons, dans des petits réduits. Il n’y a pas de limite à l’effort fourni. C’est selon le bon vouloir du maître, ou plutôt, selon la maîtresse. Des bonnes, il y en a partout chez les voisins, des épiciers aux employés de mairie, à plus forte raison chez les « Docteurs », qui en ont parfois deux. Mes parents, fonctionnaires, professeurs de collège technique, n’échappent pas à la règle. […] Ces rapports de servitude font partie de ma vie de tous les jours. J’en bénéficie, à double titre : en tant que garçon et en tant que membre du clan des maîtres. Les bonnes sont comme un symbole de l’incapacité masculine à assumer le quotidien »
Jorge Valadas, Itinéraires du refus.
Mais c’est également dans un autre corps à corps, celui qui se joue avec « Le père » ainsi toujours nommé, que Jorge Valadas va progressivement gagner des « espaces de liberté ». Farouche admirateur de Salazar « Le père » reste cependant assez critique avec les déviances du régime, dénonçant tout autant les cliques grenouillant autour du dictateur que la corruption endémique ou les petits arrangements avec les règles. Dès lors, quand l’auteur fait un de ses pas de côté qui commencent à dessiner son itinéraire si particulier, « Le père » condamne mais, en vérité, laisse plutôt faire. Rejet de la religion, refus de chanter l’hymne national à plein poumons tous les matins à l’école, accès à des lectures jugées non canoniques (BD, Verne, Melville, Stevenson, Twain, etc …) dans un pays où Salazar a déclaré que « le peuple doit juste savoir le suffisant, pas plus. », rejet enfin de la carrière militaire dans la Marine navale qu’il embrasse faute de mieux parce qu’elle offre la possibilité de partir au loin et de s’extraire enfin de la cellule familiale. Tout se passe comme si ce père affichait la dualité d’un Janus, dont la première moitié regarderait vers le passé adulé mais en voie de gangrénisation et la seconde un futur pour lui inaccessible et inenvisageable mais qu’il pourrait peut-être tutoyer, par procuration, grâce à son fils.
Insubordination, désertion, voyages au loin aux États Unis au Brésil ou en France, adhésion aux luttes antiracistes et anticolonialistes, aux combats féministes, cache-cache avec les autorités de l’immigration dans les aéroports ou les postes de police, rencontres intellectuelles décisives, le récit des pérégrinations de Jorge Valadas est aussi rocambolesque que passionnant. Il faut, donc sans plus dévoiler, laisser au lecteur le soin de le suivre au fil des pages et de le regarder, toujours aussi aiguisé, savoir choisir et savoir pourquoi il le fait, de le voir troquer l’instabilité imposée que lui faisait vivre « Le père » dans les innombrables déménagements de la famille contre une instabilité assumée, joyeuse et formatrice.
Viendra pourtant le temps tant espéré, après le 25 avril 1974 où, le régime Salazariste étant tombé, la question du retour se posera à ceux qui avaient quitté le Portugal et pour certains opté pour une France dont les actes de collusion avec le régime du dictateur demeurent peu connus. Avec la question du retour s’ouvre pour le narrateur l’inextricable dilemme entre repartir dans son pays natal ou rester en France, l’inextricable lutte entre la personne que je ne suis plus et la personne que je ne peux pas être à nouveau, cette souffrance insidieuse et culpabilisante que ressentent immanquablement ceux qui ont dû s’exiler et qu’aucun choix ne parvient à totalement apaiser.
Même si la Révolution des œillets le ramène quelques temps dans la Lisbonne de son enfance, Jorge Valadas, traversé par cette frontière autant physique que psychologique, sait assez vite, comme dans le reste de son parcours, que pour lui il n’y aura pas de retour en arrière possible. Sa vie ne peut en effet se dérouler que dans un seul sens, vers l’avant, et le chemin parcouru par les portugais dans leur libération n’offre qu’une délivrance politique partielle aux relents d’ancien régime beaucoup trop tangibles et nauséabonds. Mais paradoxalement ce sera ce choix aussi difficile pour lui que douloureux pour ses parents restés au Portugal qui lui permettra de recevoir in fine la « bénédiction » du père, celle au travers de laquelle il lui dira qu’il comprend combien son trajet et ses options politiques sont constitutives de ce qu’il est en tant que personne et qu’il peut désormais assumer ses écrits engagés sous son propre patronyme, celui qu’ils partagent tous deux. Le chemin d’errance pour chacun d’eux est peut-être enfin terminé, en ce point d’orgue où ils se rencontrent.
Ne manquez pas ce récit d’exil, intime et humain qui en dit avec justesse les limites et les difficultés. Refuser, se construire contre mais en étant toujours maître et auteur de ses choix, c’est ce que le parcours étonnant et exemplaire qu’Itinéraires du refus nous offre.
Respect !
Cécile Douyère-Corallo – Addict Culture – 24 mars 2025
Retrouvez l’article sur le site d’Addict Culture
Jorge Valadas interviewé par Carina Branco sur RFI português – le 26 mars 2025
Présentation du livre Itinéraires du refus – entretien en portugais
A história do oficial de Marinha que trocou a ditadura pela liberdade
À écouter en cliquant ICI !
Sur la nécessité de déserter
A propos de Itinéraires du refus de Jorge Valadas
La Patrie. A l’heure où des politicien.ne.s français.e.s se proposent de capter le peuple par une rhétorique de la patrie à portée de critique de ChatGPT, il me paraît plus que jamais nécessaire à moi qui suis né et vis en France, de travailler contre la patrie française. Travail qui passera par une réflexion sur la notion de peuple et sur le sentiment d’appartenance à un territoire, sans oublier d’introduire la variante de la classe, au nom de laquelle on proclama un peu vite au XIXe siècle que « les prolétaires n’ont pas de patrie ». C’était avant que les soulèvements des peuples colonisés ne viennent rappeler une évidence que l’on a un peu tendance à oublier ces temps-ci, à savoir que l’attachement à une terre et à la communauté qui y vit, de Gaza à l’Ukraine, n’est pas de la même nature que l’attachement de Netanyahou au Grand Israël ou de Poutine à la Grande Russie. C’est pourquoi, on se proposera dans ces chroniques de rendre compte de livres qui fournissent quelques éléments de réponse à des questions qui vont revenir nous hanter : pourquoi et quand déserter ? Pourquoi et quand résister ?
Ce lundi, on vous propose de suivre le récit d’une vie, celle de l’ami Jorge Valadas (Charles Reeve), déserteur des guerres coloniales du Portugal de Salazar, devenu globe-trotter des révolutions et auteur de livres remarquables, depuis Le Tigre de Papier- le développement du capitalisme en Chine (Ed. Spartacus) qui, dès 1972 dénonçait la fumisterie maoïste et ses crimes, jusqu’à son Socialisme sauvage (L’Echappée, 2018), remarquable synthèse historique sur l’histoire mondiale de l’auto-organisation prolétarienne.
Itinéraires du refus est un récit intime, qui approche au plus près, dès l’enfance, la recherche de ce qui a pu faire germer chez ce fils d’un admirateur de Salazar la fleur de la révolte. Est-ce d’avoir perçu très tôt la complicité entre sa mère et la bonne, et à travers elles la résistance des femmes dans le Portugal des années 60 ?
« Ma mère (…) intervient souvent pour poser des limites au travail de la bonne, défendre certains de ses droits et sa liberté. Ses origines paysannes me paraissent expliquer cette tolérance et cette proximité.
Ces rapports de servitude font partie de ma vie de tous les jours. J’en bénéficie, à double titre : en tant que garçon et en tant que membre du clan des maîtres. Les bonnes sont comme un symbole de l’incapacité de la société masculine à assumer le quotidien. Nous sommes tous des enfants asthmatiques et fragiles, pris en charge par une armada de mères, de sœurs, de cousines, de tantes… et de bonnes. Salazar lui-même a sa bonne. On parle d’elle dans les journaux et à la radio. La seule relation féminine qui lui est connue et dont le journal et le père parlent avec affection, en dehors de sa passion pour la mère patrie bien entendu… »
Est-ce d’avoir entendu, à 13 ans, des échos de ce que la mère-patrie fait en Afrique ? Le voilà à écouter des conversations chez les Bentes, une famille de voisins et amis :
Bentes-fils a une sœur plus âgée, institutrice. Elle a émigré en Afrique, quelque part au sud du Mozambique, du côté de l’Afrique du Sud. Un jour nous apprenons que Bentes-mère part lui rendre visite. Bentes-père la suivra « et ils y resteront plusieurs mois. À leur retour, au cours d’un de ces repas qui se terminent toujours par des desserts extraordinaires, Bentes-père raconte. La nature, la jungle, bien sûr, car dans notre esprit, l’Afrique est avant tout la nature, extraordinaire. Puis, il y a un silence, un temps d’arrêt dans le récit, une gêne. Ce n’est pas habituel chez lui. — C’est compliqué…, dit-il à voix basse.
Depuis mon enfance, je suis habitué à ce mot, « compliqué », « qu’il faut en fait traduire par : « il y a un problème ». Justement, il y a le problème des Noirs. Il dit aussi bien Noirs qu’Africains… Tout d’un coup, pour moi, les Noirs sont devenus des êtres avec une existence autonome, ils ne font plus seulement partie du décor. On bat les Noirs, les serviteurs noirs. Et pas qu’un peu, furieusement, jusqu’au sang. Bentes-père l’a vu, il a trouvé que ça n’allait pas du tout… Mais il a du mal à en dire plus, il s’agit de sa fille et de son gendre. Son trouble me perturbe. Lui toujours si tranché dans ses opinions, il est ici mesuré, il négocie, il cherche à minimiser. Quelque chose, entre le mystère et le terrible, se passe en Afrique. Il ne le dit pas mais il nous le fait comprendre, ça ne pourra pas durer, ça va avoir un prix. J’ai treize ans et l’harmonie du grand Portugal, puissance civilisatrice au-delà des Océans en prend un sacré coup. Nous ne sommes donc pas des pionniers du progrès.
Ou bien est-ce quand, après avoir essayé d’échapper à la famille en devenant cadet de Marine, il se retrouve dans une de ces barcasses pourries qui représentent la glorieuse marine de guerre de son pays, et qui pourraient bien être la métaphore de cet empire portugais qui prend l’eau ?
Les vieux navires attribués après la Deuxième guerre par l’OTAN au gouvernement portugais sont mal adaptés aux missions sous ces latitudes, à ces conditions climatiques. Rien n’a de sens et pourtant chacun fait comme si c’était l’état normal des choses. La chaleur tropicale détruit la volonté et écrase l’initiative. Nous vivons au ralenti et dans une mollesse générale, nous tuons le temps, accoudés au bastingage en regardant les rives foisonnantes de la végétation luxuriante. Au-delà, c’est le pays des guérilleros du PAIGC. Qui sait, peut-être nous regardent-ils fondre d’ennui et de chaleur ? Probablement pas, car la zone est « sécurisée », du moins autour de la bourgade qui fait office de capitale de la petite colonie. À deux ou trois reprises, nous descendons à terre. L’ambiance est tendue, un silence épais sépare les Blancs en uniforme de la masse de la population noire. On pressent que cela est antérieur à la guerre, que le colonialisme est un mur bien bâti. Que la distance agressive plonge ses racines dans le passé. Un de mes camarades qui a des lectures interdites, me rappelle la grande grève des dockers du port de Pidjiguiti, à côté de Bissau, en août 1959, qui s’est terminée, dit-il, avec plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Je ne lui demande pas d’où il tient ces informations, je connais ses lectures, je lui fais confiance.
Une première impression s’impose à moi, derrière le port, la bourgade, les rives luxuriantes, il n’y a pas qu’un petit territoire, c’est un continent. Les maîtres du petit Portugal croient combattre des rebelles locaux, en fait ils font la guerre à l’Afrique. La chaleur tropicale écrase la vivacité de l’esprit et nous buvons beaucoup de bière. Mes sensations s’entourent d’un brouillard légèrement alcoolisé. Ce qui me permet par moments d’ignorer que je suis là.
Pourtant, le réel s’impose à nous. Quelques images s’impriment dans mon esprit avec une netteté qui sera ineffaçable. Un jour, nous partons visiter une caserne. Cela ne nous intéresse que moyennement, mais nous sommes obligés ; alors on écoute d’une oreille distraite les discours monocordes des officiers rendus inaudibles par la chaleur épaisse qui nous endort. Puis, on traîne dans les baraquements. Au détour d’une allée, nous débouchons sur un terre-plein où se trouve une vieille construction en tôle, à moitié délabrée, les portes grandes ouvertes. Avec deux ou trois camarades, nous nous approchons, captivés par ce que nous pensons être une présence humaine étrange. Au fond du hangar, il y a là quelques hommes en haillons ou à moitiés nus, assis à même la terre, d’autres couchés, recroquevillés sur eux-mêmes. Ceux qui nous observent ont le regard vide, absent. Ils ne nous voient pas vraiment. Nous sommes tétanisés, paralysés par ce que l’on découvre. Sans même les regarder, le sous-officier qui nous accompagne dit : « – C’étaient des terroristes. » Il conjugue le verbe au passé, d’une voix froide et définitive. À ce moment précis, pour moi, il tombe du côté obscur de l’humain. Complices dans notre frayeur, nous nous regardons. Notre silence s’ajoute au silence de ces hommes torturés qui ne bougent plus, qui n’existent plus, qui ont été. Ils restent là, le portail du baraquement grand-ouvert, incapables de bouger, de fuir.
Jusqu’à ce moment précis, la guerre coloniale était fondue dans le paysage, tenue à distance, masquée par la végétation luxuriante. Avec ces êtres humains détruits, elle fait une entrée concrète dans nos vies.
La décision de la désertion sera d’autant plus douloureuse que le jeune Jorge aime ce père salazariste modéré à l’œuvre picturale duquel il consacrera, des décennies plus tard un livre. Il a beau étouffer dans les liens familiaux, il les aime aussi. C’est le paradoxe de l’exil auquel il consacre quelques-unes des plus belles pages du livre. Pour accepter l’exil réel hors des frontières et l’exil mental hors du faux vivre-ensemble qui attend tous ceux, toutes celles qui désertent le monde masculiniste, capitaliste, impérialiste, la peur n’est pas le principal ennemi à vaincre. L’obstacle principal, pour l’exilé, c’est l’attachement à la patrie : pas la patrie institutionnelle que gardent les flics et les militaires, pas la patrie des livres d’histoire, mais la patrie personnelle, la patrie sentimentale faite de paysages, de goûts et de couleurs, que chacun s’est construit depuis l’enfance. C’est ainsi qu’il vit son retour au Portugal :
Adossé au bastingage du ferry, me revient soudain un souvenir très fort. Nous sommes en 1967, nous sommes deux proches camarades et nous venons de quitter l’école de la Marine militaire. Nous avons été affectés à deux vieux patrouilleurs côtiers. Il navigue sur un bateau tout aussi déglingué que le mien. Le sien patrouille sur la côte au nord de Lisbonne, le mien met toujours le cap au sud. Nous partageons les mêmes idées et nous avons de longues conversations une fois que nous nous retrouvons au port d’attache. Nous parlons souvent du dégoût d’une société qui ne nous mérite pas, nous invoquons l’échappatoire de l’exil. C’est une fin de journée lumineuse d’un printemps « lisboeta ». Je m’en souviens maintenant comme si je le vivais au présent. Côte à côte, nous arpentons le quai, encombré de cordages. Dans un mois je m’en irai. J’ai pris la décision de partir, de rompre les amarres avec cette inutilité auquel on me destinait. L’échange est resté très précisément gravé dans mon cerveau. Après ces paroles, un grand silence s’abat sur nous. Un court instant, une fugace pensée me traverse, il peut me dénoncer. Non. J’en suis sûr qu’il ne le fera pas. Je le sens bouleversé et triste, comme s’il avait deviné ma pensée. À voix basse, il me dit :
— Moi je ne peux pas. Vas-y, toi, je te comprends !
Par procuration, je pars pour lui, pour d’autres. Nous nous disons au revoir.
(…)
L’exil nous contraint à nous séparer d’une part de nous-mêmes : en quittant un pays, forcés de rejeter une normalité qui nous fait violence, nous ne sommes pas « maîtres chez nous ». Cette force qui dans l’exil nous libère est aussi celle qui nous aliène de cette autre part de nous-mêmes. Comment vivre cette division ? Comment ne pas perdre tout lien – ou comment renouer le lien – avec notre passé et nos origines, avec les sources de notre être, bref, avec « la prison » dont-on s’est « libéré » ? Double mouvement de l’exil, s’« exiler de l’exil » pourrait bien être alors le chemin qui m’a conduit à reconstruire une possible reconnaissance de moi-même et me faire accueillir par le pays d’où je venais et qui avait changé : m’y retrouver, différent de celui qui s’est exilé.
Mai 68, puis la révolution portugaise, m’ont permis de réparer pour beaucoup la blessure de l’exil. Ces moments lumineux de subversion de l’ordre gris ont éclairé ma vie, m’ont permis d’effacer la tristesse, la mélancolie qui se mêlait à la libération. C’est par ce processus de s’exiler de l’exil que j’ai aussi trouvé une place dans le grand monde. La place qui me convient.
Jorge Valadas présentera son livre Itinéraires du refus (Éditions Chandeigne & Lima) le mardi 8 avril à partir de 20h à la librairie Quilombo 23 rue Voltaire, Paris XIe, m° Rue des boulets ou Nation.
Serge Quadruppani – Lundi matin #469 – 31 mars 2025
Retrouvez l’article sur le site de lundi matin.
À la recherche du temps gagné
« Sur le terrain vague de la mémoire, écrivit Pierre Drachline, poussent ces herbes folles que l’on nomme, à défaut d’un mot plus précis, des souvenirs. » La mémoire, il l’a fidèle, Jorge Valadas, et précis les souvenirs, même les plus lointains. Au point qu’à lire ces Itinéraires du refus, on se trouve subitement plongé dans les siens propres avec, en tête, une idée perturbante : de quel bois est-il fait, ce bougre, pour exhumer des souvenirs de ce long et volatil temps de l’enfance avec une telle aisance et précision ? Car il semble se rappeler de tout, Valadas, de la couleur d’un ciel, d’un parfum de sa mère, d’une douceur pâtissière d’un jour de gloire, de sa lecture précoce de Walter Scott, de ses tout premiers refus, du Lisbonne des années 1950 et 1960 – dont il dresse un tableau pointilliste et saisissant de vérité à partir des souvenirs tenaces de ce qu’il percevait, enfant puis adolescent, de l’air oppressant qu’on y respirait.
Il est vrai que Jorge Valadas a visiblement intégré tout jeune cette tribu d’êtres têtus qui, dès qu’ils les ont entendus et assimilés, habitent « les mots de Liberté et de Révolution » comme pièces essentielles d’un puzzle en construction permanente. Dès lors, dans leurs imaginaires vagabonds, ils sont toujours là, prêts à servir, comme balises inspirantes. Le reste est affaire de ténacité, de culture, de pratique et de quête des lointains. « Les choses – écrit-il – cherch[aient] leur place dans mon esprit. » En 1956, c’est à Budapest que les mots « liberté » et « révolution » prennent forme et sens. Un peuple s’y soulève contre le Parti dit communiste, occupe les usines, crée des conseils ouvriers, ouvre la voie de sa propre émancipation. Les chars de l’Armée rouge la refermeront. Par anticommunisme, le pouvoir salazariste soutient les Hongrois. Le petit Jorge a onze ans quand il se rend, en compagnie de son père, un homme d’ordre et de morale plutôt favorable au régime, à sa première manifestation. Pour protester contre la tuerie de Budapest, précisément. C’est l’idée de « Liberté » – avec majuscule – qui anime le gamin, cette liberté que les chars russes ont écrasée. Cela dit, au fond de lui-même, il sent bien que les salazaristes qui ont organisé ce rassemblement, et qui se veulent, par anticommunisme, les porte-voix des insurgés, n’ont, en matière de liberté, aucune leçon à donner à personne. Son père semble le penser aussi, mais en silence.
De chapitre en chapitre, la plume alerte de Jorge Valadas nous entraîne dans un voyage au long cours relevant tout à la fois du parcours d’apprentissage, de la pérégrination esthétique, de l’aventure humaine, de l’expérimentation politique et de l’appel du large. Tout cela, avec la claire volonté de faire en sorte que ce road movie existentiel échappe aux effets négatifs du passage du temps, dont le plus ravageur est sans soute de figer l’ancienne mémoire dans le poncif, le convenu ou le nostalgique. Ce pari, car c’en est un, Jorge Valadas le tient du début à la fin de ces Itinéraires, ce qui ne l’empêche pas, au gré des pages, de manier la mélancolie comme elle doit l’être, c’est-à-dire comme un sentiment qui pense… À ce pèlerinage de Fatima, par exemple, où, enfant, il s’est senti « immergé dans un monde laid, terrible, méchant », un univers de « peur » forgeant à jamais en lui un « refus définitif des situations de masse, de cette dissolution de l’individu dans la foule, de l’irrationnel devenu force collective », mais aussi la conviction que cette « peur » majuscule de la religiosité ne pouvait « se surmonter que par le travail de l’imaginaire ». Il n’en manque pas d’imagination, le jeune Jorge. Il s’exerce à l’aiguiser lors de ses séjours d’été sur l’île d’Abódora (du Potiron), dans l’Algarve. Ce « temps d’un présent immobile où le futur n’a pas encore sa place », il le vit dans le bonheur de la découverte et du saisissement du sentiment du désir, mais aussi dans la lecture de livres d’histoire, forcément avalisés par la censure salazariste, où toujours le gamin s’identifie aux « infidèles pourchassés » plutôt qu’aux « chevaliers chrétiens » qui les traquent. Le pli est pris, en somme. « Hors des normes », et pour longtemps.
« Le sens de la vraie vie, note Jorge Valadas en se remémorant la sienne propre, est dans le pas de côté ». C’en est un, et comment, de s’inscrire, en septembre 1963, à l’École navale d’Alfeite, sur l’autre rive du Tage. L’appel du large, là encore. L’expérience tient pourtant de l’épreuve, du moins au début : bizutage, humiliations, l’infâme panoplie de vexations dont sait faire preuve la gente militaire. Le jeune homme en tire une leçon : faire le « maximum du minimum » pour éviter de se faire remarquer. Utile principe de survie, il est vrai, quand on a compris « qu’en face nous avons des nuls et des lâches ». Mais la résistance à la bêtise galonnée exige parfois un pas de plus, collectif cette fois, pour marquer la frontière. Il se fait, au cours d’un exercice militaire stupidement ordinaire, dans un acte d’insubordination caractérisée : un refus de crapahuter, un sit-in dans la nuit et une réponse toute prête, décidée collectivement, pour l’aube qui vient toujours : « Arrêtez-nous, menottez-nous ! Nous refusons de jouer le jeu. » Les gradés n’en feront pas un plat. La résistance est donc possible. Plus tard, mi-janvier 1966, c’est la découverte de l’Afrique. Amarrage au port de Bissau – en Guinée « portugaise », comme disent les officiels. Une semaine – le temps de découvrir l’horreur de la guerre coloniale – et une image traumatisante : un groupe d’hommes à moitié nus, couchés à même le sol, le regard vide ; « des terroristes », dit l’officier de service ; ils viennent d’être torturés, détruits. « Jusqu’à ce moment précis, écrit l’auteur, la guerre coloniale était fondue dans le paysage, tenue à distance, masquée par la végétation luxuriante. À partir de ce moment, elle fait une entrée concrète dans nos vies. Je pense à Joseph Conrad, nous étions au cœur des ténèbres. » Ce qui se noue chez lui à cet instant précis, c’est une certitude : refuser cette sale guerre. Sa décision de déserter est prise, irrévocable. Il choisit le chemin de l’exil en juillet 1967.
Le cap, c’est Paris. Un petit hôtel à Montmartre ; une connaissance, Françoise, militante anticolonialiste ; une démarche sans succès place Kossuth, siège du PC, pour voir s’il peut être assisté ; des déambulations incessantes dans la Ville-Lumière ; des petits boulots alimentaires ; une découverte renversante : celle de l’excellente revue portugaise d’opposition et d’orientation marxiste anti-autoritaire, Cadernos de circunstáncia, au sous-titre alléchant pour l’exilé qu’il est devenu : « Analyse et documents sur la vie portugaise [1]. Ils compteront beaucoup dans sa vie.
L’exil, le sentiment de l’exil, sa dimension existentielle sont au centre de ce livre, qui explore toutes les phases par lesquelles passe l’exilé : la fierté d’avoir atteint son but ; la sensation de solitude qu’il génère ; la rage qui en résulte ; la blessure qu’on en retire et que jamais rien ne guérit, pas même le retour à l’étrangère terre première. Car exilé on l’est et on le reste à jamais, pour soi et pour les autres. Un être venu d’ailleurs et dont l’ailleurs est dans la tête. « Se sentir étranger à tout et à tous, note Jorge Valadas, procure une immense fatigue », une fatigue à double entrée en réalité : celle qui émane d’une obligation à fuir et celle qui provient du sentiment que cette fuite obligée a doté l’exilé d’une « richesse intérieure » augmentée. La surmonter, cette fatigue, c’est parvenir à « s’exiler de l’exil » pour retisser un lien possible avec le pays d’origine, en sachant qu’on n’en sera jamais vraiment parce que, quelque part, on se sentira toujours comme étant d’une partance et d’un retour, ou plutôt de ce mouvement, du mouvement. Un homme aux semelles de vent, en somme.
Ça tombe bien parce que Jorge Valadas aime les voyages. C’est ainsi que, doté de son faux-vrai passeport et d’un visa délivré sans problème par l’Ambassade américaine de Paris, il décide, en septembre 1970, accompagné de son amie Jackie, étudiante à l’Université de Pennsylvanie, de traverser l’Atlantique. Sur les conseils de Ngo Van, il y rencontrera, à Boston, le grand Paul Mattick [3], théoricien du communisme de conseils, mais aussi son fils –Paul Jr., digne héritier politique de son père – qui deviendra un ami proche.
L’exil, encore, mais en sens contraire cette fois… Sur le chantier où il travaille comme électricien, Jorge apprend par deux collègues portugais, déserteurs eux aussi, que, ce 25 avril 1974, les jeux sont faits : « Le régime est tombé ; ils viennent de l’annoncer à la radio ». Dès lors, l’appel du retour se fait irrésistible. Le 3 mai, il prend le Sud-Express à Austerlitz, via Lisbonne, accompagné d’un copain du Mouvement du 22 mars de Nanterre. À la frontière, aucune police ne contrôle aucun papier. « Lisbonne vit dans la liesse », écrit-il. Et la liesse, il faut en profiter parce que, généralement, elle s’estompe vite. Ce qui l’enthousiasme, lui, c’est que le mouvement des grèves et occupations prend vite, qu’il s’auto-organise à la base : des comités de travailleurs, d’habitants, de soldats poussent comme mille fleurs dans le printemps lisboète. De quoi avoir le cœur et la tête en liesse, même quand on connaît la capacité des bureaucraties de toutes sortes, mais surtout du Parti communiste, à confisquer à celles et ceux qui les ont acquises, leurs plus belles victoires.
« Un soir, écrit Jorge Valadas, je croise à Lisbonne un copain d’exil de Paris. Il déambule un peu perdu. Le nom des rues, le numéro des trams, la géographie de la ville, il a tout oublié. Lui, qui avait vécu toute sa vie à Lisbonne, erre dans les rues comme s’il avait débarqué à Buenos Aires. Inconsciemment, me dit-il, il avait rayé la ville de sa tête. » Le retour d’exil, c’est toujours comme ça : le cœur balance entre bonheur et tristesse. Et c’est bien normal, le bonheur parce qu’on a été d’un endroit et la tristesse parce qu’on n’en est plus, qu’on est définitivement d’ailleurs. Au mieux on a toujours une tête qui dit quelque chose au bistrotier du coin de sa rue, mais pas davantage. La césure est faite, et elle est définitive. Reste la famille : le visage radieux de sa mère, malade, respire le bonheur en voyant son fils ; son père et sa sœur sont moins expansifs, même si on les sent heureux. Mais rien n’y fait, là encore, on n’est plus d’ici, ni de cet espace, ni de ses anciennes habitudes, ni même de sa chambre. « Ce que je ressens terriblement, écrit Jorge Valadas, est la distance aux autres, une séparation, un mur, un mur infranchissable. » Il lui faudra donc rompre une fois encore, et cette fois-ci avec l’illusion d’un retour au pays de l’enfance. C’est un choix qui rend triste, dit-il, mais qui suscite une sensation apaisante de calme intérieur. « Lisbonne est à nouveau une pensée, une sensation, une lumière très blanche », note-t-il. Un ailleurs, en somme. L’exil, ce sera toujours une absence de lieu et le lieu d’une présence.
On ne fera qu’évoquer, parce qu’on préfère laisser le lecteur les découvrir, les deux chapitres finaux – « La lumière de la vie » et « Réconciliation attendue » – où il est question de la fin de vie de la mère et du père de l’auteur. L’émotion qui s’en dégage y est difficilement communicable tant elle est liée aux mots qui la portent. L’un des chapitres est précédé d’une citation de B. Traven, cet exilé définitif. Elle dit : « Il faut savourer la vie tant qu’elle dure et en tirer le plus possible, car la mort est en nous depuis l’instant de notre naissance. » La vie, elle bruisse à chaque page de ce livre qui s’attache à restaurer, dans un mouvement permanent, la mémoire des douleurs et des plaisirs, intrinsèquement mêlées.
À son auteur, Jorge Valadas, et en hommage à ce que la lecture de ce livre nous offre, cette phrase d’un ami qui résumait sa vie ainsi : « J’ai vécu des jours de merveille que l’inquiétude attisa toujours. » C’est ce que j’ai ressenti, je dois dire, en lisant ces superbes Itinéraires du refus.
Freddy GOMEZ – à contretemps – 7 avril 2025
Retrouvez l’article sur le site de À contretemps
Notes
La révolution est une course de fond
Jorge Valadas est l’un de ces aïeux radicaux qui inspirent immédiatement la sympathie quand on le rencontre. Ce militant d’origine portugaise a traversé bien des épisodes, soufflant sur les braises des espoirs révolutionnaires avec générosité. Il se raconte, pudiquement, dans le très beau Itinéraire du refus (Chandeigne & Lima, mars 2025).
Ce n’est pas un ramenard, l’ami Jorge Valadas. Il n’écrit pas pour la gloriole, pour conter ses exploits de vieux routier du militantisme international. Dans Itinéraire du refus, il entreprend de saisir ce qui, dès l’enfance, conduit par petites touches à forger une identité politique, un imaginaire, un refus de l’existant.
Né à Lisbonne en 1945, il a grandi dans une société menée de main de fer par le fantoche Salazar au pouvoir depuis 1932, avec la complicité d’une Église catho aussi rétrograde qu’omniprésente. Pas jojo. Le jeune Jorge comprend vite qu’il est de l’autre camp. Sa vision des salazaristes à douze ans : « Je les vois comme des sosies du bouffon général Tapioca et du fourbe Olrik qui répandent leurs méchancetés dans les épisodes de Tintin et de Blake et Mortimer. »
La suite s’écrit par épisodes plus ou moins douloureux. La distance grandissante avec le père, généreux, aimant, mais admirateur de Salazar. La découverte si remuante de la littérature, puis de Marx & cie. Les années dans la marine militaire à s’ennuyer sur le bel océan (sa consolation) en sabotant gentiment la routine. Et puis, en ce temps de guerres coloniales sanglantes (en Angola, au Mozambique), alors que Salazar professe « l’empire c’est la nation », ce choix qui d’un coup se fait impérieux : la désertion.
C’est ainsi qu’en juillet 1967 Jorge débarque dans un Paris qui l’étourdit. Il se cherche. « Je débarque du Moyen Âge ibérique », dit-il. Il sonne à la porte du Parti communiste, qui l’écœure. Se fait draguer par les trotskystes, qui l’assomment de leur bréviaire. Refuse le culte de Mao. Alors il trouve des interstices, lit Rosa Luxemburg, se forge un marxisme où l’autoritarisme n’a pas sa place. Cavalant partout pendant Mai 68, de comités d’actions en grève sur son lieu de travail, il va aussi « distribuer des tracts dans les bidonvilles portugais de la banlieue ».
La flamme retombée, il ne lâche rien. Se retrouve embarqué en 1972 dans une histoire de livraison de littérature séditieuse au Portugal par le biais de sous-marins que le régime honni vient d’acheter à la France : « C’est ainsi que des milliers de revues et de brochures arrivent par des bonnes mains, à Lisbonne, pour trouver diffusion dans les milieux de la jeunesse, avide d’idées révolutionnaires sentant encore bon l’odeur des barricades parisiennes. »
La révolution des Œillets, en 1974, est évidemment un firmament pour lui, même s’il a peu de doutes sur sa récupération sociale-démocrate. « Mai 68, puis la révolution portugaise, m’ont permis de réparer pour beaucoup la blessure de l’exil », lâche-t-il. « Ces moments lumineux de subversion de l’ordre gris ont éclairé ma vie. » De là, il restera le même, toujours à l’affût des mouvements sociaux, toujours présent dans les manifs. Une vie à lever le poing, sans bravade, juste pour contrer le gris.
Itinéraires du refus, de Jorge Valadas
« Enfants de la fin de ce système autoritaire inique, la plus longue dictature du XXe siècle en Europe, nous avons été ses derniers sujets avant sa chute. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi été les enfants du dernier système colonial européen, nous avons assisté et participé à son effondrement. C’est beaucoup. » Voilà ce qui arrive quand on naît au Portugal à la fin de la Seconde Guerre mondiale comme ça a été le cas de Jorge Valadas — autrement connu sous le pseudonyme de Charles Reeve. Si le régime de Salazar craque déjà par certains aspects, difficile d’imaginer, lorsqu’on grandi sous son joug dans les années 1950, que celui-ci s’effondrera sous les coups d’un soulèvement une vingtaine d’années plus tard. Aussi, le plus sûr chemin pour se défaire de ses contraintes est-il de partir. Mais encore faut-il comprendre ce que l’on quitte. C’est ce que raconte l’auteur, reprenant le labyrinthe qu’il a exploré depuis qu’il a déserté de l’armée portugaise en 1967, rompant d’un même élan avec un catholicisme étouffant, un régime autoritaire, une société coloniale. « Pour moi, l’exil est un chemin choisi. Et c’est dans les raisons de ce choix que je puise mon éthique et ma force de vie. » Il n’aura de cesse, dès lors, de refuser les évidences confortables qu’assurent les dogmes. Pour cela, il peut compter sur un dense réseau de camarades rencontrés pour beaucoup à Paris lors de l’insurrection de 1968, certains fuyant l’Espagne franquiste, d’autres le Vietnam d’Hồ Chí Minh, tous se retrouvant dans une solide conviction socialiste anti-autoritaire. Ensemble, ils ont appris à « s’exiler de l’exil », animant des revues et des maisons d’édition, partant à la rencontre de complices aux États-Unis, au Brésil, en Chine ou au Cambodge. Itinéraires d’un refus rend compte d’une trajectoire rien moins que linéaire, dont les différents ports d’attache sont autant de regards modestes, malicieux et révoltés portés sur le monde. [R.B.]
Itinéraires du refus, de Jorge Valadas
C’est un récit qui navigue entre les années 1950 et les tumultueuses « années 68 » comme on a coutume de les appeler désormais. Celui d’une vie, celle de Jorge Valadas, alias Charles Reeve, né à Lisbonne en 1945. « Naviguer » n’est pas un verbe usurpé pour évoquer ses « itinéraires » : du Portugal et des côtes africaines aux États-Unis, en passant par Paris. Car c’est bien la marine militaire que déserta le jeune Jorge Valadas en 1967 par refus de la guerre coloniale. Peut-être pas le premier refus, puisqu’il fut précédé d’une défiance juvénile envers la religion catholique et le régime fasciste de Salazar.
L’empreinte spectrale du communisme
La forme autobiographique est ici loin de la narration tatillonne. Valadas revendique d’emblée les mots de Zweig : « Seul ce qui se veut conserver pour nous-mêmes a quelque droit d’être conservé pour autrui ». Au gré de ses ressouvenances, place est donc donnée à l’enfance et l’adolescence de l’auteur, à son expérience de la famille, dans un Portugal où, malgré la dictature, l’empreinte spectrale du communisme et de l’émancipation fait parfois effraction dans le quotidien. C’est la matière des cent premières pages — et de ses vingt-deux premières années — dans lesquelles se forge sa rébellion contre l’ordre du monde.
Déserteur de l’armée coloniale, clandestin et révolté donc, Jorge Valadas arrive à Paris. Il y « fait » 68 (merveilleux chapitre « lutte de classe aux Folies Bergère »). Y découvre un marxisme extra-parlementaire et anti-autoritaire et « [passe] vite et avec plaisir, de Que faire de Lénine à comment faire sans Rosa Luxemburg ».
Exilés rebelles
En 1972, c’est peut-être la première traduction en portugais de Marxisme contre dictature, accompagnée d’une cargaison des Cadernos de Circunstância (revue lusophone d’obédience conseilliste) qu’une équipe, dont est Valadas, fera parvenir clandestinement à Lisbonne… par sous-marin !
À distance des partis et des organisations de l’extrême gauche, Valadas/Reeve publie aux Cahiers Spartacus. Il rencontre d’autres exilés rebelles comme lui : le trotskyste vietnamien Ngo Van, l’ancien membre du POUM Francisco Gomez dit « Paco ». Outre-Atlantique, il est reçu par les Mattick.
La révolution des Œillets de 1974-1975 lui permet de revenir au Portugal — où il ne se réinstalle pas. Au travers de ses allers-retours (la collection qui accueille le livre porte le beau nom de « Brûle-Frontières »), les derniers chapitres offrent une réflexion sur l’exil. Pour Jorge Valadas, « un chemin choisi » dans lequel puiser « éthique et force de vie ».
Théo Roumier – L’Anticapitaliste – 8 mai 2025
Retrouvez l’article sur le site de l’Anticapitaliste.
Souvenirs d’insubordination
En 1952, Jorge Valadas, jeune portugais de 17 ans, rencontre António Moreira au lycée. Sans le savoir, celui qui deviendra rapidement son meilleur ami va l’initier à la lecture, à la critique de la superstition religieuse et à la liberté. C’est que le grand-père Moreira, lecteur de la presse d’opposition, possède une bibliothèque interminable, peuplée, entre autres, d’ouvrages anticléricaux, qui fascinent le jeune Jorge. Issu d’une famille conservatrice, pour qui le pèlerinage annuel à Fátima va de soi, c’est la première fois que l’adolescent met les pieds dans « un espace non seulement ouvertement marqué par l’opposition au régime mais aussi libéré de ses signes ». Quelques années plus tard, entré à l’École navale, le jeune Jorge découvre avec effroi la guerre coloniale menée en Afrique par le Portugal de Salazar ; le lecteur vorace qu’il est ne peut s’empêcher alors de se comparer à Charles Marlow, le marin britannique protagoniste d’Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Si, quelques années avant, ce sont les livres de Moreira qui lui avaient décillé les yeux sur l’illusion religieuse (« Supplices, crucifixions, enfer décrit avec détails, blasphèmes, péché, expiation, la longue liste d’horreurs définit peu à peu la religion »), c’est, hélas, au tour des horreurs de la guerre coloniale de jouer ce rôle vis-à-vis de la patrie : « Entité mythique à l’usage des puissants. Le mot et la présence des drapeaux provoquent en moi des démangeaisons ». Quelques temps après, il prend la décision de déserter : partir, affirme-t-il, c’est, « justement, refuser le système de la peur, faire un pas de côté ». Le voilà à Paris, où il va connaître la dureté de l’exil, bientôt adoucie par le parfum sulfureux de Mai 68 et la fréquentation du groupe de Cadernos de Circunstância, revue marxiste antiautoritaire qu’il contribuera à diffuser clandestinement au Portugal moyennant ses contacts dans la marine. Voyageur infatigable, Jorge, âgé de 25 ans, part pour les États-Unis, où il fait notamment connaissance avec Paul Mattick, figure majeure du marxisme antistalinien, avant de retourner en France et de rejoindre une Lisbonne en liesse. Enivrée par la révolution des Œillets récemment éclatée, la capitale grouille de collectifs dont les différences politiques se font jour : faut-il que les déserteurs intègrent l’armée pour renforcer l’appareil militaire d’un éventuel État révolutionnaire ou doivent-ils plutôt se tenir aux côtés du mouvement social naissant, ferment d’un désir d’autonomie et d’autogestion… ?
Itinéraires du refus, paru en mars 2025 chez Chandeigne & Lima, est un très beau récit initiatique. S’y mêlent la perte de l’innocence et l’entrée dans le monde des adultes, le bouleversement provoqué par les premiers émois sensuels et la découverte des différences de classe ; l’émancipation vis-à-vis de la figure paternelle côtoie les questionnements existentiels ; les hésitations politiques se mélangent à la douleur du déracinement, la révolte à la crainte de la répression. L’Histoire avec un grand H et l’histoire de Jorge Valadas se tiennent par la main et deviennent ici inséparables, scellant à leur tour les itinéraires individuels au destin collectif. L’histoire qui nous occupe, celle qui s’écrit en minuscules, est celle d’un jeune homme qui, refusant l’ignoble – la peur, la bigoterie et la guerre – décida de tordre le cou à cet état des choses et prendre le chemin de l’émancipation pour préserver sa dignité, malgré les risques. Refuser, nous enseigne Valadas, devient nécessaire lorsque l’on veut « nous faire sortir de l’humanité ». À l’adresse de ceux qui, de peur de tomber dans le vide, préféreront ne pas franchir le pas, il conclut, optimiste : « L’histoire ne nous est pas donnée d’avance et c’est pourquoi elle est toujours riche en rebondissements. »
Équipe de la librairie – feuille de Quilombo n° 9
Louvor das deserções
As memórias de uma vida, em particular quando são encaradas sem complacência e têm como geografia histórica paisagens da opressão, podem suscitar narrativas centradas numa busca em que se trata de tentar compreender o lugar do indivíduo na complexa teia daquilo que simultaneamente faz e desfaz a sua individualidade.
Jorge Valadas é sobejamente conhecido dos leitores do MAPA, como colaborador deste jornal e como autor de livros aqui discutidos, com o seu nome português e com o seu pseudónimo literário internacional, Charles Reeve[1]. É também colaborador, desde há muito, de outras publicações libertárias portuguesas (A Batalha, Utopia, Coice de Mula, A Ideia, Flauta de Luz…) e de jornais e revistas de outros países, estes em grande número.
Itinéraires du refus, sendo um livro de memórias, é ao mesmo tempo uma meditativa obra de reflexão que abarca um amplo conjunto de temas, temas estes que não se limitam ao plano descritivo das suas particularidades, antes trazendo à superfície o que em cada um deles se encontra imerso em labirintos de incompreensão, mistério, enigma ou insistentes sombras. Curiosamente, a sociedade portuguesa que se expõe neste livro já terá, em parte, desaparecido, mas, se virmos bem, ela continua presente – porque Jorge Valadas não a aborda pela rama. No plano das intimidades, quer se trate da infância, da adolescência, da idade adulta, das relações paternais, maternais, filiais, escolares, amistosas, amorosas ou laborais, na sua necessária descrição circunstancial emergem sempre, intrinsecamente involucradas, as interrogações e perplexidades, os porquês e os comos desses «fenómenos» que fazem que o indivíduo nunca esteja sozinho na sua relação com o mundo, que a sua individualidade aja sempre em contextos em que intervêm outros. É notório neste livro que, pela sua formação político-filosófica e experiência humana dos ambientes laborais e libertários internacionais, Jorge Valadas tem sempre presente a sociabilidade, inclusive nas suas interrogações mais íntimas.
Embora sendo um livro de memórias, esta obra tem uma arquitectura narrativa que não obedece a uma cronologia linear, o que faz dela, mais propriamente, um inventivo empreendimento literário não ficcional[2]. Indicam-no os títulos dos capítulos, por vezes enigmáticos, e sobretudo a sua “desordem” temporal; remetendo mais para os conteúdos temáticos do que para o seu alinhamento cronológico, num vaivém que acentua a dimensão reflexiva e literária do texto. E também a ironia de que a narrativa está impregnada. Sublinham-no ainda as muito diversas citações em início de capítulo, que vão de Stefan Zweig a Michael Ondaatje, passando por Ferreira de Castro ou a pintora Vieira da Silva.
Mas este livro está também cheio de episódios, ocorrências, aventuras, coisas festivas, truculentas, dramáticas e às vezes espantosas de que a vida em Portugal e no exílio foi feita. A visão de Valadas, complexa nas interacções das suas personagens, que são pessoas reais, procura sobretudo compreender o que leva cada uma delas a agir como age, mesmo quando ele próprio discorda desse agir.
“Nómada” em Portugal por força das circunstâncias familiares (o pai, professor e alma insatisfeita, mudava com frequência de escola), percorreu o país na infância e na adolescência, perdendo nesse trânsito colegas e amigos, e inscrevendo-se assim, do mesmo passo, num certo isolamento e solidão que o levou muito cedo a tornar-se um ávido leitor. E um atento (e muitas vezes atónito) observador das contradições sociais e mentais com que deparava nas suas próprias vivências.
No entanto, nesta amplitude e diversidade temática há duas questões que sobressaem, a total rejeição da guerra (da guerra colonial, no caso vertente) e o exílio. Ambas estas questões levam-no a apresentar um retrato particularmente penetrante da sociedade portuguesa entre a década de 1950, quando, ainda criança, começou a observá-la, e os nossos dias. Ao referir-se aos “exílios diversos e variados”, caracteriza certeiramente o fosso que separava (separa) os que “eram contra o regime” mas “não eram contra a sociedade” dos que encaravam (encaram) a sociedade como emanação do “estado de coisas”. Porque é deste última que se trata, e não só do regime, nas muitas partes deste livro dedicadas a expor interrogativamente as estruturas normativas vigentes em Portugal, que, como sabemos, não foram abolidas com a reimplantação da democracia formal.
Desertor da marinha de guerra e internacionalista (marca visível no seu pseudónimo), Jorge Valadas revela neste livro, além de uma invejável capacidade memorialista, um modo de ver e interpretar proveniente da lucidez criada pelo espírito de revolta, que nele permanece desde a juventude.
Júlio Henriques – MAPA – abril – junho 2025
[1] Último livro publicado em português (também no Brasil): Charles Reeve, O Socialismo Selvagem – Ensaio sobre a auto-organização e a democracia directa nas lutas de 1789 até aos nossos dias, tradução Luís Leitão, Antígona, 2019.
[2] Não por acaso saiu pelas Éditions Chandeigne & Lima, onde têm sido publicados autores como Mia Couto, Isabela Figueiredo, Miguel Torga, João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, e também o cineaste José Vieira, este último antecedendo Jorge Valadas na colecção “Brûle Frontières”.