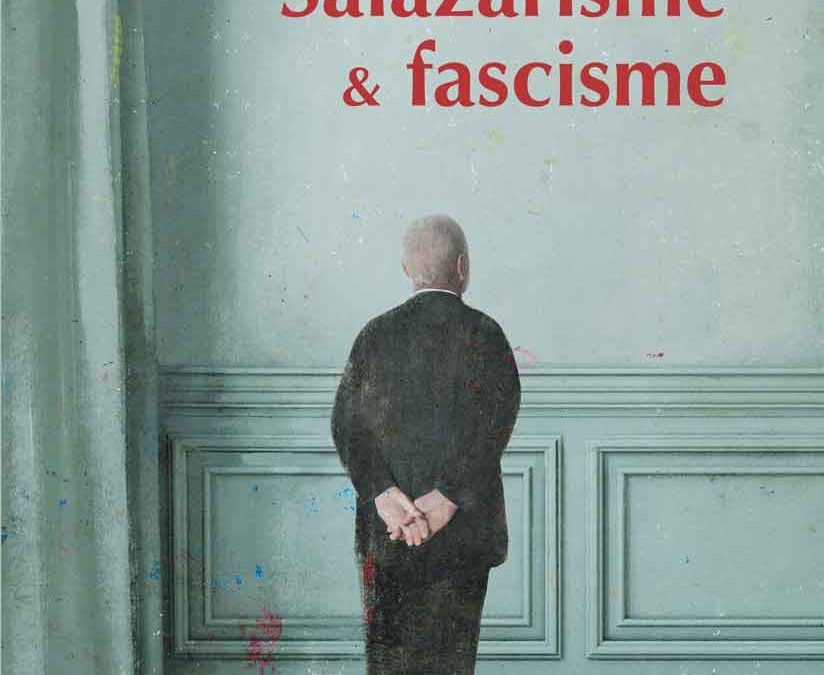Ce dimanche 26 juillet 2020, moins d’une centaine de personnes est réunie dans le petit cimetière de Vimieiro, le village natal de Salazar où celui-ci repose depuis son décès cinquante ans plus tôt, le 27 juillet 1970, à l’âge de 81 ans. « L’association pour l’histoire de l’État nouveau » (ASHENO), créée en 2016 et présidée par un général d’aviation à la retraite, Vizela Cardoso, a préparé depuis plusieurs semaines cet hommage à « Salazar, l’homme d’État », comme le souligne l’intitulé de la conférence de clôture. Cet hommage n’a rien d’officiel, orchestré au cimetière de Vimieiro et à Santa Comba Dão, pour la messe et les discours, par un cercle d’admirateurs – « volontairement restreint » ont tenu à préciser les organisateurs dans le contexte de crise sanitaire. Il s’inscrit clairement dans une logique de réhabilitation assumée par cette association ASHENO dont le président rappelle alors l’objectif de « découvrir la vérité sur ce qui s’est passé sous Salazar », se déclarant favorable à la création d’un « musée d’interprétation de l’Estado Novo ».
Ce projet de « Musée Salazar », vieux d’une bonne dizaine d’années, relancé en 2019 par la municipalité de Santa Comba Dão comme « musée interprétatif » et pédagogique, inséré dans un réseau de musées visant à développer le « tourisme culturel » autour de Viseu, a suscité une levée de boucliers avec une pétition, initiée par « l’Union de résistants antifascistes portugais » (URAP), qui a recueilli plus de 11 000 signatures, dénonçant le manque de rigueur scientifique de ce projet et son caractère « saudosista » susceptible d’en faire un lieu de culte pour nostalgiques du régime salazariste. En décembre 2020, cette pétition a provoqué un débat à l’Assemblée de la République. Le Parti socialiste, majoritaire mais dont son propre député de la circonscription de Viseu – celle où se situe la municipalité de Santa Comba Dão, également socialiste – était au départ plutôt favorable au projet, en a souligné le caractère « imprudent dans un contexte, tant européen que national, où nous assistons à l’efflorescence d’éléments et d’idéologies nationalistes de nature totalitaire ». Le Parti communiste et le Bloc de Gauche ont dénoncé une « trahison de la mémoire des milliers de Portugais et Portugaises qui ont lutté contre le régime », un député du PC déclarant que « l’histoire de ce qu’a été l’État nouveau ne se fait pas en créant des lieux de rassemblement de nostalgiques du passé, mais en célébrant la mémoire de ceux qui ont résisté. » Quant au PSD et au CDS (centre-droit/droite), après avoir mis en garde contre les dangers inhérents au nom et au lieu, ils relèvent « qu’il y a des parents qui méritent que l’on sache ce qu’a été l’État nouveau et des enfants qui ont besoin de le connaître » (PSD), allant même jusqu’à déclarer, comme une députée du CDS, que « vouloir effacer l’histoire est un acte antidémocratique. » Quant au Centre d’études interdisciplinaires du XXe siècle (CEIS20) de l’Université de Coimbra, « caution scientifique » de ce projet de réseau de « musées et lieux de mémoire sur la République et l’Estado Novo » dans la région des Beiras, il a annoncé mi-février 2021 qu’il renonçait au projet, alléguant des « différends avec les municipalités ».
Utilisant une rhétorique, chère aux droites radicales, visant à « révéler la vérité historique », « dénoncer la falsification de l’Histoire » et « briser un tabou », la volonté de réhabilitation portée par l’ASHENO et son président, est celle exprimée depuis des années par des hommes comme Jaime Nogueira Pinto – auteur en 2007 d’un Salazar, l’autre portrait – et António da Silva Teles, le dernier secrétaire particulier de Salazar (de mars 1967 à septembre 1968) qui, dans un témoignage publié en 1993 à la fin d’un recueil de souvenirs (Salazar visto pelos seus próximos), résumait Salazar en un mot, « sérénité », avant de lui rendre hommage « anticipant la justice que l’Histoire lui rendra. »
Bien qu’âgé de 84 ans, António da Silva Teles a tenu à être au premier rang ce dimanche 26 juillet 2020. C’est d’ailleurs une des rares personnalités à avoir fait le déplacement à Santa Comba Dão. Les journalistes relèvent seulement la présence de José Pinto Coelho, président, depuis 2005, du parti d’extrême-droite PNR (Parti national rénovateur) qui vient d’être rebaptisé « Ergue-te » (« Lève-toi »). En perte de vitesse depuis les législatives de 2015, où il a réalisé son meilleur score (44 000 voix, soit 0,5 %), le PNR s’est fait voler la vedette par le nouveau parti « Chega » (« Ça suffit ») et son leader André Ventura qui, en pleine préparation de sa campagne présidentielle, n’est pas à Vimieiro, ni à Santa Comba Dão, ce dimanche 26 juillet. Absence guère étonnante au regard du positionnement d’André Ventura qui, tout en empruntant allègrement au discours et à l’imagerie du salazarisme, avec en toile de fond châteaux médiévaux, récit national et grands hommes des quelques « huit siècles d’histoire nationale », déclare quelques semaines plus tard que « la plupart du temps, Salazar n’a pas résolu les problèmes du pays et nous a beaucoup retardé à maints égards. Il ne nous a pas permis d’avoir le développement que nous aurions pu avoir, surtout après la Seconde Guerre mondiale. » Et d’ajouter « pas besoin d’un Salazar à chaque coin de rue, il faut un André Ventura à chaque coin de rue. »
En un sens, recours à « l’homme providentiel » en plus, Ventura rejoint les propos tenus en janvier 2019 par le vice-président du PNR (« Ergue-te »), João Pais do Amaral : « Salazar a été grand parce qu’il n’avait pas besoin d’autres références : il était lui-même sa propre référence. Il a su interpréter les signaux de son temps et, à sa manière, fut le précurseur d’une idée, d’un idéal et d’un régime avec toutes ses bonnes et ses moins bonnes choses (…) Aussi, nous n’avons pas besoin d’un « nouveau Salazar » ! Nous avons besoin d’un nationalisme actuel, qui ne dépende pas d’un supposé homme providentiel. »
L’assistance réduite en ce 26 juillet 2020 à Vimieiro doit peu au contexte sanitaire, mais bien à cette « mémoire ambiguë » qui entoure Salazar. « Personnalité historique la plus marquante du Portugal », à en croire un sondage fort peu scientifique réalisé en 2007 par la chaîne de télévision publique RTP – loin devant Alvaro Cunhal, Aristides de Sousa Mendes et les navigateurs Vasco de Gama ou Cabral –, Salazar est un bon produit éditorial au Portugal, où se sont multipliés ces dernières années des ouvrages aux qualités inégales faisant figurer son nom dans le titre, révélant l’intérêt prononcé d’un public assez large pour le personnage. Mais sans susciter pour l’heure une biographie de référence, depuis la somme hagiographique en six volumes publiée entre 1977 et 1985 par Franco Nogueira (1918-1993), dernier ministre des Affaires étrangères de Salazar. Et ce, malgré l’accès relativement aisé aux sources d’archives, notamment le fonds Salazar aux Archives nationales de Torre do Tombo (ANTT/AOS), et le nombre de travaux universitaires de qualité consacrés à l’Estado Novo depuis le milieu des années 1980. Après la biographie politique de l’historien Filipe Ribeiro de Meneses en 2009, la plus récente, publiée en juillet 2020 – cinquantième anniversaire du décès de Salazar oblige –, celle du politiste britannique Tom Gallagher, ouvrage de commande rédigé en une année, « n’apporte pas de nouvelles connaissances et reprend sans esprit suffisamment critique des écrits de non-universitaires cherchant avant tout à réhabiliter la figure du dictateur », comme l’a relevé l’historien Victor Pereira.
Rhétorique de l’invisibilité
La « mémoire ambiguë » de Salazar, empreinte à la fois de cette image, teintée de nostalgie chez certains, « d’éminente personnalité historique portugaise » et d’une visibilité relativement faible sur la scène publique, renvoie à cette « rhétorique de l’invisibilité » consubstantielle à Salazar, décryptée par le philosophe José Gil dans un court essai stimulant publié il y a plus de vingt-cinq ans. Piètre orateur, reconnaissant lui-même ne pas savoir parler ni écrire pour un large public – « quand je m’adresse à six mille personnes, c’est comme si j’en avais six devant moi » –, même s’il avait le don de capter et de dire l’essentiel en quelques mots compréhensibles de tous – ce qu’il appelait « l’intuition profonde » –, le professeur Salazar s’exprimait en public en lisant froidement des textes soigneusement écrits et démonstratifs, cherchant à gagner en intelligibilité et en profondeur ce dont ses discours manquaient tant en termes d’émotions et de passion. L’efficacité de cette rhétorique de « l’écrit-lu », y compris à la radio, jamais apprivoisée depuis sa première allocution en décembre 1934, visait non pas à susciter l’enthousiasme des masses, mais, en faisant appel à la raison et à la logique sur un plan narratif, à convaincre un public composé de milliers de consciences individuelles communiant séparément avec Salazar.
Grâce à la propagande et par la pédagogie, avec le soutien zélé de la hiérarchie catholique et celui, plus musclé, de cette administration de la peur incarnée par la police politique, l’arbitraire et la censure, Salazar entendait modifier les mentalités et les « mauvaises habitudes » prises par ses compatriotes durant plusieurs siècles de « dégénérescence », en les faisant passer de la vulnérabilité et du désordre, identifiés à la République d’avant le coup d’État militaire du 28 mai 1926, à une « régénération » du corps national grâce à l’action de l’Estado Novo et de son chef, avant d’atteindre un nouvel âge d’or de la grandeur mythique de la nation et, in fine, le salut. Le tout devait advenir sur un fond de morale chrétienne, basé sur un esprit de sacrifice empreint de respect des traditions, de privations de liberté et de renoncement, pour éviter que l’ordre établi soit perturbé – le célèbre « Vivre à l’accoutumée », traduction de « Viver habitualmente », délivré en 1938 à l’écrivain maurrassien Henri Massis –, afin, déclarait Salazar, de pouvoir « gravir la colline de la rédemption. »
Être le moins visible possible, à l’instar d’un Salazar rechignant, par nature et par calcul, aux apparitions publiques pour mieux cultiver l’image d’un « moine-dictateur », solitaire et inlassablement au travail dans son bureau monacal, être anonyme et quasi invisible, tel était l’objectif que le régime assignait aux Portugais en tant qu’individus, seule la nation – « Tout pour la nation, rien contre la nation » déclarait Salazar dès 1929 –, régénérée par l’esprit de sacrifice, ayant vocation à accéder à la visibilité. « Constatant l’irruption de ces trois syllabes, Sa-la-zar, dans la conscience de la nation, interrogeons-nous : qui est Salazar ? Un Mussolini, un dictateur du type du Prince de Machiavel, un dominicain, un franciscain ? Ou plutôt, simplement, hypothèse plus acceptable, un homme d’État, un simple mais grand comptable des âmes et des budgets ? Existerait-il cet homme froid, distant, insensible, peu sociable ? Qui nous gouverne ? Une réalité ou une ombre ? » : en questionnant ainsi en 1932 son modèle dont il construira bientôt l’image, comme directeur du Secrétariat à la propagande nationale (de 1933 à 1949), António Ferro eut tôt fait de comprendre que cette invisibilité voulue par Salazar et savamment construite allait être le meilleur moyen de faire ressentir partout la présence invisible du « grand comptable des âmes et des budgets. »
À l’ère des chaînes d’information en continu et des réseaux sociaux, cette « rhétorique de l’invisibilité » incarnée jusqu’au bout par Salazar, qui retardera l’implantation de la télévision au Portugal à la fin des années 1950 et restera viscéralement méfiant à l’égard des médias, aurait de quoi détonner par son anachronisme et son manque de modernité3. Ce régime salazariste souvent désigné comme « hydride » – Manuel de Lucena parlait de « hibridismo » en 1976, tout en qualifiant le salazarisme de « fascisme sans mouvement fasciste » –, résistant à toute définition claire, entre État totalitaire et État de droit, État laïc ou religieux, fut construit par Salazar pour cultiver ce mythe de la solitude, de l’austérité, du labeur incessant, fidèle en cela à certaines traditions royales ibériques voulant que le roi apparaisse le moins possible afin d’entretenir le mystère du pouvoir et de l’autorité. Sorte de régent in absentia du roi, président du Conseil à vie, Salazar a pu considérer le régime de l’Estado Novo comme une monarchie sans roi, écartant toute idée de restauration depuis le décès en 1932 de D. Manuel II, exilé en Angleterre depuis le 5 octobre 1910 et l’instauration de la République. Contrairement à Franco, Salazar n’a jamais voulu être chef de l’État, préférant y placer un militaire de haut rang et promouvoir de fait « un présidentialisme du président du Conseil. » Il savait aussi qu’il ne pourrait jamais faire avec un roi ce qu’il fit plus tard, en 1958, avec le général Craveiro Lopes, le remerciant de son dévouement en lui indiquant vertement la porte de sortie du palais présidentiel de Belém.
Salazar a pu tolérer au Portugal la présence du prétendant au trône D. Duarte Nuno, duc de Bragance. Mais il l’a contraint à en exil silencieux à Coimbra, sous bonne garde de la police politique. En 1951, après la mort du chef de l’État, le général Carmona, le Conseil d’État envisagea un temps la restauration de la monarchie ou la remise de la présidence de la République à Salazar lui-même, hypothèses que celui-ci écarta.
Cette indétermination du régime autorisait une interprétation « plurielle et pragmatique » des actes relevant de la conscience morale de chacun, elle-même étroitement subordonnée à la conscience nationale dont Salazar se considérait le seul porte-parole, « par intuition profonde du peuple. » Le célèbre pentaptyque du discours prononcé par Salazar le 28 mai 1936 à Braga, pour le 10e anniversaire de la « Révolution nationale », éclaire cette logique de l’invisibilité, en affirmant le caractère indiscutable du principe spirituel placé en tête de ses cinq « grandes certitudes » : « Nous ne discutons pas Dieu et la vertu ; nous ne discutons pas la Patrie et son histoire ; nous ne discutons pas l’autorité et son prestige ; nous ne discutons pas la famille et sa morale ; nous ne discutons pas la gloire du travail et son devoir. »
Ce « Dieu, patrie, autorité, famille, travail » a souvent été repris et adapté par d’autres régimes jusqu’à nos jours, le plus souvent sous la forme d’un triptyque, du « Travail, famille, patrie » du régime de Vichy au « Dieu, patrie, famille » de l’Action intégraliste brésilienne et de Jair Bolsonaro. Dans le pentaptyque salazariste, le caractère non-discutable de Dieu, en plaçant le spirituel d’abord, légitimait ainsi le caractère non-discutable de la patrie, de l’autorité, de la famille et du travail. L’invisibilité et le silence du chef s’imposant à tous, chaque individu, chaque groupe se trouvait donc condamné au silence, sous peine d’exclusion. « Aucun moyen d’échapper à un tel système de production d’invisibilité et de silence : nous étions condamnés à nous taire », comme l’a relevé le philosophe José Gil.
Les séquelles laissées dans la société civile portugaise par cette « rhétorique de l’invisibilité » implacable sont nombreuses en termes notamment de participation politique ou d’accoutumance aux discours et pratiques austéritaires, comme entre 2011 et 2015 avec la chape de plomb imposée par la Troïka et les autorités gouvernementales pour contraindre le Portugal à « ne pas vivre au-dessus de ses moyens. » Ces legs du salazarisme sont préoccupants à l’ère du discrédit dont se nourrit le « pouvoir grotesque », au sens où l’entendait Michel Foucault dans son cours au Collège de France en 1975-1976 : « J’appelle grotesque le fait qu’en raison de leur statut, un discours ou un individu peuvent avoir des effets de pouvoir que leurs qualités intrinsèques devraient disqualifier. » Cette nouvelle forme de pouvoir fait assurément plus appel à « l’irrationalité, à la transgression et à la bouffonnerie » qu’à « la rationalité, à la tradition ou au charisme chers à Max Weber.4 » Et, dans le cas portugais, ce « pouvoir grotesque » incarné notamment par Chega et André Ventura, ne fait guère référence à la « rhétorique de l’invisibilité » chère à Salazar, tout comme un Jair Bolsonaro au Brésil, un Matteo Salvini en Italie ou un Donald Trump aux États-Unis, les trois modèles et sources d’inspiration d’André Ventura qui ont fait de la célèbre formule d’Henry Ford, « l’histoire est une blague », une politique.
Pour autant, si le champ lexical, la rationalité et la personnalité de Salazar n’ont rien en commun avec un André Ventura – « Bolsoluso » –, ou un Jair Bolsonaro – « Bolsomito » – qui doivent tant aux réseaux sociaux et à leurs algorithmes, « le vieux monsieur de Lisbonne au visage fin et aux cheveux blancs », ce « personnage glacial et guindé de dictateur de cabinet », décrit à la une du journal Le Monde le 28 juillet 1970, continue, ici et là, d’être une source d’inspiration, sinon d’admiration.
« Waiting for Salazar »
L’image de probité accolée à Salazar est certainement la plus utilisée par celles et ceux qui, à l’extrême-droite, ont fait de la dénonciation de la corruption un outil d’ostracisme et d’accession au pouvoir permettant de manipuler l’opinion via les fake news et les réseaux sociaux, d’adosser l’opprobre moral à la justice et de réprimer avec l’armée. L’exemple brésilien l’a clairement montré avec la séquence allant de la destitution de Dilma Rousseff en 2016 à l’emprisonnement de Lula et l’élection de Jair Bolsonaro en 2018, que son principal adversaire, Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs, avait d’ailleurs comparé à Salazar pendant la campagne électorale dans une interview pour la chaîne de télévision portugaise TVI. Partageant avec Salazar la même haine des « rouges » et le même attachement aux « valeurs traditionnelles », Bolsonaro tiendra d’ailleurs dans son discours d’investiture en janvier 2019 des propos d’inspiration salazariste : « Unissons les gens, valorisons la famille, respectons la religion, notre tradition judéo-chrétienne, combattons l’idéologie du genre en conservant nos valeurs. Le Brésil redeviendra un pays sans entraves idéologiques.»
L’image de probité accolée à Salazar est certainement la plus utilisée par celles et ceux qui, à l’extrême-droite, ont fait de la dénonciation de la corruption un outil d’ostracisme et d’accession au pouvoir permettant de manipuler l’opinion via les fake news et les réseaux sociaux, d’adosser l’opprobre moral à la justice et de réprimer avec l’armée.
Probité proclamée donc, mais aussi révérence à « la sagesse » et à la « grandeur d’âme » de « l’homme d’État » Salazar. Véritable mantra des admirateurs de Salazar depuis les années 1930, cette révérence envers l’homme d’État reste encore très présente. Au Portugal même, en forme de nostalgie chez certains – au-delà de « Chega », du PNR et de groupuscules identitaires comme « Nova Portugalidade », « Nova Ordem Social », ou « Escudo Identitário » – pour « les trains qui arrivent à l’heure », en faisant l’apologie de cette « splendeur du Portugal » nourrie d’un roman national construit par l’Estado Novo autour de l’épopée des « Découvertes », de la prise de Ceuta en 1415, à Salazar, réincarnation de cet Infant Henri (1394-1460), « le Navigateur », célébré en 1960 avec l’inauguration du « monument des Découvertes » au bord du Tage à Belém. Monument aujourd’hui contesté – un député vient d’ailleurs de réclamer sa destruction –, il est en 1960 reconstruit sur le modèle de celui édifié en 1940 – et détruit en 1943 – pour « l’Exposition du Monde portugais », dont l’essayiste et philosophe Eduardo Lourenço, récemment disparu, a écrit « qu’en apparence hors du temps, conçue comme une messe à la gloire de notre vocation colonisatrice et missionnaire, elle n’a eu d’autres spectateurs que nous-mêmes. »
Construit autour des « huit siècles d’indépendance », ce récit national est tout entier imprégné du mythe « d’un pays aux mœurs douces », sans se soucier de la brutalité consubstantielle au salazarisme, en métropole et outre-mer, ni trop se pencher sur un long passé colonial empreint de racisme, sur fond d’esclavage, de traite négrière et de travail forcé, masqués par la fiction juridique d’un Portugal pluri-continental, « du Minho à Timor », couplée au mythe du lusotropicalisme entretenu par un régime célébrant les vertus fantasmées du métissage et d’une « colonisation à nulle autre pareille » pour mieux justifier une présence outre-mer devenue anachronique dans les années 1960.
Cette question de la violence d’une dictature souvent perçue à l’étranger comme bénigne, en raison du nombre relativement faible de ses victimes – autour de 30 000 personnes arrêtées, emprisonnées ou éliminées entre 1933 et 1974 –, a fait l’objet d’une instrumentalisation par ceux qui s’abritent derrière ces chiffres pour mieux tempérer, sinon innocenter, le salazarisme à l’aune des crimes de masse perpétrés par le franquisme notamment. Perception erronée qui fait peu de cas des déportations et morts violentes d’opposants (camp de Tarrafal au Cap-Vert notamment), des exils forcés, de la répression brutale des grèves et manifestations (création en 1937 d’une police anti-émeutes) et de la torture. Le tout sur fond d’impunité de la police politique, devenue PIDE en 1945, dont furent victimes – et parfois complices – de très nombreux Portugaises et Portugais, avec un système de surveillance très étendu visant à gouverner préventivement par la peur. Cette violence, tout comme celle liée au racisme colonial, constitue un autre legs particulièrement lourd et encombrant du salazarisme.
La révérence au « grand homme d’État » est également très présente à l’étranger. Côté français bien sûr, traditionnellement depuis les années 1930 auprès d’une partie des élites des droites conservatrices et radicales pour lesquelles Salazar incarne une figure singulière de Chef « sage », « rationnel », « au service de la défense de l’Occident », l’âme d’une « dictature de l’intelligence » pour citer Henri Massis. Ce « philosalazarisme » français, composite, a recruté principalement au sein des droites nationalistes et traditionalistes, en premier lieu de nombreux maurrassiens, comme Henri Massis et Jacques Bainville, ainsi que d’anciens maurrassiens, comme Michel Déon, parfois passés par le gaullisme, comme Gilbert Renault (le colonel Rémy de la résistance), dans les années cinquante. Avec pour figure de proue, Jacques Ploncard d’Assac (1910-2005), ancien de l’Action française, disciple de Maurras et collaborateur antimaçonnique qui s’exile au Portugal en 1944 où il reste jusqu’à la Révolution des œillets d’avril 1974, conseillant Salazar ici et là, véritable propagandiste du salazarisme en France, animateur de « La voix de l’Occident » sur les ondes de la radio portugaise. Disciple de Salazar auquel il voue un véritable culte, il le considère jusqu’à la fin comme « la conscience de l’Occident ». La revue Lectures françaises, fondée en 1957 par le journaliste Henry Coston, collaborateur et antisémite notoire, a ainsi rendu en 2020 un hommage appuyé à Ploncard d’Assac, pour le 110e anniversaire de sa naissance, avant de consacrer son numéro de septembre dernier au dictateur portugais, avec un long article dithyrambique « Comment relève-t-on un État, Monsieur Salazar ? »
C’est d’ailleurs sous cet angle du relèvement de l’État et de la modernisation que la postérité de Salazar et du salazarisme semble se montrer aujourd’hui la plus féconde. Dès les années 1930, des hommes comme Émile Schreiber (1888-1967) – Émile Servan-Schreiber après la résistance, le père de Jean-Jacques et Jean-Louis Servan-Schreiber – lui rendent un hommage appuyé pour le bilan économique et financier de la politique de l’Estado Novo qui « en moins de dix ans, a rétabli la paix sociale, redressé les finances, stabilisé la monnaie, moralisé et modernisé l’administration. » Après avoir longuement interviewé Salazar à Lisbonne, ce journaliste économique publie en 1938 chez Denoël Le Portugal de Salazar qu’il définit comme une « dictature tempérée », dressant un portrait élogieux du dictateur qui « n’est pas plébéien et encore moins condottiere », « bien différent d’un politicien de carrière », avant tout « un intellectuel et un homme d’action », « un Marc-Aurèle moderne ». Comparant sa politique à celle de Poincaré en France, Émile Schreiber voit dans l’expérience salazariste « un gouvernement des hommes compétents, des techniciens » – on ne parle pas encore de technocrates –, dont « l’originalité est d’avoir concilié l’autorité et la mesure ». Loin du traditionnalisme des droites conservatrices et radicales, ce qui séduit avant tout Émile Schreiber est cette « volonté modernisatrice visant à sortir le pays de l’archaïsme économique et social », saluant notamment les « réalisations précorporatives » et la création précoce, en mai 1935, d’un Institut national de la statistique, destiné selon son premier directeur, à mettre de « l’ordre et de la raison, pour tirer le gouvernement de l’empirisme dans lequel nous étions tombés. » Sorte de mélange de « stabilisation à la Poincaré » et de « réforme de l’État à la Tardieu », Salazar incarne alors celui qui a réussi une « modernisation conservatrice », un expert économique et financier encensé à la fois pour son orthodoxie financière et sa modernité.
Cette vision positive du qualificatif « Novo » d’un Estado Novo perçu avant tout comme un « gouvernement des hommes compétents, des techniciens » s’est prolongée jusqu’à nos jours. Elle est déjà présente à l’été 1938 lors du colloque Walter Lippmann à l’origine du néolibéralisme. Son organisateur, le philosophe Louis Rougier, auteur la même année de Comment l’on passe des démocraties libérales aux États totalitaires, s’est intéressé de près au Portugal de Salazar, où il salue « la très grande ferveur populaire » d’un « régime extrêmement autoritaire ». Comme l’a souligné avec justesse Jean Solchany, « la dénonciation des masses et la fascination pour l’autorité ne sont pas rares dans les milieux libéraux et conservateurs, en pleine crise du parlementarisme ». Un Wilhelm Röpke fait ainsi référence à Salazar et Henri Massis, alors qu’en Suisse, la très libérale revue Neue Zürcher Zeitung se déclare pro-salazariste. Autre figure marquante de ce colloque Lippmann, l’économiste Louis Baudin prononce à Lisbonne en février 1939 une conférence sur le redressement financier du Portugal, où il fait l’éloge du sous-gouverneur de la Banque du Portugal.
Plusieurs figures éminentes du néolibéralisme, comme Friedrich Hayek, ont apprécié Salazar, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans la lutte de celui-ci contre les « abus de la démocratie », avec l’idée que la démocratie néolibérale ne peut être que limitée, Hayek allant même jusqu’à une dénonciation de la démocratie. Avant de se tourner vers le Chili de Pinochet en 1973, c’est à Salazar que Friedrich Hayek s’adresse au début des années 1960 en lui faisant parvenir un exemplaire de The Constitution of Liberty qu’il a récemment publié. Dans la lettre qu’il lui écrit le 8 juillet 1962, il forme l’espoir que « cette esquisse préliminaire de nouveaux principes constitutionnels puisse l’aider dans ses efforts de concevoir une constitution protégée des abus de la démocratie. » Son idée, qu’il précisera plus tard, est bien de concentrer « le pouvoir entre les mains d’une élite soigneusement sélectionnée, à l’abri de l’influence des masses », avant d’ajouter que « tout progrès doit être basé sur la tradition. » Autant de pistes que n’aurait pas renié le salazarisme pour penser « l’alternative à la démocratie illimitée » et dessiner les contours actuels d’un autoritarisme politique néolibéral cherchant, comme au Brésil depuis le coup d’État constitutionnel contre Dilma Rousseff, à « gouverner en s’affranchissant de tout contrôle parlementaire ou constitutionnel. »
Cette modernité toute technocratique de Salazar n’a pas échappé à l’internationale des conservateurs qui communie de longue date dans l’anticommunisme et la défense des valeurs traditionnelles de la civilisation chrétienne. Sa frange « paléo-conservatrice » nord-américaine vient ainsi d’appeler de ses vœux un nouveau Salazar dans un article publié dans le numéro de janvier dernier de The American Conservative, magazine mensuel d’opinion fondé en 2002 par Pat Buchanan, ancien conseiller des présidents Nixon, Ford et Reagan. Sous le titre « Waiting for Salazar » (« Waiting for our Salazar », dans une première version), Michael Warren Davis, rédacteur-en-chef de Crisis Magazine et auteur de The Reactionary Mind. Why Conservative Isn’t Enough (à paraître en 2021) y décrit le salazarisme comme un « traditionnalisme paternaliste » et Salazar comme un « modéré », faisant l’éloge de la biographie The Dictator who refused to Die, publiée par Tom Gallagher en 2020. Et de conclure : « Si nous, Américains, n’avons pas la discipline nécessaire pour le self-governement, si le libéralisme n’est plus d’actualité, la seule alternative possible à un tyran comme Lénine ou Hitler pourrait être un homme comme Salazar : un traditionnaliste paternaliste, un roi-philosophe. »
Cet article a suscité de nombreuses réactions critiques, y compris au Portugal, qui soulignent à juste titre approximations et erreurs factuelles. La National Review, autre magazine conservateur, fondé en 1955, répond dès le 28 janvier en présentant Salazar comme un « dictateur brutal et non un sauveur », s’étonnant d’un tel « effort pour blanchir son histoire. » Pour erroné qu’il soit, l’article de The American Conservative est révélateur d’un regain d’intérêt pour Salazar qui ne laisse pas d’être préoccupant avec le retour des dictatures sous la forme de ces « régimes hybrides » ou « autoritarismes compétitifs » qui, « tout en organisant des élections et accordant une existence légale à divers partis, trouvent de nouveaux moyens pour fausser les résultats électoraux, réprimer la citoyenneté et contrôler la communication sociale. »
Comment expliquer un tel regain d’intérêt ? En ces temps épris de populisme, le pas pris sur une histoire savante, critique mais confidentielle, par un récit national plus grand public, entretient cette connaissance encore très lacunaire du régime salazariste qui tend à ériger « l’homme d’État Salazar » en héraut des « vertus nationales » séculaires et de la « splendeur du Portugal. » La perception traditionnellement périphérique du Portugal – « il était une fois un petit pays, vestige à demi ruiné d’un grand empire d’autrefois », écrivait Rudyard Kipling en 1896 – couplée à cette « rhétorique de l’invisibilité » cultivée par Salazar confèrent une apparente innocuité à ce singulier personnage méconnu et d’un autre temps. L’attrait principal du personnage pourrait bien résider aujourd’hui dans sa capacité à réconcilier à droite les traditions néolibérales, conservatrices et traditionnalistes, sur fond d’austérité et du « vivre à l’accoutumée », véritables mantras du salazarisme. Alors que, contexte sanitaire aidant, on observe à peu près partout une tendance générale au renforcement de l’exécutif et à la restriction des libertés publiques, Salazar réunit en lui l’image d’un « technicien des finances » implacable nimbée d’un césarisme à la « Marc-Aurèle », à la fois réformateur, traditionnaliste, honnête, prudent et conservateur. « Apprenez, ô nations, à souffrir » écrivait Proudhon dans Césarisme et Christianisme. « Apprenez, ô gouvernants, à être forts pour exclure la politique économique de la délibération collective » pourrait être une des « leçons » d’actualité de Salazar.
À l’heure où le Portugal célèbre le 47e anniversaire de la Révolution des œillets le 25 avril 1974, jour de la liberté et acte fondateur de la démocratie portugaise honni par les droites conservatrices et radicales, à l’heure où est commémoré le 45e anniversaire de la Constitution portugaise adoptée le 2 avril 1976 – Constitution abhorrée par Chega, adepte d’une « liberté dérégulée », sans garanties ni protections constitutionnelles –, Salazar semble rester une énigme pour une partie de ses compatriotes. Ce « dictateur d’ancien régime » qu’évoquait Le Monde le 28 juillet 1970, « le vieux monsieur de Lisbonne » n’a peut-être pas fini de nous déconcerter.
Yves Léonard – Le Grand Continent – Avril 2021
Yves Léonard auteur de Salazarisme & fascisme répond aux questions d’Eddy Caekelberghs dans son émission «Au Bout du Jour» diffusée le 22 février pour parler de la nature du Salazarisme, de son histoire et de l’actualité politique au Portugal !
Pour écouter le podcast, veuillez cliquer ici !
Tenant compte du débat qui anime l’historiographie portugaise autour de la figure d’António de Oliveira Salazar, cette réédition d’un ouvrage de 1996, augmentée d’une postface inédite, propose une analyse des singularités et de la nature politique du régime qui a gouverné le Portugal de 1933 à 1974. Celui que son principal opposant, le général Humberto Delgado, assassiné en 1965, qualifiait de « biologiquement misogyne, socialement misanthrope, psychologiquement introverti et politiquement maurrassien » continue de faire l’objet d’une abondante production éditoriale. Mais, si le dictateur s’est éteint il y a un demi-siècle, le salazarisme, lui, a survécu, et ce bien après la « révolution des œillets » de 1974. L’entrée au Parlement en 2019 d’un parti d’extrême droite, Chega !, qui tient des propos racistes, de même que l’élection au Brésil de M. Jair Bolsonaro, qui emprunte des idées et des slogans au dictateur portugais, donnent à penser qu’il subsiste encore aujourd’hui. Yves Léonard entreprend de cerner ce qu’il définit surtout comme un autoritarisme ultraconservateur, en recourant à l’histoire sociale.
Tigrane Yégavian – Janvier 2021 – Le Monde Diplomatique