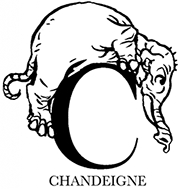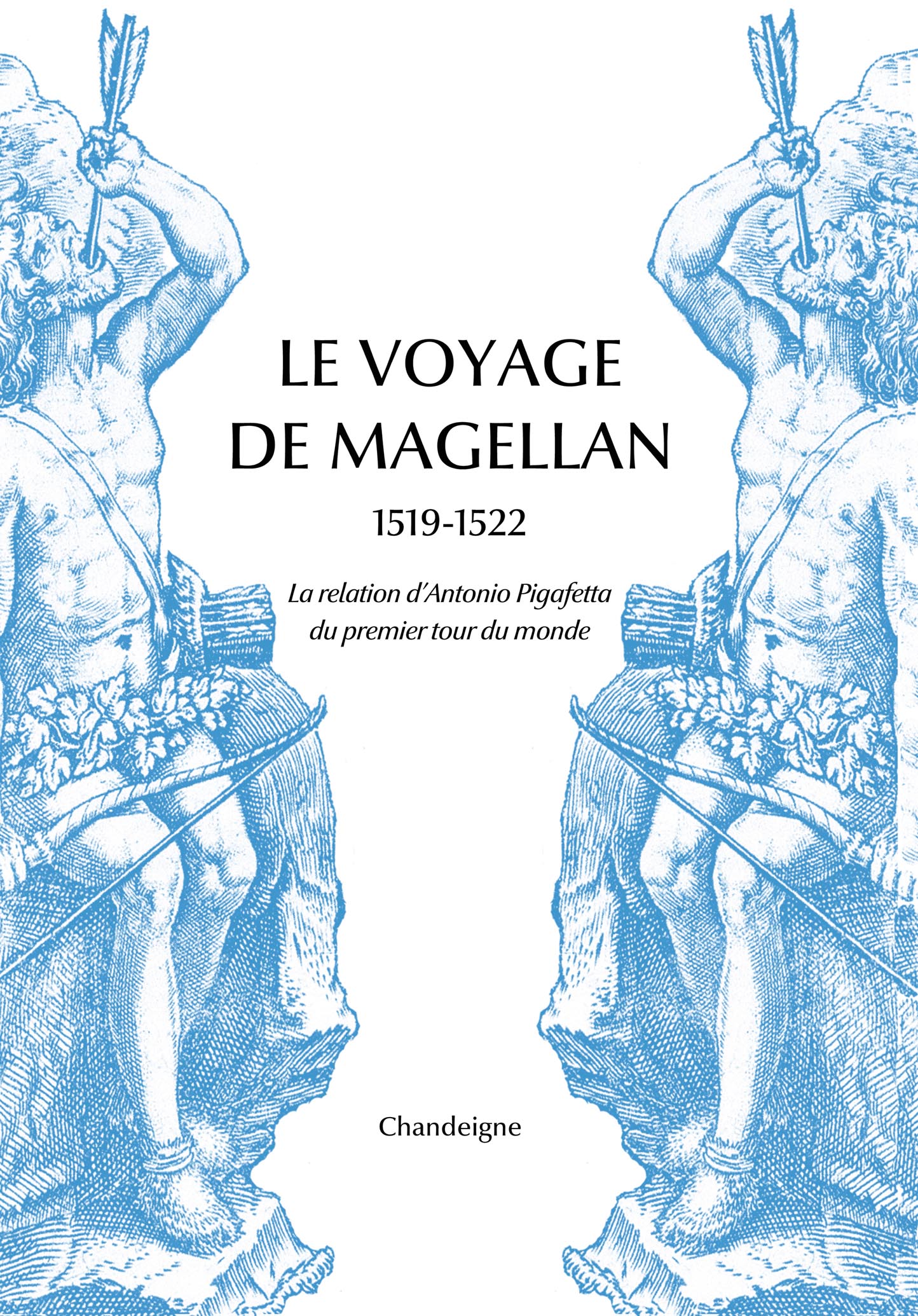- Radio Aligre - Lusitania
- Hola les Meriens
- Libération
- France Inter II Le temps d'un bivouac II
- Le Figaro
- Le nouveau magazine littéraire
- Le Temps
- Le Figaro
Mathilde Parra reçoit Michel Chandeigne dans l’émission Lusitania pour évoquer le voyage de Magellan
Émission enregistrée le samedi 8 mai 2021.
Un rendez-vous animé par Olivier Poivre d’Arvor, avec Michel Chandeigne, Michèle Boccoz, Ambassadrice de France aux Philippines et Jorge Torres-Pereira, Ambassadeur portugais en France. Ensemble ils évoquent le voyage de Magellan.
Terre de feu, l’élan de Magellan
Il y a cinq cents ans, le navigateur découvrait l’archipel perdu entre le Pacifique et l’Atlantique, au sud de l’Amérique latine. Une porte d’entrée pour les îles aux épices en Indonésie. Voyage à bord de l’un des rares navires à s’aventurer vers le cap Horn dans ces canaux étroits.
Et si la terre et les océans avaient leur existence propre ? Et si, au bout du monde, la mer et le ciel se touchaient ? Telles sont les questions qui viennent à l’esprit lorsque l’on se prend à rêver, entre mer et fjords, en regardant notre navire glisser dans un décor bleu gris, de montagnes anthracite et de ciels infinis. Ici, dans l’archipel de la Terre de feu, 74 000 km² à l’extrême sud du continent sud-américain avec, comme point le plus austral, l’île du cap Horn, aucune trace d’homme. La nature est à l’état brut. Inchangée depuis des millénaires. Il y a presque cinq cents ans, en novembre 1520, plus d’un an après son départ de Séville, le navigateur portugais Fernand de Magellan découvrait dans ces eaux glacées le passage vers le Pacifique, porte d’entrée vers les fameuses îles aux épices en Indonésie. Une découverte qui permit à l’un de ses navires, le bien nommé Victoria (victoire !), d’accomplir dans la foulée le premier tour du monde. Cinq siècles plus tard, le détroit qui porte son nom est toujours aussi impressionnant au cœur de cet archipel hostile et
grandiose que l’on découvre en bateau, jusqu’au cap Horn. Un voyage étonnant, dans le temps et dans l’espace.
Ici, le continent sud-américain s’effrite en dentelles dans une mer intérieure de multiples canaux, à «l’abri» (ça dépend des jours)
Voyages/ des cinquantièmes hurlants et à un jet de pierre de l’Antarctique glacé. On ne peut s’empêcher de frissonner en pensant à ces 200 marins intrépides emmenés par un capitaine inspiré qui osèrent s’y aventurer. «Le but de Magellan était de trouver, pour le royaume
d’Espagne, un passage sous ce continent “America” afin d’atteindre les fameuses îles aux épices, en évitant de traverser l’hémisphère portugais, détaille Michel Chandeigne, éditeur du Voyage de Magellan. Contrairement à ce qui a été écrit, Magellan n’a jamais projeté
un tour du monde.» Le navigateur portugais fut ainsi le premier Européen à naviguer dans ces mers hostiles. «Sans la certitude, renchérit César Vargas, notre capitaine, qu’il existait bien une issue dans ce labyrinthe de canaux traversés par les courants et balayés par des vents de plus de 150 km / h… Ces marins-là étaient terriblement courageux !»
Tapis de fleurs. Si leur traversée du détroit dura plus d’un mois, le temps de trouver un passage dans ce labyrinthe d’îles, notre aventure ne durera que quatre jours, à bord du bateau chilien Stella Australis, l’un des rares navires de croisière à s’aventurer dans ces canaux étroits et à débarquer au cap Horn. Le voyage a débuté à Punta Arenas. Cette ville chilienne du bout du monde surprend par ses maisons en tôles aux couleurs vives et ses élégantes bâtisses coloniales, symboles d’une prospérité perdue. Dans la ville, Magellan est partout : un hôtel, le Victoria, son buste qui fixe la mer, une réplique grandeur nature de son navire qu’on visite… En fin de journée, l’embarquement sur notre paquebot blanc et bleu (200 passagers, 90 mètres de long et 15 mètres de large) est retardé pour cause de rafales à plus de 130 km / h. «En janvier, c’est chose courante», s’amuse le capitaine. Et pourtant, c’est l’été austral, de septembre à avril, «la période la plus favorable». La nuit et le vent sont tombés ; le Stella Australis glisse vers le sud. Au petit matin, on découvre en canot pneumatique l’îlot Tucker, où nichent les manchots de Magellan, bestioles peu farouches aux contours des yeux blanchis, le ventre sali par les cailloux noirs de la plage. Ce sont les descendants des oiseaux sur lesquels les marins affamés du XVIe siècle se jetèrent sans complexe. Ils nous observent sans crainte, simplement intrigués par ces
étranges humains en gilet orange. «Ils sont beaucoup plus petits que je les imaginais», s’étonne Chantal, voyageuse sous le charme.
C’est dans cette «baie des sardines» que l’un des navires, le San Antonio, lassé de l’aventure, fit demi-tour pour rentrer en Europe.
Magellan envoya deux de ses nefs à sa recherche, en vain. «Paradoxalement, cette désertion sauva les marins du scorbut lors de leur traversée du Pacifique, sourit Michel Chandeigne. Car, pendant ces jours d’attente, ils cueillirent et consommèrent du céleri sauvage, très riche en vitamine C, et en firent des conserves !» La nature est en effet étonnante sous ces latitudes. Lors d’une expédition à terre dans la baie d’Ainsworth, à quelques miles au sud-est de l’îlot Tucker, on découvre une végétation insoupçonnée, faite de lichens, de tapis de fleurs roses, de petits arbustes aux boules rouges qui ont le goût et la texture de minipommes, mais aussi de petits arbres (canelos de Magellan), dont l’écorce est aussi gorgée de vitamine C. Les oiseaux et autres animaux sont rares, mais le renard dit aussi «de Magellan», s’est bien adapté, tout comme les «maudits» castors, dixit les Canadiens. «Importés du Canada dans les années 40 pour l’élevage, abandonné rapidement car leur fourrure n’était pas assez belle, ils sont aujourd’hui plus de 150 000 spécimens et détruisent la végétation qui tente de renaître là où les glaciers se retirent, comme ici le glacier Marinelli», explique Juanita, notre guide chilienne. Moment d’émotion lorsque, un peu plus tard, on traverse l’étroit canal Gabriel (à peine 270 mètres de large), entre chien et loup quand le gris bleuté du ciel s’évanouit dans l’anthracite des eaux et que les albatros jouent avec les courants d’air le long de la coque du navire.
Caillou mythique. Le lendemain, le Stella s’engage dans le canal Ballenero sur l’allée des glaciers de la cordillère Darwin, dominé à 2 469 mètres par le mont Shipton. Première rencontre avec un monstre de glace bleutée, le glacier Pia. On l’approche en canot pneumatique, intimidés par sa présence et en gardant une distance de sécurité car ses pans de glaces qui se détachent dans un bruit de tonnerre créent de belles vagues. Arrivés à terre, on grimpe sur la colline pour découvrir un panorama irréel et grandiose : roches granitiques, végétation bonsaï et, à perte de vue, l’eau turquoise de la baie. Puis, retour sur le navire pour longer pendant une heure de navigation les glaciers Romanche, Alemania, Francia, Italia, Hollande, nommés ainsi en hommage aux vaillants navigateurs. Le troisième jour, nous touchons cette fois véritablement le bout du monde : le cap Horn. La dernière île avant l’Antarctique. Il est 6 heures du matin, le soleil brille, le ciel est bleu et la mer est calme. C’est rare et nous pouvons débarquer dans la crique Léon, sur ce caillou mythique, régulièrement balayé par des vents de plus de 300 km / h. A ses pieds, plus de 800 navires et quelque 10 000 marins ont péri… Magellan, lui, ne l’a jamais vu, puisqu’il ne fut découvert qu’un siècle plus tard. Ce nouveau passage dit «de Drake» – autre marin téméraire – supplanta rapidement le détroit du Portugais, bien trop dangereux à naviguer. «Après sa mort, écrivit Stefan Zweig dans la belle biographie qu’il consacra à l’aventurier, tous ceux qui veulent s’y engager échouent et leurs navires se perdent dans le détroit.» La découverte de Magellan ne servit donc pas à grand-chose. Il n’empêche, comme le conclut Zweig : «L’exploit de Magellan a prouvé, une fois de plus, qu’une idée animée par le génie et portée par la passion est plus forte que tous les éléments réunis.»
Valérie Sarre – Libération – Mars 2020
Magellan, par delà le détroit
Daniel Fiévet reçoit Michel Chandeigne pour une émission autour du “Voyage de Magellan”. Diffusé le 10 juillet 2019.
“Le 10 août 1519, Fernand de Magellan quitte le port, les cales chargées de provisions et un objectif un peu fou en tête : rejoindre les îles aux épices par un détroit reliant l’Atlantique au Pacifique.”
Pour écouter veuillez cliquer ici !
Il y a cinq cents ans, le navigateur portugais embarquait avec 237 hommes pour un voyage sans retour. Une version allégée du célèbre récit d’Antonio Pigafetta paraît aujourd’hui.
Les lecteurs du Figaro littéraire se souviennent que c’est Simon Leys qui a rendu compte dans ces colonnes du Voyage de Magellan (1519-1522). La relation de Pigafetta et autres témoignages, publié en deux volumes par les Éditions Chandeigne en 2007. Pour saluer Fernão de Magalhães, qui a quitté Sanlucar de Barrameda, avec 237 hommes répartis sur cinq navires, le 20 septembre 1519, voici ce monument éditorial publié en version allégée.
En lisant cet extraordinaire récit de voyage, utilement complété par Idées reçues sur les Grandes découvertes, on se souviendra que, malgré la gloire qui enveloppe son nom, le navigateur portugais enrôlé au service de Charles Quint n’a pas achevé la première circumnavigation de l’histoire dont il rêvait.
Le 27 avril 1521, Magellan fut tué par une flèche empoisonnée à Mactan, une île de l’actuel archipel philippin, lors d’un accrochage avec des Indigènes. Il restait près d’un an et demi de voyage aux marins espagnols mais aussi génois, français, grecs, allemands et anglais de l’expédition.
Dix-huit survivants
C’est en septembre 1522 que dix-huit survivants, embarqués à bord de la Victoria, placée sous les ordres du Basque Juan Sebastian Elcano, ont bouclé ce que l’on nomme improprement le “tour du monde de Magellan”. Issu d’une grande famille de navigateurs de Getaria, Elcano est célébré comme un héros dans ce port de pêche posé au bord de la mer Cantabrique. Ayant peu d’inclination pour ce basque ténébreux, le chroniqueur italien Antonio Pigafetta ne raconte pas l’accueil triomphal qu’ont fait les gens de Getaria à l’enfant du pays lorsqu’il est remonté vers l’église de San Salvador, où il s’est recueilli au pied de la statue de Nuestra Senora de la Antigua comme il en avait fait le voeu au milieu des tempêtes. Le maknine que l’Enfant-Jésus tient dans sa main sur cette statue permet de se souvenir que le turbulent Juan Sebastian Elcano avait participé à une expédition militaire à Oran en 1509, à l’époque où Charles Quint rêvait de s’ouvrir une porte pour aller grignoter les régences ottomanes au Maghreb.
Sébastien Lapaque – Le Figaro – Juin 2019
À bord d’une légende
Le premier tour du monde, rapporté par le serviteur de Magellan, est ici éclairé par un parfait appareil critique et cartographique. L’exploit ne fut pas prémédité : en rivalité avec le Portugal, le roi d’Espagne veut gagner par l’ouest les Moluques, d’où sont importées plusieurs épices. Mais, arrivé sur place après une mutinerie et bien des avanies, l’équipage renonce à rebrousser chemin et se décide à traverser le Pacifique… Sur les 237 explorateurs partis d’Espagne, seuls 35 revinrent sains et saufs. Magellan n’était pas de du nombre.
Maialen Berasategui – Nouveau magazine littéraire – Juin 2018
Sur un bateau, avec Magellan
L’Italien Antonio Pigafetta a accompagné le navigateur portugais pendant son tour du monde. Son récit, fabuleuse aventure, est réédité.
Le voyage de Magellan (1519-1522) est un des plus célèbres récits de voyage, une aventure fabuleuse, racontée par l’Italien Antonio Pigafetta qui s’embarqua avec le Portugais sous les armes du roi espagnol qui deviendrait Charles Quint. Ce premier tour du monde, Magellan ne l’accomplit pas complètement, puisqu’il mourut en 1521 aux Philippines au cours d’un affrontement avec les indigènes. Il ne pensait d’ailleurs pas faire une boucle mais un aller et retour aux îles Moluques, «où naissent les clous de girofle» et d’où il devait rapporter les précieuses épices. Mais Pigafetta revint, lui, avec une partie des 91 membres survivants parmi les 237 qui embarquèrent en 1519.
Version de poche synthétisée
Son récit fait autorité, mais beaucoup d’inexactitudes ont été reprises de livre en livre, jusque dans le récit de Stefan Zweig, Magellan. En 2007, les Editions Chandeigne publient une édition critique de référence du rapport de Pigafetta, de plus de mille pages. Elle paraît aujourd’hui dans une version de poche synthétisée, mais avec des cartes, une chronologie détaillée et des notes qui rectifient les erreurs ou omissions du chroniqueur et établissent l’identité des marins décédés.
Un voyage long, dangereux, qui a prouvé, en allant vers l’ouest, non que la Terre était ronde, ce qu’on savait, mais qu’elle était «circumnavigable». Le récit de Pigafetta décrit en détail les difficultés du voyage, l’hostilité des marins espagnols, mécontents d’obéir à ce Portugais de Magellan, la mutinerie au large de l’Argentine, la découverte des Patagons en Terre de Feu, la rude traversée du Pacifique et la mort du célèbre navigateur qui donna son nom à un détroit.
Isabelle Rûf – Le temps – Juin 2018
Les univers maritimes n’ont cessé de passionner les écrivains. À l’approche du 500e anniversaire de la première circumnavigation autour de la Terre, Michel Chandeigne raconte le premier «voyage autour du monde» du navigateur portugais.
À ceux qui s’obstinent à croire qu’il a fallu attendre Galilée pour que les gens d’Église daignent reconnaître que la Terre était ronde – ainsi que l’on continue à l’apprendre aux enfants des écoles -, on recommande la lecture du Voyage de Magellan, que publient les Éditions Chandeigne à l’approche du 500e anniversaire de la première circumnavigation autour de la Terre. Que diable cherchaient donc le capitaine-général Fernão de Magalhães et les deux cent trente-six marins embarqués avec lui, le 20 septembre 1519 à Sanlucar de Barrameda, au nord de Cadix, s’ils croyaient que la Terre était plate ? Qu’aillaient-ils faire à bord du Victoria, du Trinidad, du San Antonio, du Concepcion et du Santiago, sinon trouver une mort certaine ? Auteur, avec Jean-Paul Duviols, d’un petit livre intitulé Idées reçues sur les Grandes Découvertes et éditeur scrupuleux de la relation d’Antonio Pigafetta aujourd’hui publiée sous le titre Le Voyage de Magellan, Michel Chandeigne aime remettre les pendules à l’heure à propos de cette histoire sur laquelle beaucoup se trompent – y compris Stefan Zweig. Il faut commencer par s’interdire de parler du tour du monde de Magellan. Chacun devrait savoir que le malheureux Fernand, tué aux Philippines en 1521, n’a jamais accompli son grand rêve.
Dans deux premiers volumes sous coffret publiés en 2007, salués comme un chef-d’œuvre éditorial par Simon Leys dans ces colonnes, Chandeigne avait publié la relation de Pigafetta assortie d’une masse considérable de documents et de témoignages sur le premier voyage autour du monde (1519-1522). Le volume allégé qu’il publie aujourd’hui reprend le seul témoignage du chroniqueur lombard avec la certitude qu’il se lit comme un roman. Simon Leys en convenait volontiers: la relation de Pigafetta vaut les grands livres d’aventures maritimes du XIXe siècle, il fait le poids sans problème face aux chefs-d’œuvre de James Fenimore Cooper (Le Corsaire rouge), Richard Henry Dana (Deux Années sur le gaillard d’avant) et Hermann Melville (Moby Dick).
Une introduction, des cartes et un appareil de notes d’une impeccable rigueur scientifique – augmenté d’une annexe extraordinaire qui décrit avec précision chacun des cinq navires et donne une courte biographie de chacun des marins embarqués – permettent de faire un usage savant de ce livre d’histoire unique en son genre. Mais il est également permis de le lire pour le seul plaisir de se rire des tempêtes. Il ne manque rien, dans cette aventure. Ni les personnages doubles, ni les chausse-trapes, ni les rebondissements. Capitaine portugais missionné par l’empereur Charles-Quint, Magellan suscitait la méfiance de ses compagnons castillans. Lors d’un hivernage dans la baie San Julian, sur les côtes de l’actuelle Patagonie, il a affronté une mutinerie qui s’est soldée par la condamnation de l’insolent Gaspar de Quesada au supplice de la cale: les bras accrochés dans le dos en haut de la vergue du grand mât, il fut lâché brusquement, avec une longueur de cordage ajustée de façon à ce que son corps se disloque avant de toucher la mer. On était en avril 1520. Le cercle du monde du levant au ponant était loin d’être bouclé…
Sébastien Lapaque – Le Figaro – 1er février 2018