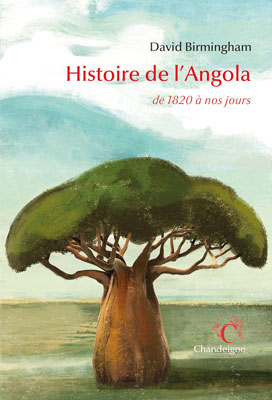- Études littéraires africaines
- 20 & 21. Revue d'histoire
- En attendant Nadeau
- L'Histoire
- Le Monde diplomatique
- Le Monde
- Africa4 - Blog Libération
En 2008, René Pélissier, spécialiste de l’Angola et des mondes africains lusophones, publiait dans Politique africaine (n°110) une chronique bibliographique intitulée « Angola : plongées dans une mer d’encre ». Le pays a en effet fait l’objet de nombreuses études, aussi bien en anglais qu’en espagnol et en portugais. En français, outre les ouvrages déjà anciens de Pélissier, le lecteur a accès aux travaux d’Arlindo Barbeitos (L’Harmattan, 2008), de Christine Messiant (Karthala, 2008) et de JeanMichael Mabeko-Tali (L’Harmattan, 2005), ainsi qu’aux articles de Catarina Madeira Santos (Annales, 2005 et 2009). La traduction du livre de David Birmingham vient utilement compléter ces travaux critiques de qualité mais dispersés. Le terminus a quo, 1820, est pertinent. Avec l’indépendance du Brésil en 1822, le Portugal perd beaucoup, tant du point de vue économique que symbolique : l’Angola va prendre la place de ce territoire dans l’imaginaire politique du pays. Histoire de l’Angola est découpé en neuf chapitres, suivis d’une section à propos de l’actualité et d’une annexe (« Le facteur Cadbury de l’histoire angolaise ») abordant la question du travail obligatoire à partir de la mission menée par William Cadbury en 1908. Une chronologie, une bibliographie choisie (les titres essentiels y figurent) et un index ferment le livre. On regrettera l’absence de notes empêchant le lecteur d’articuler les chapitres à la bibliographie en question.
Longtemps cantonnée à quelques comptoirs sur la côte, la présence portugaise met des dizaines d’années à s’imposer dans le reste du pays. À partir de la fin du XIXe siècle, l’exploitation du territoire suivra en partie l’exemple de l’État Indépendant du Congo : une économie d’extraction fondée sur le travail obligatoire. À ce sujet, D. Birmingham rejoint les observations d’Elikia M’Bokolo à propos du Congo léopoldien. La question de la main-d’œuvre se pose après l’interdiction du commerce d’esclaves dans l’Atlantique. Le Portugal suit ici la Grande-Bretagne avec retard, puisque Lisbonne n’interdit le transport d’esclaves qu’en 1836 et la possession d’esclaves dans les colonies lusitaines en 1875. Sur place, on remplace le travail servile par un substitut guère plus avantageux, les travailleurs sous contrat (serviçais). « Dans la pratique, durant tout le XIXe siècle, ces formes modifiées d’esclavage demeurent omniprésentes en Angola » (p. 24).
Sous la pression de Londres, le Portugal détourne les routes lucratives du commerce d’êtres humains pour les recomposer localement. Le développement de l’économie de plantation à Sao Tomé et Principe est ainsi dû en grande partie à l’importation de milliers de travailleurs esclaves angolais. D. Birmingham rappelle ici une spécificité de l’Angola par rapport aux colonies voisines : si le secteur privé est massivement présent en Rhodésie et dans les deux Congo, il se développe plus lentement dans la colonie portugaise. La base de la future conquête de l’intérieur se situe à Luanda, fondée en 1576. Pepetela, écrivain angolais souvent cité par l’auteur (malheureusement peu traduit en français), a brossé un portrait saisissant de la ville au milieu du XVIIe siècle dans La Glorieuse Famille : le temps des Flamands. D. Birmingham fonde quant à lui sa description de Luanda au XIXe sur deux récits de voyages, l’un de Mary Kingsley (1899), dont on ne trouve pas trace dans la bibliographie, et l’autre de Georg Tams (1840), médecin hambourgeois. Ces deux témoignages donnent à voir la composition sociale de la future capitale, son rôle de premier plan dans le commerce avec l’intérieur, ainsi que l’émergence d’une classe possédante métisse qui a fait sienne la langue portugaise. « Certains Africains éduqués de Luanda appartiennent à “l’aristocratie” créole, composée de descendants de familles dont certaines remontent jusqu’au XVIIe siècle » (p. 61). Ils trouvent à s’employer comme administrateurs coloniaux, officiers ou enseignants.
Le troisième chapitre raconte la conquête de l’arrière-pays à partir du témoignage de L. Magyar, commerçant originaire de Budapest. David Birmingham reprend le fil rouge de la main-d’œuvre servile pour décrire le processus : caravanes d’esclaves, de porteurs (ivoire et caoutchouc vers la côte, produits manufacturés et alcool en sens inverse), travailleurs forçats dans les plantations (apparition de l’industrie caféière dans le centre nord). Le dernier quart du XIXe siècle est aussi marqué par les tensions avec les colonies voisines. Les accords signés à Berlin règlent la question de l’occupation des rives du Congo. L’Angola y gagne l’enclave de Cabinda, où l’on découvrira d’importantes réserves de pétrole au siècle suivant. La conférence de Berlin favorise aussi l’arrivée de nouveaux acteurs, dont la Baptist Missionary Society qui s’établit dans les colonies belge et portugaise avec des conséquences durables pour le futur de l’Angola. « Le centre urbain de la mission sera Kinshasa, au Congo belge, où de nombreux Angolais, en quête d’emploi et d’éducation, émigrent dans la première moitié du XXe siècle » (p. 92). Les Angolais francophones joueront un rôle économique non négligeable dans le Nord du pays après l’indépendance.
Dans le Sud, Benguela constitue l’autre centre actif de la présence portugaise. D. Birmingham y consacre son quatrième chapitre et met en évidence les trois circuits économiques principaux qui font vivre cette colonie autonome (fondée en 1617) et son hinterland : le commerce de l’ivoire, celui du caoutchouc et l’exportation d’esclaves vers Sao Tomé et Principe. Une circulation régulière de marchandises (rhum, sel, armes de Liège et Birmingham) vers les royaumes de l’intérieur contredit l’opinion, commune chez les Européens, d’une terra incognita fermée au monde extérieur. L’historien renvoie encore à Pepetela dont le roman historique Yaka rend bien compte du contexte local au XIXe siècle.
Entretemps, à Lisbonne, on rêve de reconstituer un empire qui s’étendrait de l’Atlantique à l’océan Indien. Londres refuse et impose, en 1890, un ultimatum à son plus vieil allié. Le cinquième chapitre décrit ce moment où « sonne le glas de l’ordre colonial ancien », le Portugal risquant même de voir l’Angola démembré au profit de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne. Si l’on veut saisir au mieux les évolutions de la colonie, difficile de faire l’impasse sur l’évolution politique du Portugal. À partir de la fin du XIXe et jusqu’à l’indépendance de la colonie (1975), il faudra donc compléter la lecture par celle de l’ouvrage de Yves Léonard publié dans la même collection en 2016 : l’auteur y montre que, pour Salazar, la grandeur du Portugal doit s’incarner dans un empire colonial dont l’Angola constitue la pièce maîtresse. Au cours du XXe siècle, les autorités portugaises évincent les anciennes élites métisses de Luanda et de l’intérieur au profit de nouveaux arrivants blancs. Les créoles lusophones « sentent que les tenants du racisme victorien endémique écrasent leur statut » (p. 141). L’idéologie lusotropicale promue par l’État Nouveau (1933-1974) afin de montrer le visage humain du colonialisme portugais ne résiste pas à l’analyse. D. Birmingham renvoie aux romans de Castro Soromenho (Mozambicain d’origine indienne) et de Ralph Delgado (fils d’un commissaire colonial dans l’ancien royaume de Bihé) pour restituer la réalité des relations interraciales dans les années 1930.
Reconstituer les origines, le déroulement et l’issue d’une longue guerre coloniale (1961-1974), impliquant de multiples acteurs, tient de la gageure. D. Birmingham y parvient toutefois dans un sixième chapitre aussi dense que bien structuré. Le Portugal neutre sort de la Seconde Guerre mondiale en relativement bonne posture, même s’il reste un pays pauvre. En Angola, les autorités profitent de la demande mondiale en café pour en relancer la culture. Si la qualité n’est pas toujours au rendez-vous, les quantités produites augmentent régulièrement jusqu’à représenter 200 000 tonnes par an entre 1945 et 1975. La culture caféière se développe dans le Nord de la colonie. Les patrons blancs importent de la main-d’œuvre venue des hauts-plateaux du Sud. « Ces étrangers ovimbundus sont bien sûr très mal appréciés par les habitants du nord-Kongo, qui ont perdu terre et autonomie économique » (p. 47). Cette main-d’œuvre se plaint également de la déportation intérieure et d’un environnement difficile. Des centaines de milliers d’Angolais travaillent encore dans des conditions proches de l’esclavage à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Travail forcé, conditions de vie précaires dans les plantations de coton et de café et famine poussent les populations à la révolte, puis à l’insurrection. L’indépendance, obtenue en novembre 1975, est minée par les conflits entre les trois principaux mouvements de libération, ainsi que par la présence d’acteurs extérieurs (URSS, Cuba vs Afrique du Sud, Congo et États-Unis) qui s’affrontent dans le contexte de la Guerre froide. L’Angola restera pendant une quinzaine d’années un des points de friction entre les blocs. L’historien rappelle que la défaite de l’Afrique du Sud face aux Cubains lors de la bataille de Cuito Cuanavale à la fin des années 1980 fragilise le régime de l’apartheid et ouvre la voie à l’indépendance de la Namibie.
Il rend ensuite compte des difficultés qu’a le MPLA à gérer l’État dans un environnement marqué par les tensions entre la capitale et les provinces, entre les classes les plus pauvres réfugiées à Luanda et l’élite urbaine. La tentative de coup d’État de mai 1977 met à jour les frustrations des laissés-pour-compte de l’indépendance. La terrible répression qui s’en suit étouffe toute possibilité d’opposition. D. Birmingham y voit l’origine de la transformation d’un mouvement de masse en un parti au service exclusif d’une élite prédatrice. Un roman de Pepetela, Predadores, mentionné dans la bibliographie, en décrit avec pertinence l’émergence. La perpétuation de la guerre dans les années 1980, la malédiction du pétrole et l’accaparement du pouvoir expliquent en grande partie la dégradation continue des institutions et des infrastructures. La guerre civile entre le MPLA et l’UNITA (implantée dans le Sud), qui s’opposent pour la détention du pouvoir et des richesses, ne prendra fin qu’en 2002. Les deux derniers chapitres balaient l’histoire postcoloniale violente du pays et dépeignent l’ingéniosité d’une population civile malmenée mais capable de survivre malgré tout. D. Birmingham consacre ainsi des pages fortes aux femmes qui, tant en ville qu’à la campagne, ont permis à l’Angola de tenir debout.
Somme toute, il s’agit d’un ouvrage accessible, autorisant une meilleure compréhension de l’histoire moderne du pays. On regrettera un premier chapitre (« La fabrique d’une colonie ») décousu, accumulant les faits, et qui aurait mieux servi son propos en tant qu’introduction. Quant à l’annexe, n’étant pas annoncée au départ, elle laisse dans un premier temps le lecteur dépourvu, même s’il perçoit la pertinence de son contenu. La force d’Histoire de l’Angola tient, entre autres, à la connaissance que l’auteur a des sources premières et secondaires ainsi que des acteurs et du terrain. Il faut reconnaître à D. Birmingham une remarquable capacité de synthèse à propos de certains sujets complexes. Ainsi réussit-il à brosser une histoire critique des mouvements de libération, alors même que les versions des témoins et des acteurs évoluent et se contredisent au cours du temps. Ce sont les archives de la police politique portugaise qui ont été les plus utiles pour écrire l’histoire des mouvements en question. Ses procès verbaux permettent de suivre l’évolution idéologique des acteurs mieux que les archives, inexistantes ou incomplètes, des mouvements eux-mêmes. Remarquons enfin que D. Birmingham s’adosse à l’historiographie brésilienne, notamment au travail de Marcelo Bittencourt, Estamos juntos : o MPLA e a luta anticolonial (2008). Le chercheur brésilien, qui a travaillé à partir des archives et d’une série d’entretiens, donne un portrait nuancé du MPLA, démontrant en quoi ce parti est historiquement divisé en tendances opposées.
Fabrice Schurmans – Études littéraires africaines – Mars 2021
Court, agréable à lire, riche en références archivistiques et littéraires, ce livre d’excellente facture est l’occasion pour David Birmingham de retracer les grandes étapes de l’histoire de l’Angola, tout en nous en faisant découvrir la vie sociale.
Commençant son récit vers 1820, l’auteur revient d’abord sur la fabrique de la colonie angolaise. Tout au long du 19e siècle, la majorité des Africains, pourtant officiellement affranchis, restent soumis à l’économie de la terreur qui sous-tend, dans les plaines du Nord, l’extraction forestière, au Sud, le commerce de cacao et de travailleurs forcés, et à Luanda, la formation d’une capitale dirigée par une élite créole. Cette partition socioéconomique du pays se renforce au début des années 1930 avec l’arrivée au pouvoir de Salazar, et encore davantage au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
L’économie de café se développe au Nord avec une telle violence que beaucoup d’habitants fuient vers le Congo de Mobutu. Les populations du Sud ont, elles, des conditions de vie proches de l’esclavage, les uns travaillant dans les mines de cuivre, les autres fournissant une maind’œuvre paysanne bon marché. Quant aux habitants de Luanda, les milliers de Portugais partis bâtir une colonie blanche cohabitent avec une élite faite de vieux assimilados, dont la créolité remonte au 17e siècle, de néo-assimilados empreints d’une double culture, et de mestiços pouvant parfois accéder au mode de vie expatrié. Tel est le contexte dans lequel débute la guerre coloniale. Deux révoltes éclatent en février et mars 1961, l’une à Luanda, l’autre dans les plantations du Nord. La répression est systématiquement sanglante. Puis Salazar dépêche une armée de conscrits de la métropole vers la colonie. Et du côté des insurgés, tandis que les peuples du Nord créent le FNLA (Front national de libération de l’Angola), soutenu par le Congo de Mobutu et les États-Unis, les métisses, créoles, intellectuels et activistes de Luanda forment le MPLA (Mouvement populaire de libération de l’Angola), soutenu par Cuba et l’URSS. Quant aux populations du Sud, elles se rassemblent au sein de l’UNITA (Union pour l’indépendance totale de l’Angola) que soutiennent l’Afrique du Sud et les États-Unis. La guerre s’achève en 1974.
Du moins pour la métropole. Car, pour les Angolais, l’accession à l’indépendance signe le début de trente années de guerre. Impossible ici de revenir sur cette période aux histoires et aux géographies si denses, que David Birmingham décrypte avec talent. « Guerre d’intervention étrangère » en pleine guerre froide, économie de troc pour les populations qui font du pack de 24 bières blondes une monnaie d’échange, champs de mines posées par les factions rivales autour des champs et des puits des paysans alors affamés, corruption des élites politiques entretenue par les marchands néo-libéraux venus du monde entier et, surtout, exploitation de pétrole organisée par le MPLA, trafic de diamants contrôlé par l’UNITA, et ethnicisation des oppositions régionales nées au 19e siècle… En Angola peut-être encore plus qu’ailleurs, la complexité du présent « ne peut se comprendre que si l’on se rapporte à son passé » (p. 241).
Guillaume Blanc – 20 & 21. Revue d’histoire – Novembre 2021
Une histoire de l’Angola moderne
Depuis bientôt trente ans, les éditions Chandeigne réalisent un travail remarquable pour la diffusion en français des littératures de langue portugaise et de la recherche sur les espaces lusophones. Avec ce nouvel opus, elles comblent un vide, puisqu’il n’existait aucune synthèse historique en langue française sur l’Angola. Grâce à cette traduction de A Short History of Modern Angola, paru aux éditions Hurst en 2015, le travail de David Birmingham, professeur émérite de l’université du Kent à Canterbury, pionnier de l’écriture de l’histoire angolaise et de l’histoire sociale de l’Afrique depuis les années 1960, est accessible pour la première fois à un large public francophone.
Écrire une synthèse historique couvrant deux siècles d’histoire d’un territoire aussi vaste que l’Angola moderne sans tomber dans la caricature et la simplification à outrance, voilà qui tenait forcément de la gageure. Il fallait donc tout le métier d’historien et les talents de conteur de David Birmingham pour que cela devienne possible, lui qui nous brosse ce beau panorama de l’histoire moderne de l’Angola avec le recul qu’offre plus d’un demi-siècle de recherches consacrées à l’Angola, à l’Afrique australe [1], au Portugal [2], mais aussi à la Suisse [3].
Ancienne colonie portugaise, l’Angola a accédé tardivement (1975) à l’indépendance, au prix d’une longue guerre de décolonisation (1961-1974) qui a non seulement opposé l’armée coloniale portugaise aux nationalistes angolais, mais a également été marquée par la lutte entre les trois courants du nationalisme angolais [4] pour l’hégémonie sur la nation angolaise et le contrôle du futur État indépendant. Dès l’indépendance, cette lutte fratricide se transforme en une violente guerre civile qui opposera pendant plus de 25 ans le MPLA, au pouvoir depuis 1975, et l’Unita du « rebelle » Jonas Savimbi. C’est d’ailleurs la mort au combat de ce dernier, en février 2002, qui permettra de mettre un terme à la guerre.
Depuis la fin de la guerre civile en 2002, le pays a connu une période de boom économique sans précédent, surfant sur la vague haussière des prix du pétrole dans les années 2000, avant de connaître un premier coup de frein dès 2008, puis d’entrer dans une grave crise économique et financière avec la chute des prix du cours du brut dès 2014. C’est durant ces années de boom et d’internationalisation galopante de l’économie angolaise que les inégalités sociales, déjà massives, se sont renforcées, et que des fortunes colossales se sont constituées, comme en témoigne l’ascension fulgurante d’Isabel dos Santos, fille aînée de José Eduardo dos Santos, président de l’Angola de 1979 à 2017, et première femme milliardaire d’Afrique selon le magazine Forbes – la « princesse », comme on la désigne en Angola. En 2017, José Eduardo dos Santos, communément appelé « Zédu », a dû céder la présidence à João Lourenço, un ancien jeune loup de son parti, le MPLA. Depuis son élection, celui-ci n’a eu de cesse de se retourner contre son ancien mentor et sa famille, allant jusqu’à faire inculper et emprisonner José Filomeno dos Santos, fils aîné de « Zédu », pour gestion déloyale et détournement de fonds alors qu’il dirigeait le Fonds souverain créé en 2013 pour soutenir la diversification d’une économie entièrement dépendante de la manne pétrolière. La princesse déchue, quant à elle, est contrainte de gérer ses entreprises et son patrimoine depuis l’étranger pour éviter semblable déconvenue.
Il n’est guère étonnant dès lors que l’Angola ait surtout fait parler de lui pour son lourd passé guerrier, pour ses ressources naturelles ou ses énormes richesses et leur destin souvent très « privatisé ». Le grand mérite du livre de David Birmingham est de mettre en perspective ces dynamiques récentes et de montrer que l’histoire des terroirs historiques qui forment l’Angola moderne, à l’interface entre l’Afrique centrale, l’« Atlantique noir » [5] et l’Afrique australe, est bien plus complexe. Le livre montre aussi à quel point cette complexité sociale, historique et politique est essentielle à la compréhension de la trajectoire actuelle du pays.
Le récit débute en 1820, au moment où la couronne portugaise est sur le point de « perdre » le Brésil, ce qui donnera à la présence portugaise en Afrique australe et occidentale une importance renouvelée – même si le « contrôle » qu’exerce le Portugal sur l’Angola reste très limité jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est la question du commerce qui est au centre de la première partie de l’ouvrage. Un commerce dominé bien sûr par la traite atlantique des esclaves jusqu’à son abolition progressive dans la première moitié du XIXe siècle, traite dont l’auteur montre qu’elle se prolonge en réalité sous différentes formes d’esclavage jusqu’au milieu du XXe siècle : travail forcé, puis travail « sous contrat » qui nourriront l’économie coloniale grâce aux plantations de coton et de café au centre-nord de l’Angola, ou encore de cacao sur les îles des São Tomé et Príncipe.
C’est aussi le commerce atlantique qui façonnera durablement la structure sociale de l’Angola. À Luanda, l’ouvrage retrace, à l’aide de plusieurs portraits saisissants, le développement d’une élite marchande, intellectuelle et politique, culturellement et biologiquement métissée. Cette élite créole contrôlera politiquement, économiquement et culturellement l’Angola jusqu’au premier quart du XXe siècle ; et son déclassement racial, culturel, puis politique et économique sera une des matrices du nationalisme angolais tel qu’il se développera à Luanda dans les années 1950. Si les effets du métissage et de la créolisation culturelle se font moins sentir à l’intérieur de l’Angola, Birmingham insiste à juste titre sur l’importance des intermédiaires angolais dans l’histoire de l’insertion du nord (chapitre 3) et du centre du pays (chapitre 4) dans le monde colonial. Là aussi, c’est d’abord dans le commerce que ces intermédiaires se font une place de choix. Mais, à partir de la fin du XIXe siècle, c’est principalement au sein des missions chrétiennes (catholiques et protestantes) qu’émergent plusieurs groupes « d’évolués » qui, eux aussi, joueront un rôle central autant dans la structuration du nationalisme angolais que dans les profondes divisions qui se traduiront par la création de trois mouvements concurrents et se prolongeront dans la guerre civile.
L’importance des métissages et de la créolité dans la fabrique de la société angolaise a pour conséquence notable que, jusqu’au début du XXe siècle, la race et la couleur de peau ne sont pas les critères essentiels qui déterminent le statut social au sein du monde colonial. L’insertion dans les différents commerces de longue distance qui font et défont les richesses des grandes familles angolaises, l’adoption précoce de la langue portugaise comme lingua franca des élites, ou encore le niveau de formation scolaire, sont des marqueurs identitaires plus importants, et ce sont eux qui définissent les contours de l’exclusion sociale. Mais, comme le montre bien l’ouvrage, ces dynamiques changent profondément avec la conquête effective par les troupes coloniales. Celle-ci se fait progressivement, au prix d’un effort militaire colossal, entre 1890 et la fin des années 1910, et elle permet le peuplement progressif de l’Angola par des colons blancs, qui culminera dans l’après-Seconde Guerre mondiale lorsque plusieurs centaines de milliers de Portugais, principalement issus du nord rural et paupérisé de la métropole, seront envoyés en Angola. Ce « blanchiment » progressif, orchestré par la dictature d’António Salazar et l’« État nouveau » qu’il met en place dès les années 1930, aura pour conséquences principales la racialisation des relations sociales, la « mise au travail » brutale d’une partie de la paysannerie par l’institution du travail « sous contrat », l’exclusion croissante des anciennes élites créoles vers les marges du système colonial, et l’apparition de nouvelles élites, notamment formées dans les missions chrétiennes, qui deviennent une des rares voies d’ascension sociale, même si celle-ci reste toute relative jusque dans les années 1960.
Les tensions que génère ce système colonial et le refus obstiné du régime salazariste d’entrevoir une décolonisation négociée culminent en 1961 avec le déclenchement de la guerre anticoloniale. Elles se prolongent après 1975 dans la guerre civile qui, nourrie par la logique de la guerre froide puis par les ressources naturelles (pétrole et diamants) dont regorge le pays, oppose des visions concurrentes de la nation, des représentations antagoniques de ce que devrait être l’Angola indépendant, tout en étant aussi le résultat de l’appétit pour le pouvoir de ses principaux protagonistes. Même si le livre finit sur une note d’espoir avec le changement récent à la tête de l’État, les chapitres consacrés à la deuxième moitié du XXe siècle mettent en lumière les profondes divisions héritées de l’histoire coloniale et postcoloniale du pays.
Le mérite principal de David Birmingham dans cet ouvrage réside sans conteste dans sa capacité unique à raconter l’histoire de l’Angola non pas de façon abstraite mais à la hauteur des yeux de ses protagonistes. Il en résulte un récit vif, saisissant, remarquablement bien écrit. Les nombreux portraits et anecdotes dont est émaillé le livre en rendent la lecture agréable tout en conférant au récit un air de « vécu ». En témoigne le portrait, basé sur une courte autobiographie, d’un jeune Angolais du centre du pays, enrôlé dans une plantation locale, puis envoyé à São Tomé avant de rejoindre les côtes du Cameroun en se laissant dériver à bord d’un frêle esquif. Un portrait qui jette d’ailleurs une lumière plutôt positive sur le travail dans les plantations de café et de cacao, et que Birmingham s’empresse de nuancer en se basant sur le fameux rapport Cadbury qui dénonçait, dans les années 1950, les conditions de travail dans les plantations portugaises comme une forme moderne d’esclavage. On retrouve cette passion du récit dans les portraits de femmes, notamment des nombreuses femmes ordinaires qui ont organisé la « survie » du peuple angolais dans les années de guerre civile, portraits à partir desquels l’auteur raconte une version encore trop peu connue de cette histoire.
Un bel ouvrage, donc, qui mérite une diffusion large et qui permettra de mieux faire connaître un pays dont il est si peu question dans l’espace francophone. Le lecteur exigeant pourra regretter le choix de ne pas inclure de notes de bas de page, qui, s’il facilite la lecture, ne permet pas de creuser tel ou tel aspect. Si la bibliographie compense en partie ce manque, elle est très sommaire, et des indications bibliographiques plus précises, par exemple à la fin de chaque chapitre, auraient permis de mieux mettre en valeur les sources (pour la plupart secondaires) dont est tiré le livre. Enfin, on peut regretter parfois que la forme choisie pour le récit prenne le pas sur l’analyse sociologique, laquelle aurait pu permettre un approfondissement de certains thèmes clé. Mais cela se serait peut-être fait au détriment de la lisibilité du livre, un critère essentiel pour un ouvrage dont on espère qu’il donnera envie à certains de ses lecteurs de pousser plus loin la recherche.
Didier Péclard – En attendant Nadeau – Décembre 2019
Article à lire sur le site En attendant Nadeau : ici
-
David Birmingham, Frontline Nationalism in Angola and Mozambique, Londres, James Currey, 1992 ; Empire in Africa. Angola and Its Neighbours, Ohio University Press, 2006.
-
David Birmingham, A Concise History of Portugal, Cambridge University Press, 1993.
-
David Birmingham, Château d’Oex. Mille ans d’histoire suisse, Payot, 2005.
-
Il s’agit du Front national de libération de l’Angola (FNLA), le premier mouvement nationaliste fondé par Holden Roberto parmi les populations bakongo du nord de l’Angola ; du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), qui se formalise en tant que mouvement politique au tout début des années 1960 et qui, sous la houlette de son premier dirigeant, Agostinho Neto, prend le pouvoir au moment de l’indépendance le 11 novembre 1975 ; et de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola, mouvement fondé par Jonas Savimbi en 1966.
-
Paul Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Amsterdam, 2017 (1993 pour l’édition originale en anglais).
Un géant meurtri
Ce n’est pas par hasard que David Birmingham remonte à 1820 pour faire comprendre les enjeux actuels en Angola. Le Brésil, en effet, devient indépendant en 1822 et le Portugal se tourne alors vers l’Afrique pour y construire un troisième empire colonial, après l’Asie et l’Amérique. La traite transatlantique prend fin, remplacée par un travail forcé sur place qui bouleverse profondément l’économie régionale, à la jonction de l’Afrique australe et de l’Afrique centrale. Car le pays est riche de ces produits qu’aime tant l’Europe : coton, maïs, et bien sûr la canne à sucre.
Des Portugais s’y installent en nombre, aventuriers, prolétaires, exilés politiques, officiers. Au XXe siècle, d’autres ressources rendent l’Angola plus attirant encore : cuivre, diamants, pétrole. Mais attisent aussi des conflits, dont les plus récents sont connus : 1961, une guerre coloniale achevée par l’indépendance en 1975 et suivie par trois guerres civiles entre Unita et MPLA d’abord, puis entre partis pro-occidentaux et partis soutenus par l’URSS et Cuba au début des années 1980, et enfin après les élections de 1992. L’Angola en sort comme un géant meurtri, aux potentialités fortes mais non encore épanouies.
Le livre utilise en outre les travaux réalisés par la jeune génération historienne qui a notamment compulsé les archives salazaristes ouvertes à Lisbonne. De quoi renouveler notre regard sur un pays méconnu.
L’Histoire – Août 2019
Cette synthèse historique vient combler un vide éditorial sur ce grand pays mal connu à la croisée de l’Afrique centrale et australe. Historien de référence, l’africaniste David Birmingham, de l’université du Kent, examine les dynamiques sociales, économiques et géopolitiques de l’Angola, en s’appuyant notamment sur des récits de grands voyageurs du XIXe siècle et quelques grands romans angolais. Point de départ de l’étude : l’année 1820, amorce d’une évolution de la colonisation portugaise qui développe un nouveau type de programme économique à partir de la conquête de l’intérieur. De l’analyse des dynamiques socio-économiques coloniales à la répression, à partir des années 1950, des mouvements de libération nationale (le déclenchement de la lutte de libération a lieu en 1961), de l’indépendance, obtenue de haute lutte en 1975, aux guerres qui ont suivi, sur ce territoire riche en cuivre, en diamant et en pétrole, Birmingham offre une synthèse remarquable qui permet de mettre en perspective les difficultés rencontrées par l’Angola pour vivre en paix depuis la fin de la guerre civile en 2002.
Tigrane Yegavian – Le Monde diplomatique – Juillet 2019
Ce grand pays qu’est l’Angola
À Luanda, la capitale, les murs sont peu volubiles. La guerre civile qui a commencé avec l’annonce de l’indépendance, en 1975, a détruit de nombreuses traces du passé pour écrire une nouvelle page de l’histoire. Vainqueur du conflit, le Mouvement populaire de libération de l’Angola, devenu un parti-État toujours au pouvoir, s’est chargé de la reconstruction et de la gestion hasardeuse des milliards de pétrodollars. Tant sur le plan diplomatique que militaire et économique, l’Angola est devenu une puissance régionale encore méconnue et secrète. L’historien britannique David Birmingham reconstitue avec précision le grand récit des deux derniers siècles. Il revient bien sur la découverte, par des missionnaires chrétiens et des commerçants juifs, à la fin du XVe siècle, de royaumes structurés. Mais c’est en 1820, avec la « fabrique d’une colonie », que débute vraiment le livre, qui s’achève en 2017, sur l’élection du président João Lourenço et sa lutte anticorruption visant le clan de son prédécesseur. Ce livre captivant, magnifiquement édité, raconte sans jugement l’histoire d’un grand pays d’Afrique.
Joan Tilouine – Le Monde – Mai 2019
Les éditions Chandeigne proposent Histoire de l’Angola de 1820 à nos jours, la traduction française du célèbre A Short History of Modern Angola du Pr. David Birmingham de l’université du Kent : une synthèse incontournable sur ce pays à la croisée entre Afrique centrale et Afrique australe.
Géant régional en pleine mutation depuis la prise du pouvoir par Lourenço, l’Angola reste paradoxalement mal connu en France au regard de son poids en Afrique. La recherche académique contemporaine sur l’Angola a été profondément marquée par la lutte contre la colonisation portugaise puis par les enjeux politiques et idéologiques liés aux guerres civiles. Car, dans la deuxième moitié du XXesiècle, le pays n’a pas connu moins de quatre guerres : la guerre coloniale commencée en 1961 et qui aboutit aux combats de libération nationale ; la guerre interventionniste de 1975 qui voit à la faveur de la proclamation d’indépendance l’affrontement entre l’UNITA de Jonas Savimbi et le MPLA d’Agostinho Neto qui s’empare du pouvoir ; la guerre de déstabilisation des années 1980 qui s’inscrit dans une géopolitique de la guerre froide avec l’engagement du Zaïre de Mobutu et de l’Afrique du Sud de l’apartheid aux côtés de Savimbi contre les soutiens russes et cubains de Neto puis de Dos Santos (Neto meurt en 1979) ; et enfin la guerre civile qui éclate en 1992 après que Savimbi refuse de reconnaître les résultats des premières (et seules, selon Birmingham) élections libres en Angola qui voient le maintien au pouvoir du MPLA.
David Birmingham décrypte les dynamiques de l’Angola avec le recul de toute une vie de chercheur commencée dans les premiers feux de la lutte anticoloniale commencée en 1961. Il s’inscrit aux côtés des travaux de Christine Messiant, René Pélissier et Jill Dias (à qui il dédie ce livre) : c’est-à-dire une génération engagée, qui a suivi tout ce cycle des guerres et des combats politiques et idéologiques. Ces combats ont accouché d’autres combats, scientifiques cette fois : ils ont joué comme autant de facteurs plus ou moins mis en valeur ou jugés déterminants dans les recherches académiques pour expliquer les causes de l’affrontement UNITA-MPLA dans une longue guerre civile (qui ne prend fin qu’avec la mort de Savimbi en 2002). Ont ainsi été avancés suivant les chercheurs des arguments idéologiques autour de la Révolution et de la guerre froide en Afrique, des arguments ethniques pour justifier la composition des camps angolais, des arguments économiques liés à l’héritage de la colonisation puis à l’exploitation du pétrole (et des diamants), des arguments politiques pour expliquer la logique de l’affrontement entre Savimbi et Neto puis Dos Santos.
La profondeur de cet ouvrage réside dans le choix de remonter à 1820 pour reconstituer les mécaniques de la construction coloniale : des liens entre les royaumes d’Afrique centrale (Kongo, Angola, Matamba, etc.) se nouent depuis la fin du XVesiècle, la décennie 1820 constitue un profond changement: le Brésil (principal territoire colonial portugais) prend son indépendance en 1822, la question de l’esclavage transatlantique évolue et Lisbonne développe un nouveau programme économique colonial en Afrique australe. Les titres des cinq premiers chapitres de cette Histoire de l’Angola donnent à comprendre les dynamiques socio-économiques à l’œuvre au fil du XIXesiècle : « la fabrique d’une colonie » (1), « culture urbaine de la ville de Luanda » (2), « commerce et politique dans l’arrière-pays » (3), « terre et main d’œuvre au Sud » (4), « du commerce des esclaves au peuplement blanc » (5). Ou comment le Portugal colonial passe du trafic des esclaves au travail forcé dans sa colonie Atlantique d’Afrique, au fil du siècle, suscitant de profonds bouleversements géopolitiques dans la sous-région. Le Portugal construit son troisième empire colonial, après la perte de ses colonies d’Asie puis de ses colonies d’Amérique.
Mais ce livre n’est pas qu’une synthèse de vie de recherche. À l’image de certains espoirs qui concluent le postscrip de son ouvrage pour l’édition française de 2019, David Birmingham regarde aussi vers l’avenir – en premier l’avenir de l’écriture de l’histoire de l’Angola. Il livre une leçon de méthodologie historique en saluant les innovations de la nouvelle génération d’historiens et d’historiennes de l’Angola. Profitant des ouvertures des archives salazaristes à Lisbonne, ils sont parvenus à retrouver les traces des mouvements de libération nationale dans les archives de la redoutable PIDE, la police politique portugaise. Celle-ci a été envoyée massivement aux colonies à partir de la fin des années 1950, pour mettre en place un sévère régime de répression multiforme. Mais trouver les archives ne suffit pas : il salue le travail entrepris par cette nouvelle génération d’historiens et d’historiennes pour critiquer ces sources et ainsi déconstruire le regard colonial. Reste à savoir si les changements entrepris en Angola avec la prise du pouvoir d’une nouvelle génération, incarnée par Lourenço, qui n’a pas connu les maquis des années 1960-1970-1980 et qui n’entretient pas le même rapport à la guerre civile, va constituer un facteur de changement autour de l’histoire contemporaine de l’Angola.
Il faut enfin saluer les éditions Chandeigne qui accomplissent un travail éditorial et scientifique unique en son genre, pour promouvoir l’histoire et les cultures des mondes lusophones et de l’Afrique lusophone.
Jean-Pierre Bat – Blog Africa4 – Février 2019