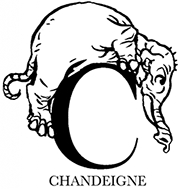Le dernier écrit de Tabucchi
Une nouvelle inachevée d’Antonio Tabucchi paraît aux éditions Chandeigne, sept ans quasiment jour pour jour après la disparition de l’écrivain italien. Sa voix revient, reconnaissable entre toutes dans la littérature européenne. Et enfin septembre vint est publié dans une édition trilingue : la version italienne a été traduite en portugais par Maria José de Lancastre et en français par Martin Rueff, qui est également l’auteur d’une postface, capitale pour comprendre la démarche de création tabucchienne mais aussi l’entreprise éditoriale, l’une n’allant pas sans l’autre ici.
On peut se demander ce que serait le texte de Tabucchi sans Maria José de Lancastre et Martin Rueff qui en ont préparé l’édition et en assurent l’entière intelligibilité. La postface de Martin Rueff, qui intègre une note de Maria José de Lancastre, expose les conditions de création de la nouvelle. « Et enfin septembre vint » date de quelques mois avant la mort de l’auteur : elle a été écrite d’un seul jet et est consacrée à un souvenir raconté à l’écrivain. Alors qu’elle était étudiante à la faculté des lettres de l’université de Lisbonne dans les années 1970, Helena Abreu a participé à un voyage organisé par son professeur de linguistique portugaise, dans un petit village de la région de Trás-os-Montes, au nord-est du pays, afin d’enquêter, sur le terrain, sur certaines particularités linguistiques. Cette expédition a été marquée par le surgissement de l’innommable, de l’inarticulable, dont elle a été témoin.
Le texte de Tabucchi s’interrompt, brutalement, au moment même où l’événement, ce qui fait événement, se produit. Le noyau du souvenir d’Helena Abreu est raconté dans la postface. Ce qui fait événement, ce qui suscite l’écriture même de la nouvelle, ne se produit pas dans le texte, n’est pas articulé dans le langage tabucchien. À la place, un trou. C’est la fin du récit, brutale, dont on sait aussi qu’elle correspond à la disparition de l’auteur. Double manque qui fait de cette nouvelle un hurlement silencieux. L’événement perfore le texte et surgit à côté, dans la parole de l’autre, celle de Maria José de Lancastre, grâce à laquelle ce texte existe aujourd’hui pour nous, accompagnée de celle de Martin Rueff. Quoi de plus tabucchien que cette mise en scène de la parole, faite d’autres paroles, autour, qui plus est d’un personnage fantomatique, celui de l’écrivain disparu ? Comment ne pas penser à Pereira et ses fantômes, dans le magnifique Pereira prétend, errant, fantomatique, dans un Portugal pourri par Salazar ? Et à l’élaboration même du récit, né de la visite du doutor Pereira, un soir de septembre 1992, cet homme aux traits pas encore bien définis, « personnage en quête d’auteur » présenté par l’auteur dans une note sur le texte, genre qu’il affectionnait tant ?
Le texte de Tabucchi seul aurait la force poétique caractéristique de l’écrivain italien. Son inachèvement en fait la force, précisément parce que ce qui manque, et ce qui crie et fait retour avec force, ce qui hante, coïncide avec ce que Tabucchi avait à cœur de dire dans la nouvelle et correspond donc à l’impulsion même du geste d’écriture. On retrouve la voix de l’immense auteur de Tristano meurt dans la forme même de la nouvelle. Le titre même, formule inaugurale de la nouvelle qui la rythme ensuite, « Et enfin septembre vint », qu’il faudrait entendre en italien, « E finalmente arrivò il settembre », fait renaître la force d’évocation des rythmes et des images de l’auteur, qui en quelques lignes fait voir et sentir le Tage, une piste qui traverse l’Alentejo, les montagnes de Monchique, les plages de l’Algarve, à l’époque où il n’y avait rien ni personne, hormis « de rares villages de pêcheurs, des cabanes de feuilles çà et là, très loin, sur ces étendues de sable, le paysan vendait melons, figues et pastèques ». La poésie des lieux, des odeurs, de ces gens qui hantent les récits de Tabucchi, renforce encore la réflexion de l’auteur. Tout est lié, poésie des sens, langue et politique. Et la langue devient l’objet même de ce texte inachevé, cette langue qui « appartient au ciel », car « le corps est une misère faite de chair, d’os et de sang, il souffre si on le touche ». Il n’est jamais question, faut-il le préciser, d’un hymne à une langue, et une seule, mais bien d’à quel point on se fait voix lorsqu’on est écrivain, à l’image de Tristano, voix émergeant des draps trempés de fièvre et salis par la gangrène, qui s’interroge, à l’aube du XXe siècle, sur la démocratie.
Dans Et enfin septembre vint, ceux qui croyaient fermement en la démocratie ont disparu, comme ce professeur de linguistique qui fait naître une « nostalgie déchirante », car à l’époque de Salazar, explique la voix, malgré évidemment la tragédie que vit le Portugal, « au-delà du puits dans lequel nous nous sentions enfoncés, nous étions persuadés qu’il y avait une flammèche, comme la veine d’or d’une mine cachée dans les viscères de la terre, et qu’il nous appartenait de découvrir cette veine, et qu’une fois que nous l’aurions trouvée, nous serions remontés à la surface de la terre en tenant dans nos mains une poudre d’or et que nos amis et nos parents qui nous attendaient inquiets nous auraient embrassés, pleins de reconnaissance pour le trésor que nous remontions des viscères de la terre ». Il semble que cet espoir, vivace alors même que les morts s’accumulent, dans ces pays où les jeunes Portugais sont envoyés et se font tuer pour une « guerre absurde », n’a plus lieu d’être. Et enfin septembre vint est aussi une réflexion politique sur l’Europe d’aujourd’hui par une voix qui, malheureusement, se tait, brutalement et nous laisse un peu plus seuls. La voix de Tabucchi manque cruellement aujourd’hui, ce texte nouvellement paru est une invitation à le lire et le relire, à se souvenir de sa luminosité politique et poétique.
Gabrielle Napoli – En attendant Nadeau – Juin 2019
Un cri de colère de Tabucchi, interrompu par sa disparition
En trois langues, la dernière nouvelle de l’écrivain italien dit l’absurdité de la guerre coloniale
Ce petit livre trilingue et posthume rassemble les pôles culturels d’Antonio Tabucchi (1943-2012): l’italien de Pise, Florence et Sienne, sa langue originelle; le portugais de son épouse, Maria José de Lancastre, avec laquelle il a traduit tout Pessoa avant d’écrire Requiem directement dans cette langue; et le français qu’il parlait parfaitement, lui qui aimait tant séjourner à Paris, comme le montre une belle photo prise sur les quais.
Et enfin septembre vint est une nouvelle dont la mort a interrompu l’écriture. Pour en comprendre les enjeux politiques, poétiques et linguistiques, il faut lire les explications de Maria José de Lancastre, qui l’a traduite en portugais, et les commentaires de Martin Rueff. Il s’agit d’une «excursion dialectale» qui a vraiment eu lieu à la fin des années 1960: un célèbre professeur de linguistique avait coutume, à la fin de l’été, d’emmener ses étudiants dans les provinces reculées du Portugal pour recueillir des archaïsmes en voie de disparition.
Cette année-là, c’était dans le Trás-os-Montes, au nord du pays. Mais avant qu’enfin septembre vienne, Tabucchi évoque les grandes chaleurs d’août dans un Portugal encore épargné par le tourisme de masse, quand la bonne société prend le frais au bord de l’océan, indifférente à la misère du pays et aux combats outre-mer.
Télégramme funeste
Le pays est enlisé dans une époque «funèbre», «quand tout le monde pensait que la dictature de Salazar ne finirait jamais, qu’elle durerait toujours». Au Mozambique, en Angola, en Guinée portugaise, dans l’Ultramar des colonies, c’est la guerre, celle qui hante les romans de Lobo Antunes. Elle demande son lot de jeunes vies, petits soldats appelés au service militaire du fond de leur campagne. Et quand les jeunes linguistes débarquent au village dans leur minibus de la Croix-Rouge, obtenu par privilège, ils trouvent surtout des vieillards édentés, au grand dam du professeur qui craint l’altération des phonèmes.
Pendant une de ces enquêtes éclatent des cris, «perçants, inhumains presque, comme un chœur de tragédie grecque, qui pénétraient les âmes comme un feu brûlant», laissant les étudiants pétrifiés. C’est l’arrivée d’un télégramme, un de plus, annonçant la mort en Afrique d’un garçon du village, pendant que sa grand-mère continue à «ânonner des mots dans le magnétophone». Mais ce cri, c’est Maria José de Lancastre qui le décrit dans sa notice. La phrase de Tabucchi s’interrompt avant qu’il n’explose, brutalement, mais on comprend que tout le récit tendait vers cette éruption de douleur et de colère contre l’absurdité de la guerre.
Isabelle Rüf – Le Temps – Avril 2019
Nord du Portugal, 1970. Ou bien serait-ce 1971 ? Une petite équipe d’étudiants en linguistique se rend dans un village pour recueillir et enregistrer la diction si particulière des Transmontanos. Quand soudain, un cri perçant vient arrêter l’enquête : l’une des villageoises présentes apprend la mort d’un de ses petits-fils, parti affronter la guerre d’indépendance en Afrique. Ce récit, inachevé par la mort d’Antonio Tabucchi, est inspiré d’une conversation réelle avec l’une de ses amies ayant participé, dans sa jeunesse, à l’expédition ethno-linguistique. A l’évocation d’une époque révolue, se dessinent des problématiques chères à l’écrivain lusophile : le caractère politique et ethnologique de la langue parlée, la critique de tout totalitarisme, la lutte acharnée contre l’obscurantisme. Cette nouvelle, écrite en 2011, n’est pas l’évocation innocente d’une étude universitaire sur le terrain. Elle met en relation un passé qui semble n’appartenir qu’aux archives et une réalité malheureusement très présente, la plume d’un écrivain militant et la voix d’un peuple, le silence, le cri et l’action. Car écrire, c’est agir, c’est transgresser, c’est garder en vie un monde qui se meurt. C’est échapper à l’oubli. Ecrire, c’est pousser un cri pour raconter ce qui se passe, pour articuler la société aux personnes qui la composent, envers et contre tout. C’est la langue, celle des humbles, analysée par ces étudiants en linguistique, qui véhicule et transmet les vertus de l’humanité : l’authenticité, la bienveillance, l’empathie, le souci d’autrui, l’innocence. Des valeurs que les mouvements fascistes veulent éliminer, à coups de démagogie ou autres malversations. « Ces gens » dit-il en reprenant les mots d’une de nos plus grandes poétesses, Sophia de Mello Breyner Andresen, qui « renouvellent ma passion pour la lutte et la bataille contre le vautour et le serpent, le porc et le rapace, car ces gens qui ont le visage creusé par la patience et la faim, ce sont les gens avec lesquels un pays occupé écrit son nom. » A l’heure où l’on tend à fermer de plus en plus les frontières, à faire de l’étranger un « autre » que soi, il est urgent de parler, de raconter, de laisser exprimer de vive voix cette langue propre à l’humanité, le langage du cœur. Présenté en italien, en français, en portugais, Et enfin septembre vint est un véritable appel à la découverte et à la prise de parole. Car comme le dit si bien Martin Rueff dans la postface, citant la philosophe Hannah Arendt, « A chaque fois que le langage est en jeu, la situation devient politique par définition, parce que c’est le langage qui fait de l’homme un être politique. »
Ana Maria Torres – CAPMag – Avril 2019
Acabou de chegar às livrarias francesas“Et enfin septembre vint”,uma novela inédita de Antonio Tabucchi (Vecchiano, 1943/Lisboa, 2012), o mais português dos italianos, escritor que encontrou em Portugal uma fonte inesgotável de inspiração. Esta edição, a cargo da Chandeigne, é trilingue – italiano, português (tradução de Mária José Lencastre) e francês (tradução de Martin Rueff). Tabucchi, nos meados dos anos 60, descobriu Portugal em Paris ao comprar a tradução francesa do Poema “Tabacaria” de Fernando Pessoa (ou, melhor,dos eu heterónimo Álvaro dos Campos). A partir desse instante, Portugal e as culturas lusófonas tornaram-se a obsessão de Tabucchi. Pouco depois visitou Lisboa, apaixonando-se pela cidade,pelo fado e escolheu o estudo do surrealismo português como tese académica. Casou-se com uma portuguesa (Maria José Lencastre, a tradutora desta obra) e tornou-se professor de língua e literatura portuguesas na Universidade deBolonha. Após uma longa carreira literária – “Afirma Pereira”(1994) será a sua obra de maior destaque-, Antonio Tabucchi morreu de cancro na cidade de Lisboa em 2012. Após a morte do escritor, a sua esposa foi descobrindo cadernos atrás de cadernos com textos inacabados, entre os quais se encontrava “Et enfin septembre vint”. Maria José Lencastre começou a transcrever, apesar da caligrafia difícil de decifrar, e a traduzir. O texto, escrito por Tabucchi em 2011, inspira-se numa história contada pela sua amiga Helena Abreu que, nos fins dos anos 60, participou nas “excursões dialetais” organizadas pelo célebre professor de Linguística Luís-Filipe Lindley Cintra. A ação desenrola-se numa aldeia perto de Chaves, em Trás-os-Montes e conta o drama ocorrido quando chegou um telegrama à aldeia com a notícia da morte na Guerra Colonial de um jovem aldeão. Essa terá sido uma das experiências humanas que mais marcou Lindley Cintra.
Nuno Gomes Garcia – Lusojournal – 13 mars 2019