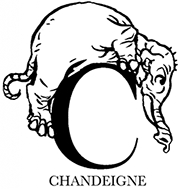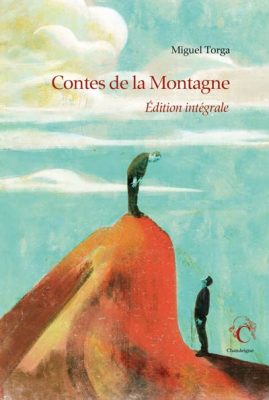- Télérama
- Luxemburger Wort
- Le Monde Diplomatique
- Le Temps
- La Croix
- CAPMag
- En attendant Nadeau
- L'amour des livres
Trois raisons de (re)lire… Miguel Torga, le médecin poète
Fin observateur de ses contemporains comme de la société dans laquelle il vivait, l’écrivain portugais Miguel Torga fut un conteur et un diariste fabuleux. Ses nouvelles et son journal sont à (re)découvrir de toute urgence.
1. Parce que sa biographie embrasse l’histoire du XXe siècle portugais
Il est, au Portugal, le médecin ORL le plus poète, ou le poète le plus calé en médecine, comme on voudra. Né dans le Nord-Est du Portugal, dans la région aride de Trás-Os-Montes, fils de paysans pauvres, Miguel Torga (1907-1995), de son vrai nom Adolfo Rocha – il a choisi Miguel pour Cervantes, et Torga comme la bruyère sauvage –, passe par le séminaire, seul lieu d’études possible pour un fils de paysan et, à l’âge de 13 ans, part pour le Brésil, où il sera garçon de ferme.
Revenu au Portugal, Miguel Torga s’inscrit en médecine et publie déjà un « livre de vers » – qu’il détruira plus tard. Une fois diplômé, il exerce dans les campagnes et observe ses compatriotes : des médecins jaloux qu’un fils de paysan puisse venir leur piquer leur clientèle et des patients décidément… bien trop patients : « Un Portugal vieillot et routinier, de maîtres et d’esclaves […] Parasites du peuple, le curé, le médecin, l’instituteur et le juge, au nom de Dieu, du Savoir, de la Loi ou d’Esculape, exigeaient toutes sortes de dîmes, en commençant par la plus concrète : l’obole des fruits de la terre ».
Il va alors voyager : en Espagne d’abord, en pleine guerre civile, avec deux amis qui ne partagent pas ses opinions de gauche et craignent ses réactions, puis dans l’Italie fasciste et en France. Ce qu’il voit, Torga veut l’écrire : « Encore foudroyé par l’éclair révélateur du voyage, qui m’avait ouvert les portes d’une Europe convulsée pour me rendre à ma patrie écorché vif, en me donnant la vision anticipée et infernale du monde apocalyptique dont les journaux disaient désormais quotidiennement des nouvelles – l’Espagne républicaine vaincue et exilée, partout les totalitarismes emphatiques et triomphants, le vieux continent déchiré, voire menacé de mort –, je tentais de traduire le plus fidèlement possible le choc que j’avais ressenti en ces jours décisifs de dispersion avide et déchirante », notera-t-il dans La Création du monde, son livre autobiographique.
En 1939, la police politique (P.I.D.E.) de la dictature « cathédratico-militaire » de Salazar (le professeur d’économie de Coimbra, Premier ministre de 1932 à 1968) l’emprisonne quelques semaines, et désormais ne le lâchera plus, plaçant des policiers jusque devant son cabinet médical et interdisant ses livres. Une dictature comme une chape de plomb : « Les consciences se taisaient, au plus profond de leur profondeur, de crainte de lâcher un mot révélateur ».
Aujourd’hui, à Coimbra où le nom de Torga est partout, on peut lire sur un mur ce graffiti, comme un clin d’œil : « O único tirano que admitimos é a voz da nossa consciência » (« Le seul tyran que nous acceptons est la voix de notre conscience »).
2. Parce qu’il est un diariste exceptionnel
Dans les deux volumes de son journal, En Franchise intérieure (1933-1977) et En Chair vive (1977-1993), Miguel Torga consigne ses lectures, ses impressions, ses rencontres et ses observations sur la société dans laquelle il vit. « Tant de journaux, tant de radios, tant d’agences de presse, et jamais l’humanité n’a autant marché à tâtons. Chaque heure qui passe est une énigme camouflée sous un millier d’explications. La vérité, de nos jours, est comme l’ombre du mensonge » (26 février 1947).
Il se méfie de l’enthousiasme que suscite le football, « cette dégradation de l’instinct ludique de l’homme, cette combativité mercantile des uns et cette furie passive des autres, qui gagne du terrain et envahit le monde ». La « Révolution des Œillets », en avril 1974, il la vit avec soulagement, mais aussi méfiance : « Coup d’Etat militaire. Ah ! si je pouvais faire confiance aux militaires. Mais ce sont eux qui, pendant les abominables cinquante dernières années, nous ont arrêtés, censurés, incarcérés, et qui ont, par la force des baïonnettes, conservé le pouvoir à la tyrannie. Qui pourrait l’oublier ? Mais bon ! Quoi qu’il en soit, c’est toujours un pas de fait. Reste à espérer que ce ne soit pas, et pour longtemps, le pas de l’oie ».
Il y adhère, évidemment, étant proche de Mario Soares, l’ancien opposant exilé qui deviendra président de la République de 1986 à 1996, mais Torga, décidément libre, n’est pas un militant encarté : « Il est une chose que je ne pourrai jamais pardonner aux politiques, écrit-il le 14 novembre 1985 : c’est de laisser mon espérance systématiquement sans recours ». Le poète n’a donc pas sa place sur les tribunes sauf à se parer du nom pompeux d’ « intellectuel », appellation souvent frauduleuse et trop partagée qu’il récuse : « Dans ce pays (et certainement dans les autres), quand un gouvernement frappe à la porte d’un poète, ce n’est jamais pour rendre hommage à la poésie. C’est pour tirer parti du peu de prestige qu’elle a encore ».
Même s’il suit de près l’actualité internationale, refusant de signer les pétitions (sauf pour la libération de Sakharov) et refusant aussi les prix littéraires, il reste solitaire, luttant toujours avec un poème.
3. Parce qu’il est un observateur clairvoyant de la nature humaine
Poète et diariste, Miguel Torga est aussi un magicien de la nouvelle. En témoignent ses Contes de la Montagne, un volume composé de 45 nouvelles écrites entre 1939 et 1980. Torga aime à travailler sur des textes courts qui traduisent des morceaux de vie, des situations ou des personnages. Dans les montagnes du nord du Portugal, les petits villages sont cernés par la chaleur l’été ou la neige l’hiver. Chacun se connaît et s’observe, médit ou vient en aide, propage ragots et rumeurs.
Car tout se sait. La jolie Lidia, par exemple, « bien faite, un teint de fleur, avec ces deux yeux de velours qui faisaient fondre les pierres », a une véritable meute à ses trousses et, amusée par les querelles qu’elle suscite, excite la jalousie de ses prétendants sans se résoudre à en choisir un. Joana, elle, se sait envoûtée par un mauvais sort et le bellâtre Arlindo, tombeur impénitent, apprendra à ses dépens ce qu’il en coûte de séduire toutes les femmes qui passent à sa portée.
Vies misérables ou heureuses, agrippées les unes aux autres par le fait de l’exiguïté des espaces villageois ou par les légendes qui descendent des montagnes, les femmes et les hommes que peint Torga sont l’expression même de la nature humaine, avec toutes ses facettes, qu’elles soient veules, insouciantes ou héroïques – à l’image de ce petit berger qui combat un loup.
Torga s’est toujours souvenu du milieu d’où il venait. Et quand il écrit sur cette population démunie et travailleuse, ce n’est ni pour la dénigrer ni pour l’embellir. Mais, plus sûrement, pour lui donner une place dans la littérature dont on la prive.
Gilles Heuré – Télérama – Mai 2018
Les âpres nouvelles d’une forte tête
C’est au cœur de la région natale de Miguel Torga, à Trás-os-Montes, que se déroulent les 45 nouvelles qui composent les Contes de la Montagne (1941) et Nouveaux contes de la Montagne (1944), intégralement disponibles désormais dans une seule et même édition.
Poète, romancier et dramaturge portugais, Miguel Torga (1907-1995) – Adolfo Correia da Rocha de son vrai nom – figure parmi les auteurs lusophones les plus traduits. Médecin, il écrit sa vie durant sans jamais abdiquer de son métier. Tous les livres qu’il publie de son vivant le sont à compte d’auteur, non pas qu’il ne trouve pas d’éditeur, mais par esprit d’indépendance, pour rester fidèle à son nom de plume “Torga”, qui désigne une bruyère de montagne particulièrement résistante et, en langage populaire, une “forte tête”.
En 1939, le bien nommé Torga connaît des démêlés avec le régime fasciste et verra ses écrits frappés par la censure salazariste, qui voit dans ces textes une dérangeante mise à nu des conditions de vie des habitants du nord-est du Portugal, province négligée par le “Estado Novo”.
Dans ces courtes nouvelles (trois ou quatre pages parfois), toutes déclinées suivant une narration linéaire, le registre est réaliste et puise dans le sol aride de Trás-os-Montes. Fil rouge et terreux de ces contes : la miséreuse condition de vie de ces paysans laissés-pour-compte, dont les comportements souvent désarmants et le langage brut font tout le sel de ces “Contes” pittoresques, écrits et revus par l’auteur entre 1939 et 1980.
Rédigés dans une langue sobre et lapidaire, ces récits vibrent d’une tension universelle : celle des passions humaines. En proie à la famine, à la misère, à l’isolement et à la folie, ce peuple malmené et isolé du nord-est du Portugal se livre à des réglements de compte homériques, dont l’auteur rend compte avec verve, lucidité et empathie (“comme les grappes qu’on allait couper, elle aussi était mûre pour le pressoir de la mort.”).
La mort est un thème récurrent, comme dans ce conte évoquant la manière dont on fait tinter la cloche pour signifier un trépas : “Et dans ces variantes le défunt retrouvait son propre humus; il quittait ce monde pour l’autre, enseveli dans sa vérité native.” L’écrivain-médecin sonde les humeurs revêches, ausculte les pulsions archaïques, jauge les blessures intimes sans jamais porter de jugement; c’est dans ces fêlures qu’il puise son inspiration, comme c’est dans la rudesse de cette contrée qu’il enracine son oeuvre.
Dressant “un tableau frustre et agreste” de cette province, Torga n’oublie jamais pourtant d’en faire jaillir la vie, avec des accents parfois lyriques commes dans “Les litanies” : “Le flot des gens, tel un Douro de litanies, continuait à s’écouler. Après le Moulin de Seixos, la forêt de Lamarosa; après la friche de l’Infantado, les aulnes de Fonte Fria.”
Le comique de mots, de gestes ou de caractères n’est pas en reste : on goûtera de grinçantes caricatures paysannes, beaucoup d’histoires de superstition voire du vaudeville (“et alors que sa femme allait ouvrir la bouche, effrayée par sa présence inopinée et son mauvais air, il la saigna au couteau, comme on saigne un porc”) et des formules pleines d’esprit (“La vie de muletier est une vie de juif errant”). On songe immanquablement à Maupassant en lisant Torga sous la plume de la traductrice Claire Cayron, qui rapporte ces récits ruraux avec force justesse et dans une langue classique soignée. Mais ce que l’on retient in fine de cette lecture, c’est l’attachement du conteur à sa terre natale, qui innerve ses récits comme une complainte. “Brûlés, ridés, les visages des vieux sont autant de parchemins millénaires sur lesquels une plume cruelle a écrit de profondes et tragiques histoires (…)”, note Torga dans l’une des quatre préfaces à ses ré-éditions, qui se trouvent reproduites en fin d’ouvrage. On songe alors à “Maria Lionça”, une mère septuagénaire qui rapatrie le corps de son fils matelot depuis le port de Leixões jusqu’à Galafura, d’abord en train, puis sur un mulet, afin de l’enterrer au village.
C’est tout à l’honneur des éditions Chandeigne, spécialisées dans les publications lusophones, d’avoir réédité une traduction d’abord parue chez José Corti (1994), faisant ainsi vibrer les grands classiques de la littérature portugaise du XXe siècle.
Sonia da Silva – Luxemburger Wort – août 2017
Une lumière d’éternité
“Je fais partie des rares Portugais qui peuvent se vanter, chaque fois qu’ils déclinent leur identité d’être du Portugal tout entier”, jurait, au soir de sa vie, le poète, romancier et conteur Miguel Torga (1907-1995). Du Portugal tout entier : du peuple et de l’élite, de la montagne et de la plaine, de l’intérieur et de l’extérieur, du corps et de l’âme, de l’avant-hier et de l’après-demain. Européen de cœur et d’esprit effrayé par l'”irresponsabilité de Maastricht”, “Portugais hispanique” opposé à l’union ibérique, ce citoyen du monde fier de ses origines, né dans la petite ville de São Martinho de Anta et pas ailleurs, est convaincu, comme il le dit lors d’une conférence prononcée au Brésil en 1954, que “l’universel, c’est le local moins les murs”. Et il célébrera le Trás-os-Montes, sa province natale, dans le nord-est du pays, à travers chacun de ses textes : ses poèmes, son grand roman autobiographique intitulé La création du monde, son journal et ses Contes et nouveaux contes de la montagne, réédités aujourd’hui.
Chant du monde et des humbles, ces courtes histoires gravées dans la pierre dure et le bois tendre mettent en scène une humanité dont l’écrivain veut se souvenir : des paysans, des bergers, des mendiants, des ivrognes, des curés, des enfants trouvés. Il n’y a pas de Dieu dans le ciel de Miguel Torga, mais une lumière d’éternité qui sauve du grotesque les superstitions de son peuple, donnant des allures de légende dorée à chacun de ses récits ciselés avec une économie de moyens qui est tout le contraire de la prose ample et rêveuse de La création du monde. “Depuis ma jeunesse”, expliquait l’écrivain dans la préface de la cinquième édition des Contes et nouveaux contes de la montagne, “je me bats pour un art aussi pur que possible dans ses moyens et aussi vaste que possible dans ses fins”.
Quarante-cinq contes nous invitent à visiter le Trás-os-Montes comme un “royaume merveilleux” caché tout en haut du Portugal. Un royaume où les animaux et les hommes se réveillent à l’aube frémissants d’impatience, et se couchent à la nuit tombée rassasiés de soleil et de joies païennes. Chez Torga, les saints comme les voleurs sont prudents, réalistes et tendres. “Le temps leur avait donné la clef de cette existence, finalement destinée à endurer la souffrance plutôt qu’à savourer la joie.” Heureusement, il y a le mimosa familier et la fontaine sur la place. Et des malheureux, condamnés “à boire l’eau des ruisseaux et manger des pierres” quand les portes se ferment sur leur passage, qui trouvent le moyen d’allumer des étoiles dans le ciel.
À lire ces récits rustiques dont les protagonistes s’obstinent à croire au bonheur, on découvre que le Portugal rural laminé par les normes économiques et techniques édictées à Bruxelles était un matriarcat d’un genre un peu particulier. Le culte de Notre-dame de Fátima, apparu en 1917, n’y avait que partiellement fait oublier Diane, dont un temple aux colonnes corinthiennes subsiste à Évora. Jamais, dans les Contes et nouveaux contes de la montagne, que l’écrivain a dédiés à son épouse Andrée Crabbé, essayiste et théoricienne de la littérature d’origine belge qui a traduit quelques-uns de ses textes en français, les femmes ne sont pas sans qualité. L’écrivain prend un plaisir infini à les peindre, à détailler leurs plus aimables attraits, à les faire vivre, aimer, lutter, souffrir et parfois mourir. Il y a Mariana, sortie de la nuit des temps, qui provoque le désir des hommes et leur incompréhension : “La pureté avec laquelle elle se donnait à eux frappait d’une immense force créatrice et irresponsable qui les rendait immatériels, comme des dieux lointains”; Margarida, qu’un lépreux regarde “avec des yeux de mouton bêlant”; et la fatale Isaura, “mignonne, gaillarde, à rendre le soleil jaloux”.
Des vies minuscules, immenses sous la loupe de l’écrivain.
Sébastien Lapaque – Le Figaro – juillet 2017
Un Portugal de granit
Entre 1939 et 1980, Miguel Torga écrit 45 contes qui décrivent la vie rude des paysans du nord du Portugal, région dont il est issu. Ce sont des terres de maquis et de chênes-lièges, cultivées avec des moyens archaïques, dans un contexte féodal et bigot. « Famine, ignorance, désespoir », constate l’auteur, en préface d’une édition censurée par la dictature en 1945. Médecin, il sait aller en peu de mots au coeur des gens et des choses. Sa langue aussi a un accent granitique qui s’accorde avec ces histoires qui n’ont rien de féerique, drôles, tragiques, poétiques, toujours fraternelles.
Isabelle Rüf – Le Temps – 1er juillet
Les destins obstinés de Miguel Torga
Le chef-d’oeuvre du grand auteur portugais du XXe siècle relate en 45 nouvelles des moments dérobés à la vie de paysans du nord-est du pays, entre joies et drames.
Peut-être faudrait-il commencer par la fin pour mieux appréhender toute la puissante mélancolie qui imprègne ce livre. Par les quatre préfaces écrites par l’auteur aux différentes éditions de ce recueil de nouvelles âpres et sauvages comme les montagnes de la province de Trás-os-Montes qui l’ont vu naître, dans le nord-est du Portugal. Miguel Torga (1907-1995), écrivain majeur de la littérature portugaise du XXe siècle, y raconte la censure implacable qui s’est abattue sur ce « livre au destin difficile ».
Saisis et interdits dès leur parution en 1941, les Contes de la montagne ont vu leurs héros « d’encre et de papier » s’exiler au Brésil (c’est là que les premières nouvelles seront publiées), par manque de liberté, comme « tant de Portugais de chair et d’os » ont été contraints de le faire, par manque de pain. Salazar règne en despote depuis 1928, muselant d’un gant de fer toute opposition, prisonniers politiques et simples citoyens s’entassant dans ses geôles (Torga y sera emprisonné entre 1939 et 1940) ou cherchant l’exil outre Atlantique.
Les Éditions Chandeigne, dédiées au monde lusophone (lire le portrait de Michel Chandeigne dans La Croix du 24 mars 2015), viennent de republier dans leur intégralité dans une édition soignée ces quarante-cinq nouvelles, courtes, parfois juste quelques pages, écrites dans une langue sobre et concise, traversée d’éclairs lyriques. Quarante-cinq moments dérobés à la vie d’hommes et de femmes, paysans recourbés sur la terre ingrate, s’acharnant à en extraire une maigre pitance.
Au milieu du quotidien de ces vies misérables et obstinées, des rires clairs et juvéniles viennent ricocher sur les murs des masures, des attentes éternelles voiler le regard d’épouses délaissées, la promesse d’un cadeau de Noël éclairer les nuits d’un enfant, des superstitions ancestrales décourager les bonnes volontés du curé…
Tout un peuple des montagne que Miguel Torga ausculte avec lucidité et bonté, un peuple qu’il chérit, admire et connaît bien pour avoir été l’un des leurs, un fils de paysans pauvres, devenu contre l’avis paternel médecin à Coimbra. Ce praticien méticuleux des corps se doublait d’un écrivain des âmes. Né Aldolfo Rocha, c’est sous le pseudonyme de Torga, du nom d’une bruyère de montagne particulièrement résistante, qu’il a signé l’ensemble de son oeuvre prolixe : un journal rédigé sa vie durant, En franchise intérieure, des nouvelles, essais, poésies, romans, pièces de théâtre et une autobiographie, La Création du monde. Et il faut l’être, résistant, pour survivre plutôt que vivre dans ces paysages arides et escarpés, dans ces villages isolés et ventés, résistant aussi face au régime fasciste et à toutes les censures et oppressions. Arpenteur entêté d’un monde malmené – il a voyagé d’un bout à l’autre de la planète –, Miguel Torga n’a cessé pourtant de revenir au pays pour s’enraciner toujours plus dans sa terre nourricière. Des paysages arides et escarpés, des villages isolés et ventés… Jean Dieuzaide/AKG-images Laurence Péan Arpenteur d’un monde malmené, Miguel Torga n’a cessé pourtant de revenir au pays pour s’enraciner toujours plus. Au milieu du quotidien de ces vies misérables et obstinées, des rires clairs et juvéniles viennent ricocher sur les murs des masures.
Laurence Péan – La Croix – 15 juin 2017
Ai, que lindeza tamanha ! Meu chão, meu monte, meu vale !
Rares sont les écrivains qui peuvent se prétendre au panthéon littéraire des portugais illustres. Luis de Camões, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen, José Saramago, António Lobo Antunes, Lídia Jorge… Miguel Torga. Pour la première fois, un éditeur français regroupe dans une même édition les quarante-cinq nouvelles qui composent les Contes de la Montagne et les Nouveaux Contes de la Montagne. Initialement publiées par la maison emblématique José Corti (qui édita entre autres, ses célèbres Poèmes Ibériques), les nouvelles de Torga ressortent dans leur intégralité grâce aux éditions Chandeigne. Un travail d’écriture éclairant, nécéssaire, né avec force, sueur et larmes. Les premiers contes sont en effet rédigés alors que Torga est malmené par le régime salazariste. Des textes à l’image de l’auteur : lapidaires, ne laissant place à aucune intransigeance. Des instantanés bruts à la concision affinée de villages du Nord du Portugal où se joue toute la magnificence des passions humaines.
Comme l’écrit si bien celui qui prit le nom d’une bruyère sauvage et indomptée comme pseudonyme dans la préface de la troisième édition des Contes de la Montagne : “Âmes en peine d’un Portugal nucléaires, les personnages brûlent dans ses pages comme les veilleuses symboliques de quelque oratoire des chemins. (…) Un tableau frustre et agreste, comme tu le sais. Mais qui est le nôtre, que nous le voulions ou non, et qui sera aussi celui des autres, quand la curiosité des autres fera le tour du monde.” Chantre national par excellence, Miguel Torga donne corps et voix à cette région toute émeraude et ocre qu’est Trás-Os-Montes, terreau isolé dans ses montagnes abruptes mais véritable microcosme d’un monde en proie à la violence de la nature et des êtres.
Lire et relire Miguel Torga, c’est renouer avec son âme portugaise, faire corps avec sa saudade, s’émerveiller face à la puissance de cette Montagne qui ne cesse de vibrer dans les veines de chaque déraciné. Écrivain de l’exil, parti au Brésil dans son adolescence, puis lors de ses démêlés avec le régime fasciste, Torga sait réveiller mieux que quiconque ce désir brûlant de puiser dans ses terres d’origine pour révéler ce qu’il y a de plus universel en chacun de nous : tout comme ses personnages qui reviennent des années plus tard mourrir dans leur village, malgré les infamies et le temps qui s’est écoulé, le lecteur est un éternel immigré voguant sur les eaux intranquilles de ce monde chaotique, à la recherche d’une escale familière où pouvoir se recueillir et se ressourcer. En somme, une redécouverte essentielle.
Ana Torres – CAPMag – mars 2017
Miguel Torga, fureur et mystère
Toute lecture digne de ce nom, disait Stevenson dans ses Essais sur l’art de la fiction, se doit d’être absorbante et voluptueuse. Nous devons dévorer le livre que nous lisons, être captivés par lui, arrachés de nous-mêmes, et sortir de là l’esprit en feu, emportés dans un tourbillon d’images animées, semblable à un brasier dans un kaléidoscope.
C’est bien en ayant l’esprit en feu que le lecteur de Miguel Torga (1907-1995) sort de ses livres, ces messages d’affliction (selon sa propre expression) envoyés par un galérien du verbe doublé d’un « reporter inquiet d’un quotidien sans frontières » et d’un « Orphée rebelle », solidaire mais autonome, persuadé que « la poésie ne subvertit que parce qu’elle transfigure, et que tel sera son avant-gardisme ». Né dans la région de Trás-os-Montes, dans le nord du Portugal, il considérait l’Iberia comme sa patrie tellurique, mais avait aussi la passion de l’ailleurs, sachant qu’il ne faut pas se défendre en s’entourant de barrières mais s’ouvrir à toutes les incursions, comme il écrivait dans son journal, dont des pages ont été traduites en français sous les titres En franchise intérieure et En chair vive.
Il disait aussi que c’est en cherchant à comprendre le Portugal qu’il a compris quelque chose de lui-même. À son pays, il a consacré un essai qui n’est assurément pas un guide pour les voyageurs pressés, plutôt une invitation à parcourir cette terre sans chercher dans ce qui nous est étranger la projection de nous-mêmes et de nos désirs, mais en s’efforçant d’expliquer « ce qui s’oppose à nous », de valoriser le différent, l’inattendu, l’antagonique. Dans Portugal, la patrie de Camões et de Pessoa s’offre au visiteur dans toute sa splendeur : Lisbonne est « la vitrine baroque et colorée de la partie aventureuse de notre sang, un quai d’embarquement pour la hâte qui court le monde », Porto est « un gros bourg ceint des murs de notre fierté paysanne », le Tage c’est « le fleuve où nous nous perdons en contemplant notre propre image », l’Algarve a des allures de « paradis terrestre », tandis que Trás-os-Montes, c’est « l’impétuosité, la convulsion ».
L’impétuosité, Miguel Torga n’en était pas dépourvu. Il ne manquait jamais une occasion de rappeler qu’il n’avait pas de vérité à prêcher, qu’il avait conçu tous ses textes avec une indéfectible témérité, qu’en écrivant il se sentait toujours traversé par un torrent d’émotions et de passions, qu’il ne possédait pas la paix, ni ne la donnait, ni ne la voulait : « Je vis dans l’intranquillité, en intranquillisant qui s’approche de moi. » Il confiait volontiers n’avoir jamais été un « auteur convaincu », mais une sorte de policier de soi-même, qui passait sa vie à surveiller son verbe afin de ne pas se dédire, qui était attentif seulement aux imperfections de ses écrits, au point de les réviser sans cesse. Malgré tout, son legs est considérable, puisque à sa mort son œuvre protéiforme comptait aussi bien seize volumes de journal qu’une vaste fresque autobiographique, La Création du monde, mais également des poésies, des recueils de nouvelles, de contes, un récit, Senhor Ventura, et un roman, Vendange.
Celui qui, de son vrai nom, s’appelait Adolfo Rocha, et exerçait le métier de médecin, s’affirmait aussi, en tant qu’écrivain, comme un contestataire, l’allié des persécutés et le maquisard de la littérature, déterminé à faire entendre la voix des victimes de toutes les dictatures politiques : « Pas plus que le saint, l’artiste n’est un opposant au pouvoir. Il est l’opposé du pouvoir, même sans atteindre à la sainteté. Plus qu’un révolutionnaire, c’est un révolté ; et plus encore qu’un révolté, un rebelle. Un champion de la liberté, tellement libre qu’il vit en lutte permanente avec ses propres démons », écrivait-il dans son journal en 1977, trois ans après la révolution des Œillets.
Dans la préface à l’édition française de son autobiographie, La Création du monde, Miguel Torga livre cet aparté, sorte de profession de foi qui définit si bien toute son œuvre, pleine de fureur et de mystère, où le merveilleux cohabite avec le démoniaque, où il a toujours lutté contre les tendances de la littérature au solipsisme, en descendant dans l’arène et en se représentant la création comme un corps-à-corps avec le présent immédiat : « Homme de mots, c’est avec des mots que j’ai témoigné de la longue histoire d’une tenace, patiente et douloureuse construction réflexive, faite avec la matière incandescente de la vie. »
La Création du monde nous apprend tout sur la jeunesse de Miguel Torga : en six livres, six jours, cette fresque revient sur sa découverte du cinéma, notamment des films de Max Linder, sa lecture de Machado de Assis pendant son exil au Brésil, où il travailla dans une plantation, ses voyages en Espagne, en Italie (sa dénonciation du franquisme et du fascisme mussolinien lui valut d’être arrêté et emprisonné), sa passion pour Henri Frédéric Amiel, le diariste genevois que Pessoa aussi aimait tant (Amiel, avoue Miguel Torga, fut l’un de ses maîtres, secrètement admiré), ses livres publiés à compte d’auteur et qu’il refusait d’envoyer préalablement à la censure, son désenchantement lucide, enfin il aboutit à cette conclusion, qui sonne comme une leçon de vie : « L’homme ne se découvre qu’en découvrant. »
Miguel Torga n’avait cessé de partir à la découverte du monde, au sens propre d’un voyage aux quatre coins de la planète, jusqu’en Chine, mais aussi au sens d’un voyage immobile, où il s’assignait la mission d’atteindre à l’universel tout en sachant, comme il le déclara lors d’une conférence au Brésil en 1954, que « l’universel, c’est le local moins les murs » : l’écrivain, né sur les hauts plateaux de Trás-os-Montes, ce « nid haut perché et agreste qui transmet l’élévation et l’âpreté » au cœur et à la chair des natifs du lieu, se proposait de s’acquitter d’une tâche de conservation et de témoignage en répandant la parole du transmontano, dans les veines duquel « court une force qu’il a reçue des rochers, une hémoglobine qui jamais ne se décolore ».
Si Senhor Ventura, publié pour la première fois en 1943 et remanié quarante ans plus tard, est un récit ancré dans l’Alentejo, terre natale d’un aventurier qui fait l’expérience de l’exil, de l’amour, de la trahison, Vendange, paru en 1945, renferme les secrets du fleuve Douro. Mais tous les livres de Miguel Torga, même les recueils de nouvelles Rua ou Lapidaires, et les Poèmes ibériques, montrent à quel point cet irréductible, prenant exemple sur Camões, qui à ses yeux incarnait le paradigme de l’intellectuel attaché à son nid « mais libre, intranquille, errant, aventurier d’en deçà et d’au-delà des mers, avide voir et de savoir, parfaite représentation de l’universalité mentale enracinée », se sentait né pour porter témoignage : « du monde entier à haute et intelligible voix, du Portugal mezza voce, et du Douro sur le ton de la confession murmurée ».
Captif des geôles salazaristes entre 1939 et 1940, Miguel Torga, qui avait vu l’un des volumes de La Création du monde saisi dans les librairies, devait, à sa libération, voir une autre de ses publications, Montanha, interdite. Il fallut attendre quinze ans avant qu’il parvînt à faire paraître une autre édition du livre sous le titre Contes de la Montagne. Elle circula sous le manteau au Portugal jusqu’en 1968, année où vit le jour, à Coimbra, une édition à compte d’auteur. Entre-temps, en 1943, Miguel Torga avait mis la dernière main à une suite, Nouveaux contes de la Montagne. En 1994, les éditions José Corti permirent de découvrir l’excellente version française de ces contes, due à Claire Cayron, et reprise aujourd’hui par les éditions Chandeigne. Dans son journal, Miguel Torga donne à lire sa préface à la traduction espagnole de ces textes. Dans cet avant-propos, une lettre au lecteur, il évoque ses personnages : ce sont, dit-il, des « héros farouches, enchaînés aux lois de leur condition, dès la naissance ils sont habitués à affronter les caprices du destin pour leur propre compte et à leurs risques et périls », même avec l’aval de leur créateur.
Ces contes, peuplés de laissés-pour-compte, d’éclopés de l’existence, d’envoûtés, de superstitieux, font le récit de vengeances, de déchéances, de cruautés, de résignations, de renoncements, de peurs ancestrales, de coups de folie ou de châtiments atroces. Ici un cœur simple se résout à affronter son destin, là un séducteur est châtré, ailleurs un lépreux, convaincu qu’il guérira en prenant un bain d’huile, constate que le bain lustral n’a eu aucun effet curatif et revend la jarre d’huile à un marchand qui à son tour la brade à tous les habitants d’un village; ailleurs encore c’est la crainte du mauvais sort qui conduit aux pires extrémités. En trois ou quatre pages, avec un art remarquable de la concision, Miguel Torga, qui disait être « une sorte d’homme de la télégraphie dans le bateau traqué par les vagues furieuses de la réalité », parvient à créer un monde qui parle à nos sens, un monde où la terreur magique se mêle à la quête du surnaturel.
Dans son texte sur Leskov intitulé « Le conteur », Walter Benjamin rappelle que l’art de conter présente un caractère très artisanal, qu’il est aussi l’art de reprendre les histoires qu’on a entendues : l’expérience transmise de bouche en bouche est la source à laquelle tous les conteurs ont puisé. Les plus grands d’entre eux sont souvent aussi ceux qui rapportent les faits de la façon la plus sèche. Si modestes que soient ces contes, ils ressemblent, dit Benjamin, à « ces graines enfermées hermétiquement pendant des millénaires dans les chambres des pyramides, et qui ont conservé jusqu’à aujourd’hui leur pouvoir germinatif ». Le meilleur lecteur de Miguel Torga est sans doute celui qui se révèle capable de recueillir ces graines tombées en apprenant aussi d’où soufflent les vents de la vie.
Linda Lê – En attendant Nadeau – Mars 2017
Son écriture concise épouse habilement le cadre et les personnages ruraux de son pays, le Portugal. Oscillant entre rudesse et humour, misanthropie et espoir en l’homme, ces scènes de la vie de campagne croquent des habitants et des paysages désarmants par la puissance d’humanité qu’ils dégagent. L’auteur se refuse à toute complaisance, dévoilant avec une drôlerie cynique, la cruauté, la bêtise, mais aussi la grandeur des êtres. Il y a quelque chose de Maupassant dans ces nouvelles parfaitement ficelées, recensées parmi les dix plus grands livres de la littérature portugaise.
L’amour des livres – Sélection Voyages 2017 – Mars 2017