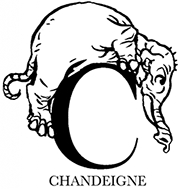Fernando Pessoa, monument mystérieux
L’auteur portugais mondialement connu s’est créé d’innombrables doubles en littérature. Ce sont ses hétéronymes.
L’auteur du Livre de l’intranquillité, Fernando Pessoa, est un monument de la littérature portugaise et de la littérature mondiale. Un monument très intrigant, à cause, en particulier, de ses nombreux hétéronymes, des doubles de lui-même qu’il s’est inventés (jusqu’à une centaine, dont quatre principaux). Pour aborder cette œuvre complexe et foisonnante, on peut humer lentement (comme on aurait fumé exquisément un cigare dans une autre vie) la nouvelle traduction, par Max de Carvalho, du Bureau de tabac, sortie aux éditions Chandeigne. Pessoa a attribué ces textes à son hétéronyme Alavaro de Campos. Le long poème qui donne son titre au recueil est un régal d’humour noir nihiliste. « Je ne suis rien/Je ne serai jamais rien/Je ne saurais vouloir être rien ». Voilà une entrée en matière radicale… « On m’a d’emblée pris pour un autre, je n’ai pas bronché […] Quand j’ai voulu enlever le masque/Il me collait au visage/Lorsque enfin je l’ai arraché, je me suis vu dans le miroir/J’avais pris un coup de vieux. » Dans Lisbon revisited, écrit en 1923 (Pessoa est mort alcoolique en 1935, à 47 ans), il a ces mots : « Vous pouvez toujours courir/Allez au diable sans moi/Ou alors laissez-moi y aller seul/Pourquoi diable faudrait-il y aller ensemble ? » Pourquoi faudrait-il lire des bluettes, alors qu’il est tellement délectable d’accompagner ce diable de Pessoa ?
Anne Kiesel – Ouest France – Mars 2021
« Fenêtres de ma chambre,
De ma chambre où loge un de ces millions qui sont au monde sans que personne le sache,
(Et si on le savait, que saurait-on ?),
Vous donnez sur le mystère d’une rue continuellement passante,
Une rue inaccessible à toute pensée … » (p. 15)
La force des quelques pages de « Tabacaria » (devenu un des plus célèbres poèmes du monde), c’est qu’un esprit s’y remet, pour tous, à sa place. Un génie se nettoie d’un coup, et complètement, de sa propre prétention à l’être, et observe alors ce qui reste de lui : si peu. C’est une sorte de test d’universalisation négative, coutumier de Pessoa : si son intelligence devait donner sa règle à toutes les autres, l’esprit humain en serait-il moins, ou davantage, songe-creux ? On connaît la réponse, ici ainsi traduite :
« Je m’éloigne de la fenêtre, je prends une chaise.
À quoi penser ?
Qui suis-je pour dire qui je serai, si j’ignore qui je suis ?
Être celui que je crois ? Mais je me prends pour tant de monde !
Et puis nous sommes si nombreux à nous prendre pour le même qu’il ne saurait y en avoir tant !
Un génie ? En ce moment même
Cent mille cerveaux au moins se rêvent en génies comme moi.
Or qui peut dire si l’Histoire en retiendra un seul ?
Ils seront le lisier des lendemains qui chantent.
Non, je ne crois pas en moi.
Les asiles sont pleins de fous complets pétris de telles certitudes !
Et moi qui ne suis sûr de rien, je serais plus sûr qu’eux ?
Non, non, pas même de moi … » (p. 19)
Et si les poètes n’ont pas toujours, ni tout à fait, perdu la partie, c’est seulement qu’ils jouent à un jeu qui n’aura pas touché au monde :
« Esclaves cardiaques des étoiles,
Nous avions conquis le monde entier sans nous lever de notre lit ;
Mais nous nous réveillons, il est impénétrable ;
Nous nous levons, et c’est un monde lointain,
Nous sortons de chez nous et déjà il s’étend aux confins de la Terre,
Au système solaire, à la Voie Lactée, à l’Éther vague » (p. 21)
On sait que Pessoa n’a multiplié les identités (les hétéronymes) que pour échapper à la perte de la sienne ; que les seuls personnages qu’il crée comme auteur sont d’autres auteurs (coexistant en lui), prévenant ainsi l’auteur qu’il est de se figer en personnage ; qu’en forgeant en lui des désespérés de diverses obédiences, en désaccord foncier sur la nature de leur néant commun – mais chacun avide de convaincre les autres de la nullité du leur ! – il ranime, depuis son esprit protéiforme, son âme morte. On devine aussi qu’à plusieurs en quelqu’un, on n’a plus devoir de sincérité (pourquoi de libres avatars seraient-ils d’accord entre eux ?), ni de fidélité (pourquoi de largement inconnus les uns des autres désireraient-ils un même être ?), ni même de progrès (quel bond réel ferait une monture attelée à tant d’autres par le cocher narquois ?). Mais cette nouvelle traduction de Max de Carvalho, étonnamment vive et proche, comme on l’entend dans ce passage :
« Mais lâchez-moi à la fin, pour l’amour du Ciel !
Vous m’auriez voulu casé, insignifiant, prévisible, imposable,
Et avec tout ça mon contraire et encore le contraire de tout ?
Si j’étais quelqu’un d’autre, je me plierais au moindre de vos désirs.
Mais vu que je suis moi, vous pouvez toujours courir !
Allez au diable sans moi,
Ou alors laissez-moi y aller seul !
Pourquoi diable faudrait-il y aller ensemble ? » (p. 45)
nous fait voir deux choses un peu cachées :
D’abord, elle fait saisir quelque chose de l’étrange familiarité avec laquelle, sans doute, l’angoisse de Pessoa devait se parler à elle-même (disséquant son propre pouvoir créateur, il fait à ses propres Muses des sortes de primesautières confidences, d’une liberté désarmante pour elles, – et pour nous !) Mais aussi, et surtout, cette sorte de véhémence bonhomme, si bien rendue par Carvalho (la colère de l’auteur se montre venir de plus loin que du lettré en lui !), vérifie que la lucidité chez Pessoa est spontanée, comme une « facilité » innée, et pas du tout fruit d’un effort, d’un travail savant. On n’est plus du tout devant une ample culture mettant son point d’honneur à dissiper une à une les illusions qui la constituent. On est devant quelqu’un qui se sait alcoolique, pervers et dépressif, et comprend que, n’étant dupe de rien, il n’a par là-même prise sur rien : l’absence de toute illusion sur ses propres tendances addictives, sado-masochistes et suicidaires ôte ainsi tout crédit intérieur aux périodiques essais d’abstinence, de désinfantilisation de la libido et de lâchers de leurres d’amour. De vertigineuses contorsions de conscience ont ici trouvé transposition de leur ton, simple et frais, d’origine.
Ainsi Pessoa se félicitant ironiquement de son propre humour :
« Je fais mieux ma valise avec des yeux qui songent à la faire
Qu’avec des mains factices (voilà, je crois, qui est bien dit) » (p. 59)
ou noyant délicieusement sa propre procrastination dans l’ajournement même du monde :
« J’allume une cigarette pour remettre à plus tard le voyage,
Pour remettre à plus tard tous les voyages,
Pour remettre à plus tard l’univers » (id.)
ou feignant de traiter toute la réalité comme une personne unique qu’il pourrait dès lors aisément congédier :
« Repasse voir demain si j’y suis, réalité !
Pour aujourd’hui c’est bon, les amis !
Ajourne-toi, présent absolu !
Si être c’est ça, autant ne pas être » (id.)
Qu’on éloigne de lui, supplie-t-il sarcastiquement, son envie de partir (symbolisée par sa valise enfin bouclée) pour qu’il ne se voie plus rester indéfiniment là, qu’il ne soit plus ce voyageur impossible, cette liberté avortée à laquelle il crève de se réduire :
« Bon sang ! Je finirai bien par la boucler, cette valise !
Et quand on l’aura emportée hors de ma vue,
Je jouirai enfin d’une existence distincte de la sienne » (p. 61)
Ici, pourtant, ce qui est grandiose (comme l’ode à la nuit, la prière pour faire accepter son intime infime nuit à l’objective et immense obscurité) le demeure, avec la quasi-tendresse (car qui nous connaît mieux, pour nous ronger aussi parfaitement ?! Quels plus proches de lui ce Néant bercerait-il ?) que la géante indistinction des choses manifeste à ce qu’elle noie – avec l’idée sinistre et décisive que l’inaccompli n’est jamais révolu ! :
« Dans la nuit terrible, substance naturelle de toutes les nuits,
Dans la nuit insomnieuse, substance naturelle de toutes mes nuits,
Dans la demi-veille d’une somnolence recrue, je me souviens.
Je me souviens de ce que j’ai fait et de ce que j’aurais pu faire de ma vie.
Je me souviens, alors l’angoisse me saisit,
Me glace comme l’effroi gagne le corps.
Ce qu’il y a d’irréparable dans mon passé – voilà le cadavre ! (…)
Aucun système métaphysique ne promet la moindre
Espérance pour ce que j’ai seulement failli faire.
Il n’est pas impossible que je puisse emporter dans un autre monde ce que j’ai rêvé,
Mais comment emporterai-je dans un autre monde ce que j’ai oublié de rêver ?
Oui, ces rêves que j’aurais pu avoir, voilà le cadavre ! » (p. 77)
Cet utile et beau petit livre traduit Pessoa comme il le révèle et a raison de le formuler : « l’élégiaque athlète de l’insondable », écrit Max de Carvalho, « la vigile perpétuelle d’une insomnie à laquelle la mort même ne semble devoir fermer l’œil », oui, cette « souveraineté d’impuissance » est ici remarquablement rendue.
Marc Wetzel – Poezibao – Mai 2019