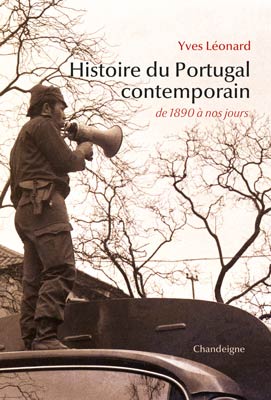- Le vent se lève
- Siné mensuel
- Le paratonnerre
- Le vent se lève
- RFI - Carrefour de l'Europe -
- Análise Social
- Lusojournal
- Revue Afrique Asie
- L'histoire
- Les clionautes
- Radio Alfa
- L'ours
- Mélanges de la Casa Velasquez
Portugal : les œillets d’avril confinés
Le Portugal a de nouveau fait l’objet de toutes les attentions ces derniers jours, d’aucuns évoquant le « mystère », voire le « miracle » portugais face à la crise du Covid-19 qui l’épargne quelque peu par rapport à ses voisins européens. Quant au Premier ministre portugais, il a tenté de secouer les institutions européennes et le « club des radins » dont il a qualifié l’attitude de « répugnante ». Éclairage d’Yves Léonard, spécialiste de l’histoire contemporaine du Portugal, sur ce pays singulier à quelques jours du 25 avril, journée commémorative de la Révolution des œillets au printemps 1974.
« Ils traversaient une place où des groupes d’aveugles s’amusaient à écouter les discours d’autres aveugles, à première vue aucun ne semblait aveugle, ceux qui parlaient tournaient la tête avec véhémence vers ceux qui écoutaient, ceux qui écoutaient tournaient la tête avec attention vers ceux qui parlaient. L’on proclamait les principes fondamentaux des grands systèmes organisés, la propriété privée, le libre-échange, le marché, la Bourse, la taxation fiscale, les intérêts, l’appropriation, la production, la distribution, la consommation, l’approvisionnement et le désapprovisionnement, la richesse et la pauvreté, la communication, la répression et la délinquance » : en 1995, l’écrivain portugais José Saramago (1922-2010), prix Nobel en 1998, publie L’aveuglement, récit d’une épidémie soudaine où, à la suite d’un homme assis au volant de sa voiture à un feu rouge, chacun perd brutalement la vue, sauf la femme d’un médecin pour guider les autres hors de ces ténèbres. Devenir aveugle pour ne plus passer sa vie sans se voir, pour réussir à voir l’essentiel et à être humain : ce message de José Saramago résonne avec force en ces temps de pandémie du Covid-19, soulignant à quel point ce qui semblait inconcevable la veille peut devenir réalité le lendemain. Mais à quel point aussi, il existe une dissonance entre l’événement imaginé dans une fiction romanesque et l’événement survenu dans la réalité.
Pour un pays comme le Portugal, présenté à satiété ces dernières années comme un « modèle », sinon un « miracle » et, encore ces derniers jours, comme une sorte d’exception européenne face à un virus qui l’épargne plus que ses voisins européens, comment mesurer cette dissonance entre la part fantasmée d’un pays mythifié et la réalité de cette crise sanitaire, économique et sociale sans précédent ? Au Portugal comme ailleurs, est-il possible de croire aujourd’hui comme avant à l’Union européenne, à la libre circulation des individus et des biens ? Classé « 7ème meilleure démocratie au monde », le Portugal peut-il être épargné par cette montée générale de l’autoritarisme et du contrôle léviathanesque des populations, alors que partout se renforce le sentiment selon lequel plus l’État-nation est puissant, mieux il s’en sort ?
Anticipation et prudence
« L’effort que nous avons fait, qui reflète le comportement exemplaire de la majorité de la population, a porté ses fruits. Mais il faut faire plus » déclarait le Premier ministre portugais António Costa début avril. Pourtant, le Portugal est bien moins affecté par le Covid-19 que nombre de pays européens, à commencer par son voisin espagnol : 599 décès (dont 86 % âgés de plus de 70 ans) et 18 091 cas confirmés de contamination pour le Portugal au 15 avril, contre près de 19 000 décès et plus de 70 000 personnes contaminées en Espagne, dont la population est près de cinq fois supérieure à celle du Portugal. « Pour faire des pas vers un retour progressif à la normale en mai, il faut s’en donner les moyens en avril » a déclaré à l’unisson le 7 avril le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa, qui s’était lui-même mis en quarantaine pendant deux semaines début mars, après avoir été en contact avec des élèves d’une école du nord du Portugal, fermée après la découverte d’un cas de coronavirus.
Plusieurs facteurs permettent d’expliquer cette situation. En laissant de côté le supposé « sens inné de la discipline » des Portugais, aux relents culturalistes sinon « saudosistas » évoqué parfois, la position géographique singulière du Portugal à l’extrême-ouest du continent – et donc éloigné du principal foyer épidémique d’origine au nord de l’Italie -, ne partageant qu’une seule frontière terrestre avec un voisin, s’est affirmée comme un atout dont les autorités ont su tirer parti rapidement, en imposant dès mi-mars des restrictions de mouvement à la frontière avec l’Espagne, alors que le Portugal ne comptait qu’une centaine de cas. De même, le relatif isolement de régions intérieures (Alentejo, aucun décès) moins densément peuplées, avec des populations vieillissantes sédentaires, a contribué aussi au ralentissement de la propagation de l’épidémie. Ensuite, l’impact d’une campagne précoce de sensibilisation à la dangerosité du Covid-19 auprès d’une population d’autant plus réceptive qu’elle connait les faiblesses et les disparités territoriales d’un Système national de santé (SNS) durement mis à mal par les années d’austérité : dès le 12 mars, aucun décès ou cas grave n’ayant alors été enregistré, l’état d’alerte est déclaré, puis l’état d’urgence le 19 mars, les écoles ayant été fermées le 16 mars et un cordon sanitaire étant établi autour de la ville d’Ovar (55 000 habitants) le 17 mars (20 décès et plus de 550 cas de contamination) ; le nord du pays se révélant le plus touché (321 décès et plus de 10 000 cas détectés).
Cette anticipation au regard de la situation épidémique du pays (2 premiers cas de contamination constatés le 2 mars – un homme de 60 ans de retour d’Italie et un homme de 33 ans de retour de Valence – annonce du premier décès le 16 mars) a permis d’éviter une première vague trop forte. Sans oublier l’absence de foyer épidémique majeur grâce, notamment, à l’élimination précoce des clubs du Benfica Lisbonne et du FC Porto de la Champion’s League de football, avant le stade des huitièmes de finale, ce qui a évité des situations dramatiques comme celle du match aller à Milan, le 19 février, entre l’Atalanta Bergame et le FC Valence, véritable « cluster » épidémique rassemblant plus de 50 000 supporters des deux clubs dans la capitale de la Lombardie, épicentre de la pandémie en Europe. Sans oublier également quelques divergences dans les chiffres des cas de contamination entre le « macro » et le « micro », entre les chiffres communiqués quotidiennement, à mi-journée, par la Direction générale de la Santé (DGS) et ceux, sensiblement plus élevés dans certaines villes, collectés par les collectivités.
Si le Portugal fait partie des pays européens les moins touchés par l’épidémie, il craint l’arrivée d’une deuxième vague, au regard notamment du faible pourcentage de la population immunisée. D’où une vigilance redoublée lors du week-end de Pâques, propice aux déplacements et rassemblements familiaux. D’où l’annonce que les écoles maternelles et primaires ne rouvriront pas d’ici septembre. D’où la prolongation de l’état d’urgence, au moins jusqu’à début mai. D’où aussi l’annonce, chargée d’affects, de l’annulation de la traditionnelle manifestation de commémoration de la Révolution des œillets sur l’Avenida da Liberdade à Lisbonne, accompagnée d’un appel pour que les Portugais ce jour-là, vers 15h, aillent à leur fenêtre et chantent « Grândola, Vila Morena », la chanson emblématique du Mouvement des forces armées (MFA) et du 25 avril 1974.
Avec un nombre de cas de Covid-19 en faible progression, une population vieillissante, un système national de santé (SNS) affaibli au sortir de l’austérité imposée par la Troïka (9,1 % du PIB, contre près de 10 % en 2009 et 12,5 % en Allemagne, soit un tiers de moins que la moyenne de l’UE) et une économie encore convalescente, dont la croissance est très fortement dépendante des exportations et du tourisme (15 % du PIB), le Portugal est fortement fragilisé par cette crise sanitaire. D’où la prudence des autorités portugaises quant aux conséquences économiques et sociales de cette pandémie.
Résilience, consensus et solidarité
Lucidité et humilité au regard des capacités hospitalières d’accueil ont prévalu depuis le début de la crise. Selon le classement de Health Power House, le Système national de santé portugais (SNS), gratuit, général et universel, fondé en 1979, est considéré comme le treizième meilleur en Europe. À l’occasion de son quarantième anniversaire en septembre 2019, le SNS a fait l’objet d’un rapport soulignant ses bienfaits depuis sa création (trois fois plus de médecins qu’en 1979, fortes augmentation de la durée de vie et diminution de la mortalité infantile), mais aussi la baisse constante du nombre de lits (339 000 en 2017 contre 527 000 en 1980)[3], avec un système où les hôpitaux sont gérés comme de grandes entreprises et les hôpitaux privés de plus en plus nombreux (107 contre 93 en 1999). Si 2 milliards d’euros ont été injectés depuis 2016 et 800 millions d’euros inscrits au budget 2020, ces montants n’ont pas compensé les coupes sombres réalisées sous couvert d’austérité qui ont vu les dépenses de santé par habitant chuter de 1021 € en 2010 à 894 € en 2012 et 2013, avant d’atteindre 989 € en 2017 et de retrouver seulement en 2019 le niveau de 2010. Face à une crise sanitaire d’une telle ampleur, autant dire que la prudence s’impose dans les faits aux Portugais, l’objectif étant surtout de prévenir, avant même de guérir. Ainsi, 500 respirateurs/ventilateurs ont été commandés fin mars, venant s’ajouter aux quelques 1200 disponibles. Un hôpital de campagne de 200 lits a été installé à Lisbonne, près de Campo Pequeno. Quant aux tests de diagnostic, plus de 110 000 ont été réalisés depuis le 1er mars, atteignant le 10 avril une capacité quotidienne de 11 000 tests, niveau comparable à des pays comme le Danemark ou la Suède.
Dans un tel contexte, plus de 70 % des Portugais déclarent avoir peur de se rendre dans les services de santé, nombre d’entre eux retardant ou annulant examens, interventions et vaccinations, faisant craindre de nouveaux drames sanitaires, alors que « tristesse et anxiété » prévalent chez près de 15 % de la population. Au-delà des difficultés économiques, du chômage partiel (avec 2/3 du salaire) ou des « congés forcés » qui conditionnent fortement pour tous la capacité à faire face aux restrictions, ces contraintes sont d’autant plus fortement ressenties par les plus jeunes qu’elles s’accompagnent d’un sentiment « d’isolement » et de « manque de liberté », alors que les trentenaires et jeunes quadra chargés de famille, avec des enfants en bas âge, soulignent leurs difficultés à concilier travail, vie familiale et éducation des enfants, générant stress, anxiété et état dépressif. Les incertitudes quant à la durée des restrictions (15 % des Portugais déclarent ne pas être sortis ces 15 derniers jours) ainsi que la crainte d’un scénario catastrophe « jusqu’à la fin de l’année » sont plus fortes chez les personnes âgées et les plus vulnérables économiquement dans un pays où le salaire minimum s’élève à 635 € nets mensuels. 12 % des Portugais – soit un million d’adultes – craignent de ne pouvoir faire face à leurs dépenses courantes dans un mois.
Face aux difficultés éprouvées au quotidien par la population, les autorités ont cherché à mettre en œuvre des mesures appelant à la solidarité, solidarité et esprit d’entraide dont la population a donné d’innombrables preuves depuis le début de cette crise sanitaire, notamment vis-à-vis des personnes âgées. Fin mars, le Parlement a ainsi approuvé la suspension des loyers pour les ménages vulnérables et les petites entreprises à court de trésorerie pendant l’épidémie, mais plusieurs associations ont averti que ces mesures risquaient seulement de retarder une crise du logement sous-jacente depuis longtemps, la mairie de Lisbonne ayant de son côté annoncé un gel des loyers pour l’habitat social (parc de 70 000 logements). Le gouvernement a également décidé de régulariser temporairement, à partir du 30 mars, les immigrés en attente de titre de séjour et les demandeurs d’asile. « En temps de crise, c’est un devoir pour une société solidaire que d’assurer l’accès des migrants à la santé, à la stabilité de l’emploi et au logement » a ainsi expliqué le ministre de l’Intérieur, Eduardo Cabrita. Si elle fait figure d’exception à l’échelle européenne, cet exemple de solidarité fait sens d’un point de vue sanitaire, permettant aux migrants et demandeurs d’asile d’accéder à un système national de santé gratuit, de se soigner, de se protéger, et ainsi de protéger les autres aussi. Mais, au-delà de ces considérations humanitaires, il y va aussi de l’intérêt d’un État dont la population vieillit, les taux de natalité et de fécondité s’effondrent, et où certains secteurs d’activité (agriculture, BTP) manquent de main-d’œuvre à bas coût.
Dans ce contexte, le gouvernement a, jusqu’à présent, bénéficié d’un large soutien de l’opinion et consensus politique, à l’image de l’adoption de l’état d’urgence – une première pourtant depuis le retour de la démocratie en 1974 -, approuvée par plus de 90 % de la population. Le projet de décret présidentiel déclarant l’état d’urgence a ainsi été voté le 18 mars par l’ensemble des parlementaires à l’Assemblée de la République (chambre unique, 230 membres), seuls la coalition Parti communiste/Les Verts, le député d’Initiative libérale et une députée non inscrite s’abstenant. Toutes les autres formations, dont le Bloc de Gauche, les écologistes de PAN et l’opposition PSD (centre-droite), ainsi que le seul député de Chega (extrême-droite) ont voté ce texte restreignant temporairement les libertés, présenté comme un « mal nécessaire » par la présidente du groupe majoritaire PS, celle-ci ayant assuré que le gouvernement d’António Costa veillerait à « faire respecter le nécessaire équilibre entre sécurité et liberté. »
Ce large consensus associant gouvernement, partis politiques, corps intermédiaires et société civile confère au gouvernement une liberté d’action indéniable. Salué un peu partout à l’étranger, notamment par le vice-président du gouvernement espagnol Pablo Iglesias, ce consensus politique va se révéler précieux à l’épreuve du temps, alors que l’inquiétude et les interrogations vont se renforcer dans les prochaines semaines, notamment quant à la durée de cette quarantaine, déjà pointée du doigt par les milieux d’affaires. Ainsi, le lundi de Pâques, 159 personnalités (professionnels de la santé, du tourisme, de la culture, chefs d’entreprise) considérant « qu’il n’est pas possible de suspendre l’activité économique jusqu’à la suppression de tout risque de contagion », ont adressé une lettre au président de la République et au premier ministre pour demander de nouvelles mesures (généralisation du port des masques, tracking, dépistage massif) en vue d’une réouverture contrôlée de l’économie, inspirée de la Corée du Sud. Mardi 14 avril, le Premier ministre António Costa a indiqué sur son compte Twitter avoir le même jour « échangé avec un ensemble d’économistes et d’universitaires sur les perspectives pour l’économie portugaise et la relance de l’activité économique », précisant que « ce débat franc et ouvert a apporté une contribution importante à la mise en place d’une voie de relance solide et fondée sur la confiance ». Cette confiance est centrale dans la réflexion du gouvernement pour envisager une réouverture progressive de l’économie, insistant sur l’idée que c’est seulement « si les gens ont suffisamment confiance qu’ils pourront retourner au travail et consommer », grâce notamment au port généralisé de masques – jusqu’ici réservé aux seuls professionnels de la santé, de la sécurité et de la distribution -, sans donner de date ni de modalités plus précises pour le moment.
Foin de l’austérité ?
La crise du Covid-19 se présente comme un test de résistance d’autant plus redoutable pour l’économie portugaise que celle-ci était seulement convalescente, après les années d’austérité (2011-2015) aux séquelles encore bien présentes et dans tous les esprits. Autant dire que le spectre de l’austérité plane lourdement sur l’après, sur cette sortie progressive du confinement que les plus optimistes espèrent comme une reprise économique en forme de U et non plus de V, comme d’aucuns l’imaginaient encore courant mars. Les prévisions du FMI communiquées le 14 avril prévoient une chute de 8 % du PIB pour 2020 (contre une contraction de 4,1 % en 2012) et 380 000 chômeurs supplémentaires au Portugal. Ce même 14 avril, António Costa, après avoir parlé « d’une crise sanitaire qui se transforme en une crise économique que nous ne pouvons pas laisser empirer », a confirmé réfléchir à la nationalisation d’entreprises, notamment la compagnie aérienne nationale TAP, privatisée début 2015 et dont l’État est encore actionnaire à 50 % : « Nous ne pouvons exclure la nécessité de nationaliser la TAP ou d’autres entreprises qui sont absolument essentielles pour notre pays. Nous ne pouvons courir le risque de les perdre ».
Dans une déclaration à l’agence Lusa le 11 avril, le premier ministre a déjà appelé au sens de « l’effort collectif » et à « l’esprit de responsabilité » ses anciens partenaires à gauche de la geringonça, cet attelage entre le PS, le PC et le Bloc de Gauche en vigueur de novembre 2015 aux élections législatives d’octobre 2019, avertissant au passage qu’il serait « d’ailleurs très déçu si nous devions arriver à la conclusion que nous ne pouvons compter sur le PCP et le Bloc de Gauche qu’en période de vaches grasses, lorsque l’économie est en croissance. » À la question sous-jacente si son gouvernement serait tenté d’appliquer dans le futur « la même recette que celle utilisée il y a dix ans pour affronter la crise », António Costa a affirmé qu’il n’appliquerait pas la même recette, « non seulement parce que je n’y ai pas cru à l’époque, mais surtout parce que la maladie est clairement distincte de la précédente. Il n’y plus actuellement de problème avec les comptes de l’État qui, heureusement, a pu assainir ses finances publiques ». Quant au scénario d’un retour à un gouvernement de « Bloc central » (comme en 1983-1985, avec Mário Soares Premier ministre), entre le PS (centre-gauche) et le PSD (centre-droite), António Costa l’a écarté, en relevant « qu’il y a une coïncidence remarquable entre les dirigeants du PSD et du PS selon laquelle ce n’est pas une bonne solution pour le système politique, car elle affaiblit les pôles naturels d’alternatives, alors que la démocratie exige des alternatives et a besoin d’alternatives ».
Alors, foin du « Bloc central », sorte de version portugaise de ce « Bloc bourgeois » analysé en France et en Italie par Bruno Amable et Stefano Palombarini ? Obsolète cette alliance autour de l’intégration européenne, des réformes néolibérales et du dépassement du clivage droite/gauche ? La leader du Bloc de Gauche (Bloco de Esquerda, BE), Catarina Martins, a déjà prévenu le premier ministre que si son parti était bien disponible pour aider à combattre la crise, ce serait à la manière du BE, sans austérité ni coupes sombres dans l’investissement public, rappelant « ne pas avoir accepté l’austérité en 2011 et ne l’accepter pas plus en 2021. » Cette crise sanitaire pose de nouveau avec acuité la question de l’équilibre instable, de cette culture du compromis, qui avait permis à la geringonça de fonctionner pendant quatre ans, équilibre entre « respect des engagements européens du Portugal » et « volonté de tourner la page de l’austérité. » Mais la geringonça a volé en éclats suite aux législatives d’octobre 2019 et la large majorité obtenue par le PS. Et, côté européen, si António Costa a cherché, avec son ministre des Finances – et président de l’Eurogroupe -, Mário Centeno, a desserrer l’étau financier, c’est sans grand succès qu’il a tenté de lever les réserves du « club des radins » néerlandais et allemands, désignant cette crise comme « un moment décisif » pour l’Europe, non sans avoir stigmatisé à plusieurs reprises l’attitude des autorités néerlandaises, qualifiée de « répugnante » : « Nous devons savoir si nous pouvons continuer à 27 dans l’Union européenne, à 19 – dans l’eurozone -, ou s’il y a quelqu’un qui veut être laissé de côté. Naturellement, je parle des Pays-Bas ».
À l’heure où les dogmes néolibéraux (« austérité expansionniste », « croissance potentielle ») qui sous-tendaient l’économie mainstream sont invalidés par les faits, cette déclaration du premier ministre portugais a fait l’effet « d’un coup de pistolet dans un concert », pour paraphraser Stendhal évoquant la politique dans un roman. Il n’est pas inutile de rappeler ici que, depuis son adhésion à l’Europe communautaire en 1986, le Portugal a été de tous les modèles d’intégration. Pour ce pays géographiquement et économiquement « périphérique », la raison, plus encore que le cœur, a conduit les différents exécutifs portugais depuis près de 35 ans à considérer que ne pas répondre aux appels de l’Europe aurait été une erreur historique. Après avoir pris le train de l’Europe en marche, rester dans le wagon de queue aurait signifié une sorte de suicide collectif aux yeux des responsables politiques portugais au pouvoir (alternance centre-droite/centre-gauche), au point de vouloir incarner ce « bon élève de l’Europe », reconnu comme tel au début des années 1990 par le président de la Commission européenne, Jacques Delors. À l’heure où celui-ci évoque le risque d’une implosion de l’Europe, à l’heure où l’intégration européenne est fragilisée de toutes parts, les déclarations du premier ministre portugais, pour stimulantes et détonantes qu’elles soient en termes d’inflexion vers une Europe plus solidaire et sociale, semblent relever plus d’un exercice rhétorique salutaire que de la realpolitik : au jeu des intérêts « bien compris », des « coûts et avantages », le maître reste l’Allemagne, figure tutélaire de l’arbre généalogique d’une « famille européenne », proche de devenir cette famille en déclin de Lübeck au cœur du XIXeme siècle, Les Buddenbrook. Mais, comme le rappelait un des personnages du roman d’Eça de Queiroz (1845-1900) Les Maia, « pour pouvoir parler haut en Europe comme ministre des Affaires étrangères, il faut avoir derrière soi une armée de deux cent mille hommes et une escadre munie de torpilles. Malheureusement, nous sommes faibles… Et moi, pour jouer les rôles subalternes, pour qu’un Bismarck ou un Gladstone vienne me dire : « Il en sera ainsi », je ne marche pas » !
À la fin des fins, le constat historique de Gary Lineker, sorte de loi d’airain de l’Union européenne, pourrait bien se vérifier une nouvelle fois. Et de répéter alors en boucle « it’s the Covid, stupid. » À moins que le jour soit venu d’identifier clairement cette forme d’union économique comme la source des difficultés et de se mobiliser pour en changer complètement le logiciel et rétablir la souveraineté du politique. À moins de s’imprégner des senteurs de ces œillets d’avril et de Lisbonne, qui, en avril 1974, « donnait de l’espoir à tous les déçus de Varsovie et de Prague, même à ceux qui étaient si jeunes qu’ils n’avaient pas encore eu l’occasion de savoir ce qu’était une illusion ». À moins, pour mieux sortir du confinement, de faire sien ce pacte des « Capitaines d’avril » : « Nous avons juré. Nous avons juré que dorénavant les mots je, tu, il, nous, vous, allaient disparaître et qu’on n’utiliserait plus que la troisième personne, la personne collective, englobant tout un chacun, ils, eux. J’en ai été le témoin, ça a été enregistré. Aucun de nous ne souhaitait qu’on se réfère à ses actes individuels ou qu’on en garde le souvenir, ce souvenir devait être à tout jamais un et indivisible, le souvenir d’un groupe de cinq mille, et tous diraient ils, eux. »
Yves Léonard – Le vent se lève – Avril 2020
Le saviez-vous ? Le gouvernement portugais est de gauche et a un mot d’ordre : «Non à l’austérité.» Yves Léonard*, enseignant à Sciences-Po, analyse cette expérience originale et trop méconnue.
Depuis 2015, une coalition de gauche est au pouvoir au Portugal. Et elle refuse de pratiquer une politique d’austérité. Donc, ça doit être une catastrophe puisqu’elle ne respecte pas les dogmes européens.
Eh bien, n’en déplaise à certains, la réponse est non ! António Costa, le Premier ministre socialiste, soutenu par le Bloc de gauche et le Parti communiste, a choisi de relancer la consommation. D’en finir avec l’austérité. Il a augmenté le salaire minimum, les retraites, les allocations familiales et il a baissé les impôts pour les salaires les plus modestes… Et ça marche! La croissance est repartie, le déficit public a été ramené à 1,4%, le chômage est passé sous la barre des 7%, contre 17% en 2013 ! Et en respectant le cadre européen. Cela a redonné de la confiance. Tout n’est pas rose, mais il y a une amélioration sensible.
Pourtant, quand ce gouvernement de gauche s’est formé, personne n’y croyait… On lui avait même donné un drôle de surnom, la Geringonça, qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est un terme très difficile à traduire. En gros il signifie : une espèce de machin, un bidule. Le terme a été utilisé de manière très négative par la droite et le centre droit qui venaient de se faire éjecter du pouvoir en disant : ce truc, ce machin bringuebalant, fait de bric et de broc, ne marchera jamais. Près de trois ans après, ça tient toujours debout. Alors maintenant les gens utilisent cette expression pour désigner un système très original qui fait la singularité du Portugal aujourd’hui.
Qui compose cette alliance?
Aux élections législatives en octobre 2015, la coalition de centre droit arrive en tête mais sans majorité absolue. Elle était déjà au pouvoir et avait imposé l’austérité. Le Parti socialiste n’obtient pas lui non plus la majorité absolue. À la gauche du PS, le Bloc de gauche et le PC ont comme mot d’ordre de sortir de l’austérité. La droite forme un gouvernement qui va tenir dix jours avant d’être mis en minorité par les forces de gauche. Pourtant, pendant la campagne, il n’y avait pas de projet de coalition. C’est face au résultat lui-même – le PS avait fait plus de 32% des voix– que les trois composantes de gauche se disent qu’il y a une carte à jouer et s’allient.
Ce n’était absolument pas prévu pendant la campagne ? Ils n’en avaient pas discuté avant ensemble?
Non. Les échanges commencent après les élections. Le programme s’ébauche au jour le jour pour aboutir à un gouvernement socialiste avec le soutien sans participation des autres forces de gauche. Au départ, c’est une alliance de circonstance dirigée contre le gouvernement précédent et l’austérité. Vous insistez sur le rôle du Bloc de gauche.
Que représente-t-il ?
C’est un mouvement assez singulier, ni Podemos ni La France insoumise, même s’il y a quelques analogies. Depuis la révolution des oeillets, en 1974, il y avait une véritable floraison de groupes maoïstes, trotskistes, etc. qui n’ont jamais réussi à s’entendre, et rivalisaient avec des scores autour de 1 % selon les formations. À la fin des années 90, plusieurs groupes se sont alliés pour peser aux élections, qui sont à la proportionnelle. En 2015, le Bloc de gauche mène une campagne extrêmement dynamique à l’image de sa jeune responsable, Catarina Martins, qui a une trentaine d’années, sur le thème d’en finir avec le célèbre slogan de madame Thatcher «il n’y a pas d’alternative » (Tina). Pour la première fois, ils obtiennent plus de 10 % aux élections législatives et le Bloc de gauche va tendre la main au Parti socialiste : le moment est alors venu d’échanger. Le Parti communiste, qui représente 8% et qui n’a plus participé à un gouvernement depuis l’été 1975, suit. Ça va donner la Gerigonça, l’alliance de circonstance.
Dans votre livre, vous vous interrogez : pourquoi l’Europe se focaliset- elle sur le modèle allemand et pas sur le modèle portugais ? Le silence sur ce qui se passe au Portugal est étonnant…
Le Portugal n’a peut-être pas encore acquis toute sa légitimité en Europe. Il y a eu une méconnaissance de ce pays. C’est bien d’en parler mais pas pour en faire un modèle idyllique, un indépassable horizon. Car il y a encore plein de préjugés sur le Portugal. Aux yeux de l’Europe du Nord, c’est le «Club Med». Personne ne prend «ce pays de concierges», de maçons, de l’émigration endémique vraiment au sérieux. Les élites ne voient toujours pas qu’il a beaucoup changé. Certes, le Portugal a gagné en légitimité et en crédibilité ces dernières années. Mais il ne faudrait pas, non plus, passer d’une vision totalement archaïque, péjorative, avec des stéréotypes à n’en plus finir, à une vision chez certains peut-être un peu trop paradisiaque. Pour la gauche portugaise, tout l’enjeu est de mettre en place une alternative. Ce n’est peut-être pas reproductible à l’identique, il y a des dysfonctionnements. D’ailleurs, le Bloc de gauche a une vision encore critique, notamment vis-à-vis de l’impérieuse nécessité d’observer les règles européennes que le gouvernement d’António Costa veut respecter, avec son ministre des Finances, Mário Centeno, également président de l’Eurogroupe. Ou encore sur la législation du travail, sur la libéralisation et sur la dérégulation instaurées dans les années 2012-2013 et sur lesquelles l’actuel pouvoir n’est pas revenu. Dans Alternatives économiques, un article récemment paru nuance le modèle portugais en évoquant la baisse de la population active, les jeunes qui continuent de partir, les salaires qui peinent à se redresser. C’est vrai que plusieurs indicateurs montrent que ce n’est pas l’eldorado. Sans parler de l’immobilier qui flambe, sur fond de spéculation et de boom du tourisme. Mais, par rapport à la situation qui prévalait il y a encore trois ans, à la fois aux plans économique et politique, quelque chose de singulier a émergé. Vous avez au Portugal des formations politiques à gauche qui se parlent, s’opposent, s’invectivent ici et là, mais qui construisent quelque chose ensemble, créent en commun pour sortir de manière volontariste d’une situation qui allait perdurer. Ça mérite d’être salué.
La gauche portugaise ne semble malheureusement pas inspirer la gauche française.
La France insoumise s’est rapprochée du Bloc de gauche pour les élections européennes de 2019. Lors de la campagne présidentielle de 2017, Benoît Hamon est allé à Lisbonne juste après les primaires en disant : «Voilà un modèle qui pourrait fonctionner, une source d’inspiration.» Donc, il y a quand même du nouveau: pour la première fois depuis la révolution des oeillets, certains vont au Portugal pour observer son expérimentation politique.
À un an des élections législatives, ce gouvernement reste-t-il populaire?
Oui, les sondages donnent le Parti socialiste autour de 40 %, le Bloc de gauche et le PC autour de 8 % chacun.
Vous analysez beaucoup la situation politique en fonction de la révolution des oeillets, qui a eu lieu le 25avril 1974. Pourquoi?
Il faut comprendre qu’en une seule journée, la dictature et tout son personnel politique sont renversés par un mouvement pacifique mené par des militaires démocrates, soutenus par la population. Il y a ensuite un processus révolutionnaire pendant dix-huit mois, et tous les piliers des années de dictature sont écartés. Pas comme en Espagne où le pays sort de la dictature parce que le dictateur est mort de sa belle mort. Au Portugal, la situation est différente. Au matin du 25avril, vous avez un régime dictatorial, Caetano, successeur de Salazar, qui est encore en place. Rétrospectivement, certains vous diront: «Sa chute était inéluctable, ça allait se produire.» Non ! C’est la détermination de ce mouvement des capitaines qui provoque cet événement inattendu.
D’où cette fierté démocratique ?
Elle reste très présente. Les gens qui ont défilé dans la rue en 2012, en 2013, en 2014, contre l’austérité et la troïka, chantaient Grândola Vila Morena, le chant de la révolution des oeillets. Une manière de dire : si on a réussi à faire tomber la dictature en 74, avant la Grèce, avant l’Espagne, avant beaucoup d’autres, et de manière singulière, alors nous sommes capables de résister différemment aux politiques d’austérité, de nous opposer et de proposer quelque chose de particulier. Cette part de fierté a une résonance historique forte.
Et, chose rare en Europe, pas de vague populiste ou d’extrême droite !
Au Portugal, le nationalisme, très longtemps, a été incarné par Salazar. La clé de voûte du régime salazariste – dictature, libertés publiques brimées, propagande, censure – était une vision très nationaliste et très passéiste d’un Portugal imaginaire, replié sur son empire colonial, «l’outremer » magnifié. D’une certaine manière, cette histoire invalide tout discours ultranationaliste. Il y a aussi, sur le temps long, la notion du rapport aux autres. L’émigration, la migrance, est au coeur de l’histoire de ce pays, pour des raisons économiques et sociales, et pèse et joue encore un rôle assez sensible. Là encore, il ne faut pas complètement idéaliser, car le Portugal n’est pas un îlot isolé qui serait complètement immunisé contre tout ce qui pourrait ressembler à de la xénophobie, à du racisme. Il y a quelques marges à la droite de la droite, certains au centre droit qui conservent cette vieille tonalité salazariste mais, pour l’essentiel, elles pèsent peu. Je ne peux pas garantir qu’à l’horizon des trente prochaines années, il en ira de même.
Mais le souvenir de Mussolini n’empêche pas la Ligue de gagner les élections en Italie !
Oui, mais le cas portugais est différent. Vous avez d’une part cette rupture du 25avril, d’autre part la construction au fil des années d’un État social qui n’existait pas sous la dictature, et qui a épaulé, appuyé et conforté l’émergence d’une classe moyenne. L’essentiel de la population s’est reconnue, s’est retrouvée dans le système politique qui a fonctionné avec quelques succès, les deux principaux partis de gouvernement (PS et PSD, au centre droit) se révélant particulièrement résilients. L’adhésion à l’Europe aussi a donné, depuis les années 80, un coup d’accélérateur. Notamment pour se procurer des fonds dont manquait le pays.
L’Italie aussi a profité de l’Europe !
Le système italien a dysfonctionné bien avant les autres, avec un certain nombre de scandales. L’un des ferments de la crise italienne aujourd’hui, c’est d’une part ce nationalisme exacerbé entretenu par un certain nombre de politiques, Berlusconi en tête. Et la crise des migrants aujourd’hui vis-à-vis de laquelle les Italiens, à tort ou à raison, se sont sentis en première ligne et isolés.
Des mauvaises langues pourraient dire que finalement la possibilité de relance du Portugal aujourd’hui a été permise grâce à la cure d’austérité imposée par la troïka de 2011 à 2014 !
Les responsables de la droite ne s’en privent pas, en effet ! S’ils étaient restés au pouvoir, ils auraient certainement continué le serrage de vis, les restrictions budgétaires, etc. Alors que là, il y a une inflexion quand même assez sensible vers une relance de la consommation par le pouvoir d’achat, ce qui n’est pas dans le credo et les standards habituels.
En dehors de la situation politique, le Portugal innove aussi sur les énergies renouvelables, qui représentent déjà 50 % de la consommation ?
Le pays a pris relativement tôt le virage de l’énergie éolienne, solaire, et hydraulique. Le Portugal incarne une forme de modernité qui était l’apanage de quelques pays d’Europe du Nord. Mais là encore, on ne le raconte pas beaucoup… L’autosuffisance avec des énergies renouvelables est prévue à l’horizon 2030-2035.
Vous êtes un spécialiste de l’histoire de l’Europe, d’après vous qu’est-ce qui est responsable du délitement de l’idée européenne ?
Plein de choses. L’engagement européen s’est construit sur une idée-force: la paix. Pour les jeunes générations, la paix en Europe est un acquis qui semble aller de soi. Voire… Ensuite, un phénomène d’usure. Plus un discrédit lié à l’évolution même de la construction européenne depuis ces vingt-cinq dernières années. L’ultralibéralisme et la financiarisation ont tout supplanté. Par rapport au modèle européen d’origine, ce n’est pas une évolution, c’est une dénaturation. Ajoutez à cela la crise de 2008-2010 qui s’est traduite par de l’austérité renforcée, avec des mesures qui soignent le patient mais le tuent en même temps… Enfin, l’élargissement de l’Europe s’est construit sans réflexion approfondie, sans repenser le modèle. Tous ces éléments mis bout à bout ne font pas beaucoup de bien à la cause européenne.
Christian Duplan – Siné Mensuel – Octobre 2018
Salazar, le « moine-dictateur » du Portugal
Tout le long du XXème siècle, le monde a connu une multitude de dictateurs avec des profils similaires : harangueurs de foules, orateurs d’un certain talent, hommes à poigne avec le soutien de l’armée ou de milices fidèles,…
L’Espagne sous Franco en est un bon exemple. Et pourtant, son voisin ibérique, le Portugal, semble faire bande à part. Salazar a réussi à accéder au pouvoir de façon très technocratique, comme ministre des Finances, nommé par une dictature militaire qui entendait « nettoyer les écuries d’Augias ».
Perçu comme modeste et profondément pieux, o professor fut bien souvent autoritaire et impitoyable envers ses adversaires. Et tout au long de son règne de près de quarante ans, malgré les conflits mondiaux ou encore les guerres coloniales de « l’empire », Salazar a réussi à faire durer son Estado Novo sans pour autant susciter de nostalgie particulière dans le Portugal démocratique depuis la Révolution des œillets le 25 avril 1974.
Docteur en histoire et enseignant à Sciences Po, spécialiste de l’histoire contemporaine du Portugal, Yves Léonard a échangé avec nous sur cette période sombre du Portugal.
En quoi le Salazarisme diffère des autres régimes conservateurs et fascistes ?
Question compliquée. Les principaux facteurs de différenciation tiennent à la fois à la singularité de la nature du régime et à la nature même du personnage, celui qui incarne le régime, António de Oliveira Salazar (1889-1970). Il s’agit d’un personnage atypique par son parcours personnel. C’est un universitaire, professeur d’économie politique à l’université de Coimbra, qui devient chef du gouvernement et dictateur, parcours peu courant dans l’Europe de l’entre-deux-guerres. Ce n’est pas un militaire et il n’a jamais porté l’uniforme.
Salazar n’est pas non plus un grand orateur en public ou un leader charismatique. Pourtant c’est un personnage à la fois habile, retors, implacable qui va conquérir le pouvoir, sans « marche sur Rome » ni élection, de façon technocratique comme « magicien des Finances » et en tissant sa toile petit à petit, avec pour seul soutien, au départ, une petite formation politique, le Centre catholique.
Sur le régime lui-même et son ADN : Il s’agit d’un nationalisme non-expansionniste, non belliqueux. Le but n’est pas de s’agrandir ou de conquérir mais de préserver les colonies (Goa en Inde, vastes territoires en Afrique, notamment Angola et Mozambique). C’est un « nationalisme d’empire » avec une forte instrumentalisation de l’histoire. Le régime la réécrit d’une façon fantasmagorique, comme le montre l’Exposition du monde portugais à Lisbonne au second semestre 1940, pour commémorer « les centenaires » (1140, « fondation » du royaume du Portugal ; 1640, restauration de l’indépendance face à l’Espagne). L’empire c’est la grandeur du pays, « la splendeur du Portugal ». Comme le souligne une affiche de la propagande des années 1930, « le Portugal n’est pas un petit pays. »
La matrice est ultra conservatrice et catholique, très répressive avec une justice et une police politique consacrant l’arbitraire et l’absence de libertés publiques. Salazar ne se reconnaît pas non plus dans ce que Philippe Burrin nomme « le champ magnétique du fascisme ». Il essaye même de s’en démarquer à sa manière. Salazar ne se reconnaît pas dans les figures du Duce, du Führer ou du Caudillo.
Ce que souhaitait Salazar c’était de s’appuyer sur l’Eglise et l’armée, sans être phagocytée par ces dernières. Tout son « art », c’était de négocier et de concéder suffisamment d’intérêts à celles-ci pour qu’il ne soit pas en porte-à-faux et qu’il n’y ait pas d’Etats dans l’Etat. Lors des longues négociations du Concordat de 1940, Salazar est dans l’idée de « rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. »
En quoi le Vatican fut-il admiratif du système de l’Estado Novo ?
Le code génétique du salazarisme est très fortement lié à la religion, dans un pays de tradition catholique. Etudiant, il est membre du Centre académique de démocratie chrétienne à l’université de Coimbra. Salazar dira plus tard que ce qui l’intéressait ce n’était pas le terme démocratie mais le terme chrétien.
A ses côtés, tout au long de la dictature, il y a le cardinal-patriarche de Lisbonne, Manuel Gonçalves Cerejeira. C’est l’un des rares amis personnels de Salazar. Ils ont partagé la même gchambre pendant leurs études à Coimbra et qui vont très liés tout au long de leur vie. Cerejeira est clairement un homme d’influence et un ami.
D’autre part, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50, c’est le contexte de la Guerre froide qui va grandement servir le régime et lui permettre de survivre. Comme le franquisme, le régime salazariste a survécu à la guerre mais de manière différente, avec le soutien des grandes puissances occidentales (Royaume Uni, traditionnel allié diplomatique depuis la fin du XIVe siècle ; Etats-Unis, avec une base militaire aux Açores) et la bénédiction du Saint-Siège.
Le Pape Pie XII ne faisait pas mystère de son admiration pour Salazar. Le cœur de tout cela c’est l’anti-communisme, autour du culte marial de Fátima. Pour le salazarisme, c’est un salut providentiel. Géo-stratégiquement et politiquement avec l’Alliance atlantique, dont le Portugal est membre fondateur en 1949, il y a un second souffle de la dictature.
Le régime de Salazar est un régime long dans le temps (1928-1968/1974), avec des inflexions sensibles. Il y a plus une altération des liens avec les milieux catholiques à partir de la fin des années 50, notamment dans le contexte des guerres coloniales quand certains catholiques considèrent que c’est un combat anachronique. Lorsque le Pape Paul VI se rendit au Portugal en mai 1967 pour célébrer le cinquantenaire des apparitions de Fátima, Salazar ne souhaitait pas sa venue compte tenu du discours critique de ce pape.
Une grande partie de la hiérarchie catholique a pourtant durablement soutenu Salazar. Comme sous l’Ancien régime, les notables locaux (les « caciques », nobles ou grands bourgeois) ont été favorisés et ont par conséquent soutenu le système. Le parti unique, l’Union nationale, n’avait pas pour but de mobiliser les masses, mais deréguler le système au niveau local, en orchestrant une forme d’apathie et de soumission où rien ne devait perturber « l’ordre immuable des choses ».
Sait-on pourquoi Salazar, ce « moine-dictateur », souhaita rester au pouvoir pendant plus de 40 ans cumulant même les postes de ministres ?
Cela renvoie à sa culture politique, à l’image qu’il souhaitait donner, à sa modestie feinte. C’était aussi pour dire, d’une certaine manière, que Salazar était là guidé par la providence et qu’il faisait don de sa modeste personne à la nation portugaise.
C’est un homme farouchement nationaliste, convaincu qu’il fallait restaurer la grandeur du pays. Ce qui parlait aux élites de l’époque. Salazar a fait sa place grâce à son habileté, sa dureté et à une certaine idée du Portugal. C’était un homme de l’intérieur des terres – des Beiras – partageant un nationalisme tellurique, « de la terre et des morts. »
Salazar était également anti-libéral. Pour lui, le parlementarisme est inadapté et dangereux, un seul homme doit diriger. Salazar a une très haute idée de lui-même. Des années 1930 au début des années 1960, il ne délègue pas, cherche à tout contrôler – dépenses publiques en tête – et ne fait confiance qu’à lui-même. D’où sa propension à cumuler les fonctions ministérielles à plusieurs reprises (Affaires étrangères, Défense), tout en restant, de 1932 à son attaque cérébrale de la fin de l’été 1968, l’inamovible président du Conseil.
L’orchestration de son image, sans véritable culte de la personnalité, est très subtile. Dans les années 30, António Ferro va se charger de la propagande de l’Estado Novo. Il est l’inverse de Salazar : affable, souriant, rondouillard, ayant un carnet d’adresse large, admirateur du fascisme italien et de Mussolini, à l’aise en société. Salazar impressionne en privé, en tête-à-tête, alors qu’en public il est mal à l’aise. Ce n’est ni un mondain ni un « communicant », alors que Ferro lance une propagande dynamique et moderne. Salazar est montré comme le nouvel Infant Dom Henri, le « Navigateur » qui n’avait guère navigué mais qui, au XVe siècle, avait lancé les Découvertes portugaises. La presse le montre d’ailleurs sous les traits de l’Infant Henri, qui se transforme en celui de Salazar. Le dictateur ne s’oppose pas à cette mise en scène. S’il ne dit pas non c’est qu’il accepte. « Seul est ce qui paraît », comme il se plait à le faire croire.
Que peut-on retenir de la politique économique de Salazar qualifié de technicien des finances, de dictateur-comptable ?
Dans le contexte des années 20, cela s’apparente à une stricte orthodoxie budgétaire. C’est peu ou prou l’image qu’à un Raymond Poincaré en France. Partisan d’une monnaie forte, Salazar impose des cures d’austérité pour le respect du sacro-saint – déjà – équilibre budgétaire, la République parlementaire (1910-1926) n’y étant pas parvenu. Le personnage n’a rien d’original. Salazar est un homme nourri de l’enseignement économique typique de l’époque. Comme ministre des Finances, où il est nommé en avril 1928, il supervise les autres ministères et contrôle toutes les dépenses publiques. Dès 1929, le budget est équilibré et la monnaie nationale, l’escudo, retrouve la stabilité. D’où l’image qu’il cultive de « magiciens des finances ».
Ce n’est pas lui-même un homme d’argent, mais plusieurs cercles gravitent autour de lui et il entretient des relations avec plusieurs personnalités du monde économique. Salazar se défie de l’affairisme, identifié aux Etats-Unis, ceux de la prohibition et de la Grande dépression. Mais le patronat portugais a le soutien de l’Etat. Le dictateur portugais est habile ; c’est un technicien qui compose et impose. Dès son discours d’investiture aux Finances en 1928, il avait en quelque sorte annoncé la couleur : « Je sais très bien ce que je veux et où je vais ».
L’habilité ou l’ambiguïté de Salazar pendant la Seconde Guerre mondiale où il autorise les Alliés à installer leurs bases dans les Açores et en même temps d’autoriser des Portugais à s’enrôler l’armée allemande sur le front russe. Pendant la Guerre froide, le Portugal intègre l’OTAN et l’ONU… Tout cela a-t-il permis de préserver Salazar et son régime ou parfois cela le mettrait-il en difficultés ?
Pour l’essentiel, Salazar a privilégié le pragmatisme. Il a un sens du danger et du risque très prononcé, tant en matière de politique intérieure, que sur le plan extérieur. La neutralité de la péninsule ibérique était ambiguë. Pour Salazar, avec le souvenir de l’intervention portugaise durant la Première Guerre mondiale, le pays avait tout à perdre en s’impliquant dans un conflit. En faisant de la vieille alliance britannique la pierre angulaire de sa diplomatie, Salazar va peser pour que l’Espagne n’entre pas officiellement en guerre, oscillant entre une neutralité collaborante avec les Alliés anglo-américains – autour de la question stratégique des Açores – et des avantages commerciaux accordés aux puissances de l’Axe, par exemple avec le commerce du wolfram, minerai stratégique pour la fabrication des têtes d’obus et dont la vente aux Allemands ne cessera qu’au début de l’été 1944.
À la fin de la guerre, c’est la formule célèbre de Paul Eluard « le dur désir de durer » qui semble prévaloir. L’art de « savoir durer » est la marque de fabrique de Salazar. A l’annonce de la mort d’Hitler le 30 avril 1945, il met en berne les drapeaux et, en même temps, à la tribune de l’Assemblée nationale, chambre unique, Salazar déclare quelques jours plus tard : « Nous bénissons la paix, nous bénissons la victoire ». C’est une vision cynique du pouvoir. Par méfiance à l’égard des Etats-Unis, Salazar refuse dans un premier temps le Plan Marshall, avant de l’accepter, intérêt bien compris, tout comme il avait refusé dans un premier temps la présence américaine aux Açores, détestant le modèle américain, synonyme d’argent facile et de mœurs dissolues. Mais, à la fin de la guerre, l’allié historique britannique n’a plus sa puissance ni son rayonnement d’antan pour protéger son vieil allié et les routes commerciales maritimes de son empire colonial. Le protecteur, à son corps défendant, devient peu à peu américain notamment durant la Guerre froide. Dès 1949, le Portugal intègre l’OTAN, contrairement à son voisin espagnol. Le Portugal devient alors l’interlocuteur privilégié des Occidentaux dans la péninsule ibérique.
Les dernières recherches ont-elles permis de mieux connaître la PIDE, la police politique de l’Estado Novo ?
Il y a eu un vrai renouvellement historiographique depuis une trentaine d’années. Contrairement à d’autres pays, la chance du Portugal est d’avoir un accès relativement facile aux archives de l’Estado Novo. Celles mêmes de Salazar sont publiques, aux Archives nationales de Torre do Tombo, à Lisbonne. Les archives sont digitalisées et assez riches, parfois lacunaires, même s’il y a le problème de la prescription de l’atteinte de la vie privée. La PIDE surveillait tout et pouvait soupçonner quelqu’un qui n’allait plus à la messe, suffisant à en faire un suspect. C’était une police implacable de la pensée et du quotidien. Aujourd’hui, il y a un meilleur accès, mais lorsque j’ai commencé à travailler sur le sujet, il y avait des obstacles. Le renouvellement historiographique des derniers années concerne notamment les connaissances liées à la question coloniale, sa centralité dans l’Estado Novo. Ainsi que l’histoire sociale « par le bas », des « petites choses », même si beaucoup reste encore à faire. Aujourd’hui, globalement, le corpus est intéressant par rapport au voisin espagnol, où travailler sur Franco est toujours difficile tant la famille du dictateur a phagocyté les archives.
La diffusion de l’anti-colonialisme et de la libération sexuelle dans les années 60 a-t-elle touché le Portugal ?
Oui avec la montée d’une puissance d’une classe moyenne et avec les révoltes d’étudiants en 1962 et en 1968-69. Mai 68 a touché la société portugaise, mais de façon diffuse, Salazar ne quittant le pouvoir qu’en septembre 1968. L’autre élément déterminant, c’est l’émigration massive due à la pauvreté et à la volonté de fuir à la conscription. Des centaines de milliers de Portugais se sont alors installés en France, en Suisse ou encore en Allemagne fédérale, le Portugal étant à la fin des années 1960 le seul pays d’Europe occidentale à voir sa population diminuer.
Le mouvement des capitaines a également été influencé par les conditions de la guerre coloniale (le « Vietnam portugais ») mais aussi par les contestations étudiantes des années 60.
L’armée a toujours eu un soutien ambigu au régime, dont Salazar se méfiait. Certains officiers supérieurs, par républicanisme, par atlantisme, se sont même opposés au dictateur, notamment le général Delgado, candidat à l’élection présidentielle de 1958 et que Salazar fera assassiner par sa politique politique – la PIDE – en février 1965 à la frontière espagnole.
Avec l’intensification des guerres coloniales, il y a eu une « démocratisation » de l’armée avec l’envoi de jeunes issus des classes moyenne ou populaire, comme le capitaine Salgueiro Maia. Plusieurs, étudiants, n’étaient pas des militaires professionnels. Ce sont ces jeunes officiers, « les capitaines d’avril », qui ont été les acteurs décisifs de la Révolution du 25 avril.
Quelles sont les différences entre Salazar et son successeur Marcelo Caetano qui, lui, a été renversé ?
Les différences sont nombreuses, même si, comme Salazar, Caetano est un professeur universitaire reconnu, spécialiste de droit public. Chef de la Jeunesse portugaise, ministre des Colonies, Marcelo Caetano (1906-1980) semblait être un successeur crédible de Salazar qui s’était bien gardé de désigner son dauphin. Les choses changent durant les années 50 avec les querelles de clans autour de Salazar. Rugueux, ce dernier se méfiait d’un Caetano plus hésitant, au caractère moins trempé que lui.
Au début des années 60, Caetano est devenu recteur de l’université de Lisbonne, au moment des révoltes étudiantes et il avait eu des propos ambigus, laissant entendre qu’il comprenait plus ou moins les revendications étudiantes.
Marcelo Caetano, qui n’était pas le favori des ultras du régime, a tenté d’impulser une improbable « libéralisation du régime », le « printemps marceliste ». Surveillé par les ultras, jusqu’au-boutistes sur la question des guerres coloniales, Caetano a échoué à imposer tant une libéralisation véritable du régime, qu’une issue négociée et pacifique pour les colonies, rebaptisées « provinces d’outre-mer » depuis les années 1950.
Comment les Portugais perçoivent ce lourd passé ?
Le 25 avril 1974 est une transition par rupture, par opposition contrairement à l’Espagne où la constitution de 1978 est une sorte de chape de plomb de l’oubli. Plusieurs dirigeants salazaristes font le choix de l’exil mais certains sont jugés et emprisonnés, même si l’épuration politique et administrative n’est pas massive. Le rapport au passé est marqué par une forme de rupture symbolisée par « le 25 avril ». Il y a également une forme de « silence de la mémoire », entretien par le rituel commémoratif. Pour les jeunes générations qui n’ont connu que la démocratie, il y a une forme d’occultation du passé, teintée d’ignorance.
Chez certains Portugais, l’image d’un Salazar rigoureux et probe suscite une forme de nostalgie, même si l’extrême droite reste très marginale. A la différence de l’Espagne, il n’existe pas de lieu symbolique de mémoire, comme le mausolée de Franco dans le Valle de los Caidos près de Madrid. Même si, cycliquement, revient à la surface, comme tout récemment, le projet d’une sorte de musée de l’Etat nouveau, implantée dans le village natal de Salazar ou près de celui-ci dans les Beiras, à Santa Comba Dão.
Une partie de la droite a tout de même repris à son compte certaines idées chères au salazarisme, celles liées à la soumission à un ordre – supposée immuable – des choses, incarné dans ce Portugal que Salazar entendait « faire vivre habituellement », à l’accoutumée, sans révolte, comme apolitique et hors du temps, respectueux des valeurs intangibles du salazarisme, « Dieu, patrie, famille, travail, autorité ».
Le Salazarisme est-il un modèle d’inspiration pour des régimes d’extrême droite comme le Brésil ?
Le salazarisme est daté, singulier, peu modélisable. Mais il peut être source d’inspiration comme, tout récemment, au Brésil dont le nouveau président de la République, Jair Bolsonaro, a repris dans sa campagne l’une des devises de Salazar « Dieu, patrie, famille », faisant référence au célèbre discours de 1936 où Salazar déclarait à Braga : « Nous ne discutons pas Dieu, nous ne discutons pas la patrie, nous ne discutons pas la famille, nous ne discutons pas le travail, nous ne discutons pas l’autorité… ». Bolsonaro a amplifié de tels propos grâce aux réseaux sociaux, certes fort éloignés des moyens de communication de l’époque de Salazar.
Brieuc Cudennec – Le paratonnnerre – Décembre 2018
À l’occasion du 45ème anniversaire de la Révolution des œillets au Portugal, qui a mis fin à une dictature vieille de près d’un demi-siècle, Le Vent Se Lève a rencontré Yves Léonard, spécialiste français de l’histoire contemporaine du Portugal. Docteur en histoire, il a notamment publié une Histoire du Portugal contemporain – préface de Jorge Sampaio, octobre 2016, ainsi que Le Portugal, vingt ans après la Révolution des œillets (1994), Salazarisme et fascisme (1996), La lusophonie dans le monde (1998) Mário Soares, Fotobiografia, (2006). Entretien réalisé par Sarah De Fgd et Pierre-Alexandre Fernando, retranscrit par Adeline Gros.
Le Vent Se Lève – Dans l’imaginaire collectif, l’intégration européenne du Portugal est associée à la chute de la dictature de Salazar qui est allée de pair avec une démocratisation croissante du pays. Cependant, depuis 2008, l’Union européenne est associée à une politique d’austérité extrêmement dure sur le plan social. Quel regard portent les Portugais sur la construction européenne ? La décennie d’austérité qui vient de s’achever a-t-elle entaché le capital de sympathie dont a pu disposer l’Union européenne à une certaine époque ?
Yves Léonard – Si l’on compare les différentes enquêtes d’opinion, telle que l’Eurobaromètre, réalisée par la Commission européenne, la perception des Portugais est plutôt au-dessus de la moyenne européenne ; le sentiment est moins négatif qu’ailleurs, le Portugal se situant même dans le premier groupe des six pays les plus favorables aux logiques de l’intégration européenne. Cette perception varie néanmoins en fonction des différentes classes sociales et du niveau de qualification, alors que la confiance dans l’Union et l’image de l’Union ont légèrement baissé au Portugal entre le printemps et l’automne 2018 [1]. Les élites portugaisesont toujours considéré depuis le milieu des années 1970 qu’il fallait adhérer, que l’avenir du Portugal était européen, ou devait à tout le moins s’envisager dans le cadre de la construction européenne. Ce sentiment a assez peu évolué en trente ans. En revanche, l’opinion publique a longtemps été relativement peu sensibilisée à la question européenne, hormis par sa dimension financière avec la manne des fonds structurels parsemant routes et infrastructures en construction de drapeaux aux couleurs de l’Europe. L’adhésion s’est faite dans un contexte particulier, comme un prolongement naturel à la transition démocratique et à la décolonisation – « l’Empire est mort, vive l’Europe » selon une formule de Mário Soares (1924-2017) –, malgré une certaine lenteur des négociations (1977-1985). Car si le Portugal était le bienvenu, il a dû néanmoins faire face à des réticences d’autant plus fortes que son adhésion était liée à celle de l’Espagne qui inquiétait ses voisins européens, en raison notamment du poids encore important du secteur agricole. En définitive, l’opinion publique portugaise a vécu l’adhésion dans une relative indifférence. Les partis politiques de gouvernement, européistes, à savoir le Parti socialiste (Partido socialista, PS) et le Parti social-démocrate (Partido Social Democrata, PSD, centre-droit), ont fait peu de pédagogie autour de la question de l’Europe. D’autant qu’ils entendaient « regarder vers l’Atlantique », en développant échanges et dialogue avec les espaces lusophones (plus de 250 millions de locuteurs dans le monde), tant en Amérique du Sud (Brésil), qu’en Afrique (Angola, Mozambique), grâce, notamment, à la création en 1996 de la CPLP (Communauté des pays de langue portugaise). Une partie de l’opinion publique portugaise n’a pris que tardivement la mesure d’un certain nombre de conséquences douloureuses – en termes d’emploi et de restructurations à la hâte des secteurs agricoles et industriels – que pouvait avoir l’adhésion à l’Europe, notamment lors de périodes de crise et de difficultés. Cela fut le cas dans un premier temps au tournant des années 2000, avec le ralentissement de la croissance. Lors de la crise de la fin des années 2000, une grande partie de l’opinion est d’abord restée silencieuse, avant de se réveiller pour formuler avec force ses critiques à l’encontre d’une construction européenne identifiée dès lors à la Troïka. Aujourd’hui, et notamment depuis le virage anti-austérité qui a été pris depuis plus de trois ans [2], cette opinion reste plutôt majoritairement favorable à la construction européenne.
LVSL – Le Portugal fait partie avec des pays comme l’Espagne la Grèce et l’Irlande, qui ont été placés sous tutelle de la Troïka – Commission européenne, BCE, FMI – auxquels on a imposé des réformes structurelles d’inspiration néolibérale. Comment ces réformes et leur mode d’imposition ont-ils été perçus par les Portugais ?
YL – Très mal. D’abord à cause de leur dureté : baisse des salaires, de traitement pour les fonctionnaires, des pensions de retraites. S’en est suivie une contraction énorme, à l’issue de laquelle certaines catégories professionnelles ont perdu jusqu’à un tiers de leurs revenus. À cela s’ajoutent la hausse du chômage et tout un cortège de mesures d’accompagnement, dont la suppression de certains jours fériés. Ces mesures extrêmement dures ont été d’autant plus mal perçues qu’elles ont été imposées de manière brutale à une population déjà fragilisée par des années de politique de rigueur et de croissance atone, dans un contexte où les Portugais ont éprouvé un farouche sentiment de perdre une nouvelle fois leur indépendance. Vous avez parlé de la mise sous tutelle du Portugal par la Troïka ; il y a des précédents dans l’histoire portugaise. C’était le cas à la fin des années 70 et au début des années 80, avec les aides du FMI, alors que le pays connaissait de réels problèmes économiques. Le Portugal est devenu au fil des années – 90 notamment – celui qu’on appelait le « bon élève de l’Europe », donc en quelque sorte un exemple, avec pour apogée l’Expo’98, l’exposition universelle de Lisbonne consacrée à l’été 1998 au thème des Océans, avenir de l’humanité. D’un seul coup, dans les années 2000, le Portugal était devenu un mauvais élève, celui dont on dénonçait la mauvaise gestion. Il y avait en toile de fond tous les symptômes du traumatisme grec. Une grande partie des classes moyennes qui ont pour l’essentiel été les grandes gagnantes de l’européanisation, de l’après-dictature, s’est trouvée fragilisée ; les classes populaires ont quant à elles vécu le démembrement de secteurs industriels traditionnels avec une extrême violence. On parle souvent des Indignés espagnols, mais il faut se souvenir que les manifestations au Portugal ont commencé avant les manifestations espagnoles, dès le mois de mars 2011 – date à laquelle il y a eu spontanément, hors partis, hors syndicats, par les réseaux sociaux pour l’essentiel, des mobilisations très fortes pour dénoncer l’austérité et la prochaine intrusion de la Troïka avec des slogans qui sont passés à la postérité. On a notamment remis au goût du jour une phrase emblématique de « Grândola, vila morena », la chanson de la Révolution des œillets, qui disait « c’est ici que le peuple commande », sous-entendant que l’influence de la Troïka sur le Portugal constituait une ingérence étrangère (« Que se lixe a Troïka » – « Que la Troïka aille se faire foutre »). Le film de Miguel Gomes Les mille et une nuits (2015) le montre bien. Il permet de prendre la mesure de la condescendance, du mépris à peine voilé des représentants de la Troïka à l’égard du Portugal. À l’ère des réseaux sociaux, cette attitude a été très mal perçue. Dans les années 1980, avant l’adhésion à l’Europe, la situation avait été différente. Avec les réseaux sociaux, l’indignation s’est répandue comme une traînée de poudre.
LVSL – Quelle est la nature du « miracle portugais » que décrivent certains médias ? Est-il le produit d’une politique de relance sociale ? Ou d’une stratégie de dumping fiscal mise en place depuis 2008, visant à attirer entreprises et retraités fortunés comme l’affirment certains économistes plus critiques ?
YL – Un peu de tout cela. Les autorités portugaises, qui ont fait preuve de volontarisme, ont également bénéficié d’un alignement des planètes. A l’automne 2015, la volonté de mettre fin à l’austérité coïncide avec une baisse du prix de l’énergie et du pétrole. Je ne parlerai pas de miracle : il y a eu une volonté très forte de modifier radicalement la donne et de s’unir pour s’opposer à des politiques dont on avait vu toute la dureté sur le plan social. La Geringonça est le fruit d’une volonté d’en finir avec la politique des précédents gouvernements qui avait appliqué et amplifié les mesures dictées par la Troïka. Une volonté partagée par toute la gauche de tourner la page.
Plusieurs mesures adoptées au début des années 2010 – flexibilité du marché du travail, synonyme de précarité accrue, dumping fiscal, avec le visa gold, (le visa doré) – n’ont pas été remises en question. La relance par la demande – singulière à l’échelle européenne – a eu lieu dans un contexte favorable, qui a permis à la consommation de repartir à la hausse, grâce notamment à une hausse du salaire minimum, passé de 450 à 600 euros. Il y a eu durant ces années des secteurs entiers de l’économie portugaise qui ont changé de nature, une mutation justifiée par l’idée qu’il fallait monter en gamme, pour reprendre une expression qui renvoie à l’imaginaire néolibéral et managérial. Au fil des années, des secteurs traditionnels, tels que le textile, la chaussure ou le vin, se sont modernisés pour être concurrentiels à l’exportation, principal levier de la croissance avec le tourisme.
Pourtant, si la croissance est supérieure à 2 %, le chômage en baisse et le déficit public à son plus bas niveau depuis le rétablissement de la démocratie, si le WebSummit annuel de Lisbonne confère au Portugal une image d’innovation et de Startup nation, précarité, inégalités et pauvreté sont loin d’avoir disparu, alors que l’investissement public reste insuffisant. Le syndrome Airbnb frappe la capitale Lisbonne où, nourris par la spéculation et les visas dorés, les prix de l’immobilier se sont envolés, chassant les habitants des quartiers traditionnels. Si l’on respire mieux au Portugal, difficile de parler d’un miracle économique.
LVSL – Peut-on parler d’un modèle portugais comme le font certains partis européens de gauche, qui pourrait être dupliqué ? Y a-t-il une quelconque cohérence dans la coalition qui est au pouvoir, ou est-elle simplement le produit de rapports de force entre un parti communiste – marxiste et eurosceptique – et un parti socialiste – europhile et social-libéral – de l’autre ?
YL – Un modèle est source d’inspiration et reproductible. Tout porte à croire que ce n’est pas le cas du Portugal, dont la coalition fait figure de cas très singulier à échelle européenne. C’est un modèle qui n’est, pour l’heure, ni exporté, ni dupliqué.
Cependant, le cas portugais devrait inciter à beaucoup plus de réflexion à l’échelle européenne que ce n’est le cas actuellement. On a beaucoup commenté ce qui s’est passé en Espagne ces derniers mois, et le cas portugais n’est évoqué – quand il l’est -, comme souvent, que de manière périphérique, voire anecdotique. Or ce qui s’y passe est tout sauf anecdotique parce que c’est l’expression d’une alternative, d’une voie singulière, produit d’un rapport de force politique et d’une volonté de mettre fin à l’austérité. Le « tout sauf ça » a permis des échanges et un rapprochement, qui n’était pourtant le mot d’ordre d’aucun des trois partis membres de la coalition à l’été 2015, lors de la campagne des législatives. La coalition a été le fruit d’une nécessité – tourner la page de l’austérité – et d’un contexte politique inédit permettant à la gauche – majoritaire en voix et en sièges à condition d’unir ses forces – de gouverner.
L’intérêt de cette organisation (la geringonça), c’est son fonctionnement, à première vue de bric et de broc, brinquebalant : vous avez trois formations qui sont obligées de s’écouter et de débattre, en s’opposant parfois, afin d’aboutir à des solutions. En s’efforçant de concilier impératif européen – prôné par le Premier ministre António Costa et le ministre des Finances Mário Centeno, président de l’Eurogroupe -, et impératif social, aiguillonné par le Bloc de Gauche et le Parti communiste. Fort de son solide ancrage local, le Parti socialiste, d’orientation social-libérale sous les gouvernements de José Socrates (2005-2011), défend, avec António Costa qui a pris le contrôle du parti en 2014, une ligne se voulant plus à gauche, plus social-démocrate. Ce sont les primaires de 2014 qui lui ont permis de s’imposer face à un adversaire qui était sur une ligne plus classique à l’échelle de l’Europe, au social-libéralisme affirmé. Sans cette évolution ni la main tendue par le Bloc de Gauche, aucune entente n’aurait été possible et la geringonça n’aurait pu voir le jour, alors que le PC se tenait dans l’opposition depuis 1975.
Des conflits sociaux perdurent (éducation, santé) et des divergences subsistent entre les membres de la geringonça sur un certain nombre de sujets. Mais, jusqu’ici, sans altérer la stabilité politique ni bloquer le système, une fois que le débat a eu lieu et que des opinions contradictoires se sont exprimées, permettant de produire des textes législatifs et des mesures concrètes. Pour ces raisons, c’est un cas intéressant de mise en commun et de réflexion collective. Il reflète aussi un rapport de force singulier entre un Parti socialiste autour de 35 % et deux autres forces qui peinent à dépasser les 10 %, aucune des trois formations n’ayant eu intérêt à rompre cet attelage brinquebalant. Même si celui-ci profite plus nettement au PS. Bien que le Bloco de Esquerda, qui a obtenu 10 % des voix aux dernières législatives d’octobre 2015 reste un parti essentiellement urbain, et le Parti communiste, qui a essuyé un revers aux élections municipales de 2017, plafonnent dans les intentions de vote pour les prochaines élections législatives d’octobre 2019. C’est une configuration très particulière, due au fait qu’il n’y a pas, à échelle européenne, d’autre cas où un parti social-démocrate frôle les 35 % et échappe à la pasokisation généralisée. Le cas portugais reste donc très singulier, même comparé à son voisin espagnol.
LVSL – L’une des données marquantes du paysage politique portugais réside dans l’absence d’une extrême droite vraiment significative, alors qu’en Espagne, une extrême-droite franquiste, jusqu’alors contenue dans le parti populaire est en train de renaître via le mouvement Vox qui a eu un franc succès lors des dernières élections en Andalousie. Comment expliquer cette absence de l’extrême droite dans le spectre politique portugais ? Est-ce du fait de l’héritage de la dictature de Salazar qui serait trop récente, et perçue trop négativement par les Portugais ?
YL – Cela tient pour partie à ce poids de la dictature salazariste, mais surtout à la manière dont le Portugal est sorti de la dictature. Si l’on compare avec le voisin espagnol, les deux cas sont antinomiques : d’un côté, en Espagne, il y a eu une transition pactée, négociée, avec le Pacte de l’oubli [3] dont on mesure aujourd’hui toutes les conséquences ; et de l’autre, le cas portugais pour lequel, la transition s’est faite par rupture, avec un coup d’État, la Révolution des œillets qui, en une journée, a renversé une dictature vieille de près d’un demi-siècle. L’héritage de cette transition est très prégnant dans la mémoire collective. En outre, des dispositions interdisant à un parti officiellement fasciste ou se réclamant du fascisme de se présenter à des élections ont été intégrées dans la Constitution de 1976. Il y a également des raisons liées à la singularité du cas portugais, pays traditionnel d’émigration, moins en première ligne que ses voisins sur la question des migrants dans le bassin méditerranéen et moins touché par les crispations identitaires liées à une immigration relativement faible, même si racisme et xénophobie existent au Portugal.
Malgré un taux d’abstention lors des différentes élections assez élevé, qui s’approche de la moyenne européenne, la crise de confiance dans les partis politiques est moins importante au Portugal que dans d’autres démocraties occidentales. On peut parler d’une forme de résilience des partis politiques. Les deux partis dominants, qui alternent au pouvoir depuis la Révolution des œillets, maintiennent des scores importants, entre 30 et 40 % des voix pour le Parti socialiste (PS) et entre 20 et 30 % pour le Parti social-démocrate (PSD). Ces deux seuls partis captent 70 % de l’électorat, ce qui constitue une exception. Il n’y a donc pas eu d’espace laissé pour l’expression autonome d’une droite qualifiée de populiste, radicale. C’est pour cela qu’on dit qu’il n’y a pas de populisme ni d’extrême-droite au Portugal, ce qui se vérifie aujourd’hui : le Parti national rénovateur (Partido Nacional Renovador) a fait un score de 0,5 % lors des dernières élections législatives en 2015, ce qui est peu à l’échelle européenne. Cependant, la donne est peut-être en train d’évoluer pour deux raisons : d’une part, l’exemple espagnol a libéré la parole chez certains. Il y a comme un effet de capillarité, de mimétisme qui peut jouer, d’autant que les réseaux sociaux peuvent rapidement l’alimenter. Avec les influences venues d’autres pays, avec des personnalités telles que Steve Bannon et ses émules, le Portugal n’est pas un îlot à l’abri. D’autre part, en raison d’une forme de résurgence du discours nationaliste.Salazar, avec son entêtement obsessionnel à faire du Portugal un grand pays colonial, avec son nationalisme d’empire passéiste et anachronique, avait d’une certaine façon tué le match en invalidant toute forme de discours ultra-nationaliste, cause d’une décolonisation tardive et conflictuelle qui avait provoqué le renversement de la dictature au printemps 1974. Quant au testament salazariste, selon lequel, privé de ses colonies, le Portugal disparaîtrait, il avait lui aussi été rapidement invalidé par l’ancrage européen de la jeune démocratie portugaise. Dans l’actuelle campagne des européennes, chez les deux partis traditionnels de centre-droit et de droite, il existe une certaine porosité, sinon dérive populiste, tant au sein du CDS-Parti Populaire (CDS-Partido Popular), que du Parti social-démocrate (PSD), partis assez éclatés actuellement et en perte de repères. Une partie de leurs élus et une partie de leur électorat sont en attente, tentés par un discours empreint de nostalgie d’une grandeur révolue et de repli obsidional, volontiers contempteurs d’une geringonça brocardée comme mauvaise gestionnaire et clientéliste. Type de discours qui les rapprocherait davantage d’une droite populiste. La situation est donc peut-être en train d’évoluer, même si c’est encore trop tôt pour l’affirmer.
LVSL – En Espagne, la question de la mémoire historique est prégnante. Une loi d’amnistie, le Pacte de l’oubli, a été votée pendant la période de transition démocratique. Elle est d’une actualité brûlante, comment l’a montré le récent documentaire Le silence des autres. Qu’en est-il au Portugal ? Y a-t-il eu un travail sur la mémoire historique, de réparation des crimes commis pendant la dictature de Salazar ? L’héritage de Salazar est-il aujourd’hui un sujet clivant dans la société portugaise comme ça peut l’être en Espagne où des représentants politiques, et des personnes issues de la société civile se revendiquent ouvertement de l’héritage de Franco ?
YL – Pour comprendre cette question de la mémoire historique, il faut revenir à la transition. Nous sommes actuellement en période de commémoration du 45ème anniversaire de la Révolution des œillets du 25 avril 1974, qui a permis le renversement de la dictature. Chaque année, à la même période, les Portugais se souviennent des événements du 25 avril 1974. Comme tout cycle commémoratif, il y a des hauts et des bas, des périodes plus aseptisées où finalement ce ne sont plus que des mots que l’on délivre avec un sens qui se perd, au risque de banaliser l’événement 25 avril présenté, lors de son 30ème anniversaire, plus comme une évolution qu’une révolution. Cependant, au moment du 40ème anniversaire en 2014, en pleine période d’austérité imposée par la Troïka, se sont multipliées les critiques sur le fait que les idéaux de la Révolution des œillets auraient été trahis. Ce cycle commémoratif, qui fait d’un jour de commémoration un jour férié depuis 1976 – le Jour de la Liberté, permet de seremémorer chaque année cet événement clé de la démocratie. C’est d’autant plus important lorsqu’on compare les modes de construction de la démocratie en Espagne et au Portugal. Même si, face à l’horreur des dictatures, il est toujours très difficile de faire des comparaisons et de quantifier l’abjection, la dictature de Salazar a été une dictature très dure, gouvernant par la peur, où, dans la vie quotidienne, la population était épiée par la police politique. Mais il n’y a pas eu au Portugal cette épouvantable guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts, traumatisme majeur de la société espagnole. Soutien du régime franquiste, le Portugal de Salazar n’a pas connu de guerre civile. Et, à la différence de l’Espagne franquiste, la dictature a été renversée le 25 avril par le Mouvement des Capitaines et une révolution à la fois pacifique et populaire. Ce qui change pas mal de choses au regard des pratiques démocratiques, plus inclusives dans le cas portugais [4].
Au Portugal, l’enseignement de l’histoire du temps présent est un peu le parent pauvre des programmes scolaires. Il y a eu néanmoins de nombreuses avancées depuis trente ans, fruits d’une histoire savante développée, entre autres, par l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université Nouvelle de Lisbonne, l’Institut de Sciences sociales (ICS) de l’Université de Lisbonne et le Centre de Documentation du 25 avril à l’Université de Coimbra, qui ont produit – et qui continuent de produire – d’excellents travaux sur la période de la fin du salazarisme, sur la Révolution des œillets et la transition. Cependant, le problème de la diffusion de cette histoire savante demeure. Une grande partie de la population portugaise – les jeunes notamment – ignorent largement ce que fut la dictature. Et alors que ceux qui l’ont vécue, il y a plus de 45 ans, disparaissent, cette mémoire née de la transmission entre générations ne se fait plus de la même manière. La transmission ne s’est pas toujours très bien faite dans les familles. On ne parlait pas facilement du temps de la dictature parce qu’il y avait une sorte de chape du silence, ainsi qu’une volonté d’oublier, voire de banaliser, chez certains, le temps de la dictature.
Quant au personnage de Salazar, il ne suscite pas de culte de la personnalité, contrairement à l’Espagne où certains se revendiquent ouvertement de Franco. Salazar était lui-même partagé sur ce culte de la personnalité. Comme ces fantômes qui viennent vous visiter sans forcément vous hanter, il continue de susciter auprès d’une certaine partie de la population, vieillissante,qui a vécu au temps du salazarisme, le souvenir non pas d’un dictateur implacable, mais d’un homme honnête et vertueux. Au point d’avoir été désigné en 2007 comme la personnalité majeure de l’histoire du vingtième siècle portugais par un sondage fort peu scientifique réalisée par la chaîne de télévision RTP. Aujourd’hui, alors que la corruption et le clientélisme n’ont pas disparu, on voit bien comment certains pourraient chercher – quand ils ne l’ont déjà fait – à utiliser l’image d’un personnage qui incarnerait une forme de probité. Très récemment a ressurgi l’idée d’un musée qui serait consacré à Salazar dans son village natal près de SantaComba Dão. Mais cela reste un projet. Il faut rester toujours très attentif parce que la révolution a permis de solder en partie les comptes de la dictature. Il y a eu alors une épuration, avec le jugement et la condamnation d’une partie des équipes dirigeantes de l’ÉtatNouveau [5], souvent exilées au Brésil. Il y a eu un changement de cap et de personnel politique, mais qui ne pouvait pas être complet compte tenu de la taille et des besoins du pays. Une partie de ces élites politiques et économiques s’est d’ailleurs organisée pour réapparaître au bout d’un certain temps. Alors qu’en Espagne, lors de la transition, le Pacte de l’oubli a permis à de nombreuses personnalités de continuer d’exercer leurs fonctions quand bien même elles étaient impliquées dans la gestion de l’ancien régime. Plus que le devoir de mémoire, ce qui importe réellement, c’est le besoin d’histoire. Il y a un besoin de connaître et d’écrire cette histoire. Elle est aujourd’hui largement écrite et connue, même si elle est entachée de quelques tentatives révisionnistes. Avec aussi de belles avancées récentes en matière d’histoire sociale, par en-bas, l’histoire des petites choses. Mais la transmission auprès du grand public reste imparfaite. Une partie de la jeunesse ne sait plus ce que fut le 25 avril.
LVSL – Le Portugal est assez peu évoqué dans les médias français, malgré les liens historiques qui unissent la France et le Portugal du fait de la vague d’émigration massive des années 1960-70. Selon vous, comment peut-on expliquer ce manque d’intérêt de la part des médias français ?
YL – C’est le fruit d’une longue histoire. Le Portugal a longtemps été considéré comme un pays périphérique par les Français, avant tout rivaux de leurs voisins immédiats, Anglais, Allemands ou Espagnols. Le Portugal n’était pas un enjeu majeur, de par l’exiguïté de son territoire et son caractère périphérique à l’échelle du continent européen. Les recherches en France sur le Portugal sont relativement récentes à l’exception de la période des Découvertes,sur l’Infant Henri, le Navigateur, ou Vasco de Gama par exemple. Pour la France, le Portugal était un cas d’autant plus marginal qu’il était méconnu. Il y a eu des moments où la France a plus regardé du côté du Portugal, ainsi quand la République a été proclamée par exemple [6]. Du temps de Salazar, des pans entiers de la droite réactionnaire et conservatrice française ont puisé dans le salazarisme une source d’inspiration. Le régime de Vichy s’est très largement inspiré du modèle incarné par Salazar [7]. Mais le reste des échanges était relativement faible. Le Portugal était avant tout l’allié historique de l’Angleterre. L’arrivée massive des émigrés portugais dans les années 1960 n’a guère changé les choses, l’ignorance restant totale de leur culture, nourrissant au contraire de nombreux stéréotypes empreints de condescendance et de moqueries sur « ce pays de concierges et de maçons », teintés malgré tout d’une forme de respect pour le « bon travailleur portugais », respectueux et dur à la tâche, comme l’a montré le film de Ruben Alves La cage dorée (2013). Les choses ont changé ces dernières années, non pas tant avec l’engouement touristique des Français pour le Portugal, mais par les avancées de la recherche historique qui permettent de faire connaître l’histoire de ce pays, ainsi que sur le plan culturel avec la découverte des grands auteurs portugais tels que Fernando Pessoa (1888-1935), José Saramago (1922-2010), seul Prix Nobel de Littérature portugais à ce jour, ou bien encore António Lobo Antunes.
La Révolution des œillets a constitué un moment charnière au cours duquel une grande partie de l’intelligentsia et des responsables politiques français se sont tournées vers le Portugal, à la fois pour observer et se nourrir de son exemple, mais aussi pour donner des conseils, faisant de ce pays un véritable laboratoire d’expérimentations politiques et sociales, nourrissant une efflorescence d’ouvrages et d’articles. La singularité de la geringonça et du redressement économique devrait de nouveau susciter pareil engouement pour le Portugal.
Sarah de Fgd, Le vent se lève, avril 2019
« Portugal une exception européenne »
Émission diffusée le vendredi 29 octobre. Par Daniel Desesquelle, avec Ana Navarro Pedro, journaliste correspondante à Paris de l’hebdomadaire Visão ; António Costa Pinto, professeur de sciences politiques à l’Université de Lisbonne en ligne de Lisbonne et Yves Léonard, enseignant à Sciences Po. Son dernier livre « Histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours »
Book review Histoire du Portugal contemporain – de 1890 à nos jours »
The histories of contemporary Portugal written in French have been few and far between. Prior to Yves Léonard’s new book, the only scholarly synthesis of Portugal’s recent past had been Jacques Marcadé’s now dated Le Portugal au XXe Siècle (1988). French readers interested in engaging with contemporary Portugal have been restricted mainly to the general histories of Portugal written by Robert Durand (1992), Jean-François Labourdette (2000) and Albert-Alain Bourdon, the latest edition of which includes an “épilogue” written by Yves Léonard on “today’s Portugal” (2014). By nature these works are extremely brief, to the point of offering at times little more than a factual panorama of the country’s recent past. None of them offers anything like an updated synthesis of Portugal’s contemporary history. This is particularly regrettable if one considers the wealth of innovative investigation produced by researchers in the subject area over roughly the last two decades. Léonard’s new book is thus a timely addition to the existing bibliography.
BOURDON, A.A. (2014), Histoire du Portugal, 4th ed., Paris, Chandeigne.
DURAND, R. (1992), Histoire du Portugal, Paris, Hatier.
LABOURDETTE, J.F. (2000), Histoire du Portugal, Paris, Fayard.
LÉONARD, Y. (1999), “O império colonial salazarista” and “O ultramar português”. In F. Bethencourt, K. Chaudhuri (eds.), História da Expansão Portuguesa, vol. v, Último Império e Recentramento (1930- -1998), Lisbon, Círculo de Leitores, pp. 10-50.
LÉONARD, Y. (2003), Salazarisme et fascisme, 2nd ed., Paris, Chandeigne. léonard, Y. (2011), Salazarisme, nationalisme et idée coloniale au Portugal. phd thesis, Paris, Institut d’Études Politiques.
MARCADÉ, J. (1988), Le Portugal au xxe siècle, Paris, Presses Universitaires de France.
Dans Histoire du Portugal contemporain », Yves Léonard propose, à travers un exposé clair et une lecture agréable, une synthèse de l’histoire du Portugal contemporain qui « reste encore trop méconnue en France, alors que des flux croissants de touristes français découvrent le pays, parfois pour s’y installer, l’heure de la retraite venue. Mais, clichés et préjugés continuent d’avoir la dent dure. »
De très nombreuses photographies, des tableaux et des cartes enrichissent le présent ouvrage qui présente, en 10 chapitres, l’histoire du Portugal depuis le déclin de la monarchie (1890-1910) jusqu’à l’époque actuel avec l’élection de Marcelo Rebelo de Sousa à la présidence de la République. On soulignera les trois derniers chapitres qui montrent l’évolution politique et économique du Portugal depuis son entrée dans l’UE, et surtout le dernier chapitre (Oeillets fanés et génération dans la mouise ») où l’auteur aborde les « années piteuses » marquées par le chômage, la précarité, l’émigration des jeunes, la réduction des salaires, etc. Outre une très riche bibliographie et repères chronologiques judicieusement organisés, la présente étude est précédée d’un avant-propos de Jorge Sampaio, Président de la République portugaise de 1996 à 2006.
Enfin, signalons dans l’introduction du livre, cette épigraphe inspirée d’un des romans d’Eça de Queirós, écrivain critique et fin observateur de la société portugaise, pratiquant une ironie acerbe et clairvoyante : « Et Jacinto n’en revenait pas qu’il y eut encore au Portugal un sébastianisme. Mais nous le sommes tous ici, mon cher Jacinto ! À la ville comme à la campagne, chacun d’entre nous attend un dom Sébastien. Même la loterie de la Miséricorde est une forme de sébastianisme. Moi, tous les matins, même s’il n’y a pas de brouillard, j’attends le mien. » Face aux nouveaux défis, cette quête séculaire d’un « sauveur » n’appartiendrait-elle pas au passé ? – s’interroge et nous interroge Yves Léonard.
Dominique Stoenesco – Lusojournal – 12 octobre 2016
Écrite par le meilleur spécialiste francophone, Histoire du Portugal contemporain, de 1890 à nos jours constitue une remarquable synthèse qui rend enfin justice à un pays et une civilisation trop longtemps délaissés dans le paysage éditorial de l’Hexagone. Le choix de la date du titre n’est pas anodin, puisque l’année 1890 correspond à l’humiliant ultimatum britannique sonnant le glas du rêve de l’expansion coloniale portugaise en Afrique méridionale, celui d’un nouveau Brésil en Afrique (la fameuse « carte rose »). Lors de ce moment charnière, la monarchie prend conscience de son impossibilité de s’affranchir de l’étouffante tutelle anglaise et du profond déséquilibre dans la relation entre les deux alliés historiques.
Si d’aucuns caractérisent la période qui succède aux invasions napoléoniennes et la perte du Brésil comme un long et inexorable déclin de l’éclat portugais, Yves Léonard, lui, décrit le souffle de l’extraordinaire richesse des courants et des idées politiques qui jalonnent les premières années du régime républicain, avant de se pencher sur les conditions menant à l’ascension et à l’établissement du régime corporatiste mis en place par le tout par le tout-puissant président du conseil Salazar (1932-1968). L’occasion pour l’auteur de se pencher sur la nature de ce pouvoir, à la lumière de riche débats qui traversent actuellement l’historiographie portugaise. Si le salazarisme emprunte des traits du fascisme italien dans sa constitution institutionnelle, il s’en écarte notamment par la nature du chef : Salazar n’a rien d’un Duce ni ne cherche à incarner un rôle de leader charismatique pour mobiliser les masses.
Une attention particulière est accordée à la dimension sociétale de l’histoire du Portugal, que ce soit dans l’étude du déroulement du processus politique qui a succédé à la révolution des Œillets de 1974 ou dans les évolutions récentes, dans le contexte de la crise qui frappe sévèrement le pays.
Dans cet ouvrage de référence, l’auteur a le mérite de dépasser les clichés du « bon émigré portugais » et de la trilogie des F (fado, Fatima, football) qui ont la vie dure, pour mieux revenir sur le caractère précurseur du Portugal dans l’histoire européenne. Que se soit sa transition démocratique réussie, sa trajectoire au sein de l’union européenne et sa place dans le monde. Pour mieux partager sa passion. Yves Léonard a notamment eu l’heureuse idée de citer cette phrase de Miguel Torga, un grand nom des lettres portugaises : « Nous qui avons été les nomades du monde devront être dorénavant les sédentaires comparses d’une Europe où nous nous sommes toujours sentis à l’étroit et dans laquelle nous n’avons pas su nous accomplir. Partir, c’est notre façon de nous émanciper. Dorénavant, notre chemin ne sera plus celui de la recherche de vastes espaces pour affirmer ce qui nous était refusé dès le berceau, mais celui d’une découverte intérieure ajournée depuis des siècles et de siècles. »
Tigrane Yégavian – Revue Afrique – Asie – Novembre 2016
Yves Léonard, professeur à Sciences Po Paris, consacre au pays qu’il connaît si bien un livre aussi savant qu’accessible. Du règne de Carlos Ier, à la fin du XIXe siècle, jusqu’à nos jours, le petit État qui fut un grand empire, a traversé épreuves et métamorphoses, sans toujours suivre une ligne claire. Instauration précoce de la République (1910), lourde dictature salazariste (1932-1970), révolution des illets (1974), décolonisation douloureuse (1975), entrée dans l’Europe (1986), dévissage économique, cure d’austérité ressemblant à une mise sous tutelle, entre 2011 et 2014.
Le Portugal actuel ne ressemble plus guère au pays qui expédiait au xxe siècle sa jeune main d’oeuvre hors des frontières. Mais ces transformations ont profondément affecté les institutions, les structures économiques, les logiques sociales. La république lusitanienne ne manque pas aujourd’hui d’atouts pour affronter les défis de la modernité, avec une société civile active et dynamique, une jeunesse éduquée, une diaspora solide sur tous les continents une influence culturelle enfin par le biais de sa langue. A la charnière de plusieurs mondes, le Portugal remobilisé peut échapper à l’essoufflement du système politique que pointe Yves Léonard et renouer avec la prospérité.
L’histoire – Janvier 2017
« Quatre régimes politiques différents, quatre constitutions, quatre dictatures dont, avec l’Estado Novo salazariste, la plus longue dictature d’Europe occidentale au XXe siècle, deux chefs d’État assassinés (le roi dom Carlos en février 1908, le dictateur Sidonio Pais en décembre 1918), une transition démocratique singulière, une décolonisation tardive et conflictuelle réduisant brutalement le Portugal à son rectangle européen d’avant l’expansion du XVe siècle, une émigration endémique, le plus souvent synonyme de pauvreté et d’avenir incertain, enfin une européanisation corollaire d’une modernisation à marche forcée, dont l’apogée sera « l’Expo’98 », cette exposition universelle organisée à Lisbonne en 1998 pour commémorer le 500e anniversaire du voyage de Vasco de Gama en Inde : autant d’événements et de tendances qui scandent un long vingtième siècle portugais présenté ici, par souci de clarté pédagogique, en une dizaine de chapitres chronologiques reflétant les principales césures de son histoire politique. »
Voici le voyage d’exploration à travers une histoire contemporaine riche et méconnue, que nous propose Yves Léonard, docteur en histoire et diplômé de Sciences Po, où il enseigne depuis 1997. Ancien boursier de l’Institut Camões et de la Fondation Gulbenkian (Lisbonne), spécialiste de l’histoire contemporaine du Portugal, il a notamment publié Le Portugal, vingt ans après la Révolution des œillets (1994), Salazarisme et fascisme (1996), La lusophonie dans le monde (1998) Mário Soares, Fotobiografia (2006), collaboré à de nombreux ouvrages collectifs, comme une História da Expansão Portuguesa (1999) et dirigé l’édition d’ouvrages et de revues, dont Intellectuels, artistes et militants. Le voyage comme expérience de l’étranger (avec Anne Dulphy et Marie-Anne Matard-Bonucci, 2009), De la dictature à la démocratie : voies ibériques (avec Anne Dulphy, 2003), ainsi que le dossier sur le salazarisme publié dans Vingtième siècle. Revue d’histoire (n° 62, 1999). Il est aussi l’auteur de travaux sur l’histoire du Tour de France cycliste, dont La République du Tour de France (Seuil, 2003).
L’ouvrage d’Yves Léonard, issu de cours à Sciences Po sur le Portugal au XXe siècle et nourri des dernières avancées de la recherche, est construit chronologiquement autour des évolutions politiques et économiques du pays, sans oublier les questions sociales et culturelles. Les deux premiers chapitres sont consacrés à la chute de la monarchie et à la Première République (1910-1926) et ses difficultés. Quatre chapitres traitent de l’arrivée au pouvoir de Salazar et de l’Estado Novo. Le chapitre 7 retrace son renversement par la révolution des oeillets (1974-1976), et les trois derniers chapitres retracent l’histoire du Portugal démocratique, qui fait le choix de l’adhésion européenne, permettant une modernisation tardive, et de ses difficultés financières, socio-économiques (chômage, recrudescence de l’émigration surtout des jeunes diplômés, réduction des salaires, explosion des impôts, de la précarité et de la pauvreté) et politiques (essoufflement du système) depuis le début du XXIe siècle.On peut se livrer à une lecture plus transversale de l’histoire contemporaine du Portugal, autour de quelques thèmes, constamment mêlés, qui paraissent récurrents : le sentiment et la crainte de la décadence du pays ; la quête de la grandeur impériale passée ; la recherche difficile de la modernité politique, économique et culturelle ; le rôle révolutionnaire de l’armée dans la vie politique ; la tentation de la dictature.
À la recherche de la grandeur perdue
La crise de l’Ultimatum britannique de janvier 1890 marque, pour Yves Léonard, l’entrée dans le XXe siècle d’un Portugal pas remis du traumatisme de la perte du Brésil dans les années 1820 et confronté à une crise politique, sociale, économique et financière. Les ambitions africaines du Portugal – relier d’ouest en est les territoires entre l’Angola et le Mozambique, « le nouveau Brésil » – se heurtent à l’ambition britannique d’une liaison Le Caire – Le Cap. Le 11 janvier 1890, le gouvernement anglais lance un ultimatum au Portugal : renoncer au projet africain sous peine d’un blocus naval de Lisbonne. Le gouvernement portugais cède, ce qui provoque une fièvre nationaliste et anglophobe au Portugal, qui débouche sur une virulente remise en cause de la monarchie (et même une éphémère révolte républicaine à Porto le 31 janvier 1891), dont profite le parti républicain pour se poser en rempart de la patrie humiliée. Cette humiliation génère en outre dans les milieux intellectuels et au sein des élites une conscience de la décadence et un discours sur le déclin du pays, qui va jouer un rôle dans le rejet puis l’effondrement de la monarchie, renversée en 1910 par un coup d’État militaire et remplacé par la Première République (1920-1926).
De même, la dictature nationaliste de Salazar va jouer sur cette nostalgie d’un passé grandiose pour convaincre, lors de l’Exposition coloniale de Porto en 1934 et l’Exposition du monde portugais en 1940, pour raviver le sentiment de la grandeur du Portugal (« Le Portugal n’est pas un petit pays »), qui doit s’incarner grâce à l’empire colonial. Salazar (hostile aux colonies dans les années 1920 notamment pour des raisons financières) fait adopter en 1930 l’Acte colonial, fondement du système colonial et considère les colonies comme « les grandes écoles du nationalisme portugais » (Salazar, 1932), popularisées par une intense propagande coloniale, qui dans les années 1950 ne parle plus de « colonies » ou d’Empire colonial » mais de « provinces d’outre-mer » et « d’Outre-mer portugais » et s’approprie la théorie du lusotropicalisme (Gilberto Freyre, 1933), mettant en avant « le « génie colonisateur » des Portugais et leur propension mythifiée à coloniser différemment, de façon « suave », grâce aux vertus du métissage… ». En réalité, point de « sociétés multiraciales » outre-mer : comme on le sait, les guerres coloniales, qui commencèrent en 1961 et aboutirent aux indépendances en 1975, entraînèrent la fin de la dictature et la révolution des Oeillets en 1974. L’ancrage européen (candidature en 1977, adhésion à la CEE en 1985), dans un autre « ailleurs », principale réponse au traumatisme de la perte de l’Empire colonial qui ramenait le pays à ses frontières du XVe siècle. Comme l’expliqua le Premier ministre Mario Soares au Monde en 1985, « c’est le poids même de notre empire qui nous a distraits de l’Europe et fait entrer en décadence ». L’adhésion était donc une opportunité de moderniser l’économie et la société portugaises. Les seuls restes de ce passé colonial sont l’institutionnalisation politique du « monde lusophone » autour de la langue portugaise, avec la création en 1996 de la Communauté des pays de langue portugaise, et depuis la crise de nouvelles relations avec le monde lusophone (Afrique et surtout Brésil).
Modernisation, révolutions et forces armées
La question de la modernisation du pays s’était posée dès la seconde moitié du XIXe siècle, les crises se résolvant par des coups d’État militaires. Après une première moitié du XIXe marquée par la lutte entre libéraux et absolutistes puis entre libéraux, par la guerre civile, les révoltes populaires et les interventions de l’armée, la séquence qui aboutit à la chute de la monarchie s’ouvre en 1851 par un coup d’État militaire, puis une période de « Régénération » : les modérés entendent lutter contre la décadence du pays par une politique de modernisation (grands travaux, ouverture aux importations) qui ne réussit pas. Incapable de moderniser et démocratiser le pays, le système politique s’essouffle, fondé sur le poids des caciques locaux,l’alternance « Régénérateurs »/« Progressistes » et une monarchie qui devient une oligarchie bureaucratique. Les républicains, on l’a vu, avaient profité de l’agitation sociale et du rejet croissant d’un régime monarchique de plus en plus crispé (dissolution de la Chambre, répression anti-républicaine, gouvernement de dictature de Joao Franco en 1907). Les tentatives de révoltes à Lisbonne, l’assassinat du roi dom Carlos et du prince héritier en 1908, par des membres de la Carbonaria, société secrète républicaine, la répression anti-républicaine poussèrent le parti républicain, jusqu’ici réformiste, à adopter alors la voie révolutionnaire. En octobre 1910, à Lisbonne, un coup d’État de militaires affiliés à des sociétés secrètes républicaines et de groupes civils armés de la Carbonaria renverse la monarchie et aboutit à la proclamation de la Première République (1910-1926), une des rares républiques européennes avec la IIIe République française.
Cette République, qui avait suscité beaucoup d’espoirs de modernisation et de démocratisation du pays et lancé de nombreuses réformes (nouvelle Constitution démocratique, droit de grève, réformes de l’Université, de l’enseignement primaire et de l’orthographe, réforme fiscale et nouvelle monnaie, nouvel hymne et nouveau – et actuel – drapeau, séparation de l’Eglise et de l’Etat inspirée du modèle français lois sur le divorce et le mariage civil) dans ce sens, qui la fragilisèrent (forte opposition monarchiste et catholique), comme l’entrée dans la Première Guerre mondiale en 1917, puis la dictature du « fasciste avant la lettre » Sidonio Pais (la « Republica Nova » en 1918). L’agitation sociale, l’impuissance et l’instabilité politiques d’un régime parlementaire à bout de souffle expliquent le coup d’État militaire, soutenu par une partie des élites politiques et intellectuelles traditionaliste et nationalistes, qui mit fin en mai 1926 à la République. C’est encore la division politique, entre militaires au pouvoir (républicains conservateurs, monarchistes et nationalistes), et la crise financière (le Portugal frôle la banqueroute), qui permirent à un professeur d’économie de l’Université de Coimbra, Salazar, de prendre progressivement le pouvoir, entre 1928, quand il fut nommé ministre des Finances, et 1932, lorsqu’il accèda à la présidence du Conseil à la place d’un militaire.
La dictature salazariste est donc née de la dictature militaire et dut composer avec l’armée. Au sommet de l’Etat il y avait dyarchie : un militaire (le maréchal Carmona jusqu’en 1951 pour l’arme terrestre, le général Craveiro Lopes jusqu’en 1958 pour l’armée de l’Air, puis l’amiral Américo Tomas jusqu’en 1974 grâce à un trucage massif de l’élection dont fut victime le général Delgado, leader de l’opposition qui voulait renvoyer Salazar) chef d’État à vie aux fonctions de plus en plus protocolaires, et un président du Conseil, le dictateur Salazar dont les réformes mirent en place un régime anti-démocratique et le repli autarcique (protectionnisme, sacralisation de l’équilibre budgétaire, institutions corporatives) du pays. Salazar prit bien soin de maintenir une stricte subordination des militaires, qui finirent par constituer un État dans l’État, au pouvoir civil, d’autant plus facile que le républicanisme militaire n’était plus une alternative crédible.Quant aux réformes et à la modernisation du pays… Les années 1930 furent dominées par les théoriciens du corporatisme, mis difficilement en place. Les années d’après-guerre el furent par des ingénieurs et des économistes néoclassiques ou keynésiens, d’où des mesures de développement économique, de grands travaux et d’ouverture commerciale et touristique timide à l’Europe qui provoquèrent une croissance économique, dans un pays qui restait très rural, très inégalitaire et immobiule, marqué par une extrême pauvreté, source de l’émigration portugaise massive, et un analphabétisme permanent. C’est l’armée coloniale, ses jeunes officiers et sous-officiers, qui renversèrent le 25 avril 1974 le régime dirigé par le successeur de Salazar (mort en 1970), Marcello Caetano. l’installation de la démocratie prit 18 mois, dans une lutte entre militaires, extrême-gauche, communistes et gauche non communiste, dont sorti victorieux le parti socialiste de Mário Soares. Comme on l’a vu, les trente années qui ont suivi ont été celles de l’ancrage européen par la démocratisation et la bipolarisation politique, la modernisation économique à marche forcée (grâce à l’aide communautaire et l’ouverture aux IDE) et l’européanisation des modes de vie d’un pays qui connait aujourd’hui la crise et la tutelle européenne de la Troïka (2011-2014) qui imposa des mesures drastiques d’austérité. Face au mécontentement populaire, à la montée de l’abstention et du vote antisystème, la gauche portugaise PS, Verts, PC) s’est réunie en 2015-2016 autour d’un programme commun de réformes post-austérité et d’un gouvernement à ossature PS.
L’Estado Novo : dictature ou totalitarisme fasciste ?
Dernier thème transversal : la dictature. Celle de Salazar n’est pas la première, il y eut auparavant des périodes de dictature en 1907 et en 1918, mais la plus longue. Yves Léonard revient sur la question de la caractérisation de l’Estado Novo, qualifié dès les années 1930 de « fascisme de professeur d’université » par Miguel de Unamuno puis les opposants au régime. Il s’attarde sur le débat académique passionné, et qui a connu un « été chaud » en 2012, sur la nature du régime, né en 1968 des travaux du sociologue Herminio Martins sur l’opposition au Portugal et de ceux de Manuel de Lucena, qui a qualifié en 1976 le salazarisme comme un « fascisme sans mouvement fasciste ». Pour certains chercheurs le salazarisme a eu une dimension totalitaire dans les années 1930, avec les caractéristiques traditionnelles des totalitarismes. Pour d’autres chercheurs qui travaillent depuis les années 1980, le salazarisme est un régime autoritaire, qui a notamment mis au pas un véritable mouvement fasciste les « Chemises bleues » du National syndicalisme. Pour ces chercheurs, le salazarisme a emprunté des traits au fascisme dans ses institutions mais s’en est écarté notamment par la nature du chef (pas de leader charismatique type Duce), un parti unique jamais déterminant en matière de formation des élites ou de mobilisation des masses, par un corporatisme inspiré par le catholicisme social dont Salazar se réclamait. Yves Léonard refuse « d’identifier un régime fasciste par ses seuls signes extérieurs » (p. 133) et voit dans l’Estado Novo une dictature technocratique, nationaliste et impériale, catholique, traditionaliste et conservatrice, qui abandonne après 1945 le « badigeon romain » pour s’éloigner du « champ magnétique des fascismes » (p. 119).
Pour conclure, on trouvera dans le livre très agréable à lire, très clair et didactique d’Yves Léonard un ouvrage bien plus riche que ne peut le laisser entrevoir cette recension et précieux pour mieux aborder l’histoire souvent mal connue d’un pays trop souvent réduit au cliché des trois F (Fado, Fatima, Football) et à l’émigration en France. L’ouvrage est agrémenté d’une préface de Jorge Sampaio, ancien président socialiste de la République portugaise(1996-2006), de nombreuses illustrations, d’une très utile chronologie commençant en 1807 et d’une abondante bibliographie portugaise et internationale. Louons enfin la qualité du travail d’édition des éditions Chandeigne (l’ouvrage est un bel objet), qui contribue grandement à faire connaitre le Portugal, son histoire et sa culture en France.
PS : cette recension, qui aurait dû être terminée plus tôt, rencontre une triste actualité puisque Mário Soares est décédé le 7 janvier 2017.
Laurent Gayme – Les clionautes – Janvier 2017
Émission radiophonique « Passage à niveau » – Novembre 2016 – Artur Silva, journaliste à Radio Alfa mène un entretien avec Yves Léonard, auteur de Histoire du Portugal contemporain.
Le Portugal, de Salazar à Raoul Costa
Le dernier ouvrage d’Yves Léonard, spécialiste de l’imaginaire colonial portugais et du salazarisme, comble un vide.
Certaines nécrologies, parues dans la presse française, à la suite du récent décès de Mário Soares (1924-2016), attestent que l’histoire contemporaine du Portugal est assez peu connue. On y retrouve de nombreuses erreurs factuelles et un recours paresseux à quelques notions ou expressions stéréotypées (la saudade par exemple). Ces carences se doivent, en partie, à la rareté des publications, en français, sur le XXe siècle portugais. Les différentes histoires du Portugal publiées en France n’étaient pas rédigées par des vingtiémistes et ce siècle était le plus souvent expédié. Il est vrai que l’historiographie contemporaine portugaise a été, jusque dans les années 1970, peu abondante, la dictature salazariste dissuadant, par différents mécanismes, les recherches. C’est pourquoi cet ouvrage comble opportunément une carence.
Une histoire européenne
Soigneusement édité et agrémenté d’une pertinente iconographie, il offre au lectorat français une vue d’ensemble sur le Portugal contemporain. Yves Léonard, avec une plume élégante et claire, s’appuyant sur l’historiographie portugaise tout en puisant dans la littérature, retrace l’histoire d’un pays fréquemment absent des grandes synthèses historiques.
Seule, peut-être, la Révolution des Œillets qui, pendant plusieurs mois, a concentré l’attention des hommes politiques et intellectuels français, constitue l’exception qui confirme la règle. Or l’histoire du Portugal, s’inscrit pleinement dans l’histoire européenne et, à certaines époques, certains événements ou processus le placent à l’avant-garde. Ainsi une République s’implante dès 1910 et s’attaque rudement à l’Église catholique dans un pays dominé par un monde rural massivement pratiquant. Ou, en 1917, une dictature, dirigée par un homme fort et charismatique, qui articule légitimité électorale, mise en place d’un parlement corporatif, tentative de conciliation du patronat et des syndicalistes, s’instaure, introduisant des pratiques et des caractéristiques que l’on retrouve en Italie cinq ans plus tard.
Salazar et le Salazarisme
L’ouvrage commence par une des crises du libéralisme portugais, l’Ultimatum de 1890. Lorsque la Grande-Bretagne ordonne au Portugal d’abandonner son rêve d’unir ses possessions en Angola et au Mozambique, reliant l’Atlantique à l’Océan Indien, une partie de la population, surtout urbaine, proteste contre la perfide Albion et les républicains fustigent une monarchie accusée de brader le patrimoine légué par les navigateurs des Grandes découvertes. L’Empire colonial, dont les origines se situent au XVe siècle, période exaltée par l’élite politique et intellectuelle portugaise depuis le XIXe siècle, s’inscrit profondément dans le discours sur l’identité nationale et tant les républicains que la dictature de l’Estado Novo (1933-1974) prônent la défense et le développement de l’Outre-Mer.
Auteur d’un Salazarisme et fascisme, Yves Léonard revient sur l’Estado Novo et son principal dirigeant António de Oliveira Salazar, qui reste quarante ans au gouvernement, dont trente-six comme premier ministre. Cette dictature et ce dictateur suscitent encore de nombreux débats historiographiques, parfois vifs. Ce régime était-il fasciste ? Telle est la question qui obnubile les historiens portugais et qui, comme note Yves Léonard, finit parfois par appauvrir les recherches sur cette période historique.
L’histoire immédiate n’est pas négligée par l’auteur qui termine son propos avec l’arrivée au pouvoir du socialiste António Costa, dans le cadre d’une coalition inédite dans l’histoire du Portugal contemporain. En effet, le Parti communiste portugais et le Bloc des gauches (part issu de l’unification de plusieurs mouvements d’extrêmes gauche) ont accepté de soutenir un gouvernement socialiste, sur la base d’un programme récusant les politiques d’austérité menées par les gouvernements précédents.
Mobilisant l’historiographie portugaise la plus récente, l’ouvrage éclaire un peu certains domaines négligés par les historiens lusitaniens. Ainsi, la part belle est offerte à l’histoire sociale délaissée. À l’exception des dernières années – et notamment les mutations sociales qui ont boulversé le pays, tardivement mais extrêmement rapidement. Le Portugal, qui jusque dans les années 1960 voyait 40% de sa population active travailler dans une agriculture peu productive, est devenu un pays dans lequel le tertiaire domine, partageant la plupart des caractéristiques des autres pays d’Europe occidentale.
Espérons que le primat de l’histoire politique (et culturelle) s’estompera et qu’un renouvellement de l’histoire sociale permettra de nourrir les futures rééditions d’un ouvrage qui s’imposera comme une lecture incontournable pour tous ceux désirant mieux connaitre l’histoire du Portugal.
Vincent Pereira – L’ours – Mars 2017
La synthèse que propose Yves Léonard sur l’histoire du Portugal depuis la dernière décennie du xixe siècle comble une lacune importante. Il nous manquait, en effet, depuis plusieurs décennies, un ouvrage en français faisant office de manuel pour les étudiants, les chercheurs et toutes celles et ceux s’intéressant à ce « petit pays », marge occidentale de l’Europe, à la fois proche et méconnu. L’auteur part du paradoxe qui nous saisit face à cet objet : un pays géographiquement proche, aux liens culturels, historiques et démographiques étroits avec la France, mais qui garde sa part de mystère et peine à se débarrasser d’un certain nombre de clichés anthropologiques aujourd’hui éculés.
Rendre sa complexité et sa singularité à l’histoire du dernier long siècle portugais, telle est donc la première ambition de l’ouvrage, à la fois classique par ses choix narratifs et original par la sélection d’une iconographie soignée, malgré les contraintes éditoriales, qui en rend la lecture fort agréable. Aussi constitue-t-il un outil de travail précieux : les repères chronologiques remontent au blocus napoléonien et s’achèvent sur l’élection à la Présidence de Marcelo Rebelo de Sousa en janvier 2016. La bibliographie, resserrée, se veut le reflet des renouvellements et des débats des quinze premières années du XXIe siècle, en portugais, en anglais et, le cas échéant, en français, sans toutefois négliger une sélection de « classiques » qui ont jalonné l’historiographie portugaise depuis la Révolution des Œillets. Un index des noms propres aurait pu compléter de manière heureuse ce travail de grande qualité.
En dix chapitres, l’auteur livre une narration qui se veut de prime abord très politique, par le choix des ruptures : les changements de régime (1910, 1926, 1974) ou bien encore, à l’intérieur du long tunnel de l’Estado Novo (1926-1974), les scansions du vote de la Constitution (1933), de la fin de la Seconde guerre mondiale (1945) et du début des guerres africaines (1961). La période postérieure à la Révolution des Œillets est elle aussi divisée de manière classique, l’arrimage européen de 1986 constituant un temps fort de l’histoire récente du pays. Pourtant, derrière ce choix a priori très narratif, Yves Léonard porte une attention constante à des approches plus économiques, sociales et culturelles, ainsi qu’aux apports de la sociologie et de la science politique pour sortir le lecteur d’un récit strictement linéaire de l’histoire de ce pays-monde : histoire intérieure, c’est-à-dire métropolitaine, mais aussi histoire internationale et coloniale d’un pays où le fait migratoire tient une place essentielle. Le point de départ de 1890 est sans surprise, tant sont liées la crise de la monarchie finissante et la crise dite de l’Ultimatum qui a opposé Lisbonne et Londres sur le terrain africain. L’entrée dans le contemporain s’est donc faite dans la douleur d’une cuisante humiliation diplomatique, obligeant le Portugal à réduire ses ambitions coloniales et ses projets de « nouveaux Brésils » (chap. 1). La centralité du fait colonial apparaît d’emblée dans la prose d’Yves Léonard, qui ne néglige pas pour autant les autres facteurs et déterminants de l’histoire du pays. La période républicaine (1910-1926), encore mal connue, bénéficie des nombreuses mises au point que le centenaire du 5 octobre 1910 a suscitées (chap. ii).
Spécialiste de la période salazariste, Yves Léonard réinterroge l’étonnante longévité du régime qui occupe le cœur du xxe siècle portugais (chap. iii à vi), réaffirmant les conclusions de son ouvrage consacré à la question des rapports entre le salazarisme et les régimes fascistes (Salazarisme et fascisme, Paris, Chandeigne, 1996, 223 p.) et reprenant à son compte l’expression de René Rémond du « badigeon à la romaine » — abandonné après 1945 — pour souligner la superficialité des « emprunts » faits par Salazar à la geste de son homologue italien, sans le charisme ni les gesticulations païennes. Il ne passe néanmoins pas sous silence les positions plus nuancées — ou radicales, selon la perspective adoptée —, comme celles de Fernando Rosas, Luís Reis Torgal ou Manuel Loff, ce dernier défendant la « véritable nature d’un régime intrinsèquement et durablement fasciste » (p. 120), et souligne le caractère toujours actuel et sensible de la question, évoquant les controverses de l’été 2012, au plus fort de la crise économique.
Le chapitre vii, consacré à la Révolution des Œillets, revient sur les dix mois qui ont changé le destin du pays, soulignant le caractère unique dans l’histoire d’une révolution dont la première étape, la chute du régime en place, se réalisa en vingt-quatre heures et sans effusion de sang, ou presque. L’auteur s’efforce pourtant de dépasser le mythe en décrivant scrupuleusement les rapports de force entre civils et militaires, les divisions au sein du Mouvement des forces armées (MFA), les inquiétudes étrangères à l’idée que s’installe à la pointe occidentale de l’Europe un régime marxiste sous l’influence du Parti communiste. L’option libérale et européenne apparaît à de nombreuses reprises sous la plume de l’auteur comme celle de la « raison », portée par les élites socialistes et centristes (p. 199), le « cœur » du pays battant pour l’Atlantique Sud.
Le chapitre final pose de nombreuses questions face à la situation politique actuelle, qui voit, depuis la crise des années 2011-2014, contesté le système né quarante ans plus tôt. Cette crise ne se traduit pas par l’émergence d’une extrême droite influente, mais par des taux d’abstention croissants ainsi que par l’audience d’une gauche incarnée à la fois par un Parti communiste stabilisé et allié aux Verts et par le Bloc de gauche (Bloco de esquerda). De cette configuration est née une « alliance inédite » (p. 252) avec le PS en novembre 2015. Les dernières pages nous montrent un Portugal sur une ligne de crête, partagé entre impératifs communautaires que le « bon élève de l’Europe » entend respecter et attentes sociales de sortie de l’austérité.
Au terme de cette lecture, on est frappé par le caractère transversal de certaines thématiques : la question de l’outre-mer, relayée par celle, pleine d’univoques, de la lusophonie dans le monde (pp. 229-236), mais aussi la place de l’armée et des militaires dans la vie politique, ou bien l’intense et constante activité diplomatique des gouvernements successifs. Yves Léonard pointe ainsi des champs encore en friche ou en demande de renouvellement de la recherche (histoire de l’administration et des techniques de gouvernance, du droit, des relations internationales), ou bien des périodes qui mériteraient notre attention, comme la première République et les années 1960, sclérosées par un pouvoir et un dictateur vieillissants mais aussi travaillées par des dynamiques démographiques, économiques et culturelles qui ont bouleversé la société et préparé, autant que le bourbier africain et la crise du commandement militaire, la rupture du 25 avril.
Nadia Vargaftig – Les Mélanges de la Casa Velasquez – Avril 2018